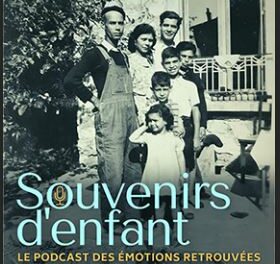Participants :
André LOEZ qui poursuit des recherches sur l’histoire sociale de la guerre et les mutins de 1917, a publié en 2010, 14-18 les refus de la guerre. Une histoire des mutins (Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire »). Il est aussi l’auteur avec Nicolas Mariot, d’Obéir / désobéir. Les mutineries de 1917 en perspective (La Découverte , 2008) et avec Rémy Cazals de La Vie au quotidien dans les tranchées de 1914-1918 (Cairn, 2008).
Nicolas MARIOT, directeur de recherche au CNRS, codirecteur de la rédaction de la revue Genèses. Sciences sociales et histoire. Ses travaux, pluridisciplinaires et transversaux, portent sur les conditions sociales de l’adhésion et du conformisme. Il collabore régulièrement aux activités du Collectif de Recherche International et de Débat sur la Guerre de 1914-1918. Il vient de publier Tous unis dans la tranchée, 1914-1918, les intellectuels rencontrent le peuple, Paris, Seuil, 2013.
Hervé MAZUREL, spécialiste de l’Europe romantique, historien des imaginaires et des sensibilités, qui a publié Vertiges de la guerre. Byron, les philhellènes et le mirage grec, Première édition, 2013.
Emmanuel SAINT-FUSCIEN, auteur d’une thèse portant sur les relations d’autorité au sein de l’armée entre la fin du XIXe siècle et la fin de la Grande Guerre, Á vos ordres ? La relation d’autorité dans l’armée française de la Grande Guerre. Il mène actuellement « une recherche autour du réinvestissement des expériences de la Grande Guerre, tant celles des élèves que celles des enseignants, dans les mondes scolaires au cours des années 1920 et 1930. Parallèlement, il tente de participer à l’élaboration d’une histoire de l’autorité pédagogique et de l’obéissance scolaire en Europe au cours du XXe siècle. »
Depuis une quinzaine d’années l’historiographie de la première guerre mondiale se caractérise par « l’omniprésence trop forte du débat entre contrainte et consentement ». Dans la recherche historique, bien qu’il existe des divergences et des approches différentes, le débat ne se retrouve pas de façon aussi nette. Cette table ronde réunit quatre historiens spécialistes de l’autorité, de la guerre et de la Première Guerre mondiale plus particulièrement, les uns se reconnaissant plus dans une approche qui relève de l’histoire culturelle, les autres dans une approche qui relève de l’histoire sociale.
L’histoire culturelle de la Grande guerre s’est épanouie avec des historiens de l’Historial de Péronne, Stéphane Audoin-Rouzeau en particulier. Elle s’intéresse aux expériences partagées par le plus grand nombre : la violence, le deuil et autres phénomènes universels : sa visée est anthropologique. L’histoire sociale cherche plutôt ce qui relève de l’appartenance sociale des individus. Les grands travaux historiques des années 1970 étaient des travaux d’histoire sociale, les plus emblématiques étant la thèse d’Antoine Prost sur les anciens combattants, Les Anciens Combattants et la société française (1914-1939), Paris, Presses de la FNSP,1977, celle de Jean-Louis Robert sur les ouvriers parisiens (Ouvriers et mouvement ouvrier parisien 1914-1919, histoire et anthropologie, Université Paris 1, 1989) celle de Jules Maurin sur les soldats languedociens, Armée-Guerre-Société : soldats languedociens (1889-1919), Publications de la Sorbonne, 1982. La thèse de Jean-Jacques Becker, 1914, comment les Français sont entrés dans la guerre, Presses de la FNSP date elle aussi de 1977 et est au fondement de l’histoire culturelle, qui a supplanté l’histoire sociale durant les années 1990.
André Loez fait part de son évolution personnelle : ses premiers travaux furent d’histoire culturelle, puis il évolua vers l’histoire sociale. Ses recherches ont commencé à la fin des années 90 alors que dominait l’histoire culturelle, celle de l’imaginaire partagé, travaillant sur le thème des larmes, sur les émotions. En travaillant sur les mutins il a ressenti une réelle insatisfaction à l’utilisation des concepts et des démarches de la seule histoire culturelle, qui lui a semblé avoir un caractère trop englobant. Il a modifié son parcours, influencé plus particulièrement par la lecture d’un article de Rémy Cazals, qui était un compte rendu critique du livre de Stéphane Audoin-Rouzeau et de Jean-Jacques Becker. Il a pris conscience que l’interrogation sociale sur les mutins et sur l’État (qui produit l’encadrement) était trop évacuée.
Emmanuel Saint-Fuscien commence par présenter un cas concret afin de montrer que l’opposition histoire culturelle/histoire sociale est trop schématique. En 1915, un soldat qui est en train d’écrire une lettre dans un endroit tranquille de son casernement refuse d’exécuter l’ordre que lui donne un sous-officier, puis l’insulte. Le soldat passe en conseil de guerre et est acquitté à l’unanimité. Les juges qui ont désavoué toute la hiérarchie militaire, ont estimé que l’ordre n’était pas légitime et que les conditions dans lesquelles il avait été donné justifiaient le refus du soldat. L’intervenant montre qu’une étude approfondie de ce dossier permettrait une analyse pertinente sur :
– la fonction des tribunaux militaires qui exercent une justice de classe.
– la justice tempérée par l’expérience de la guerre dont les juges ont tenu le plus grand compte.
– le registre de langage : « les injures proférées rompent le pacte hiérarchique ».
– les relations d’autorité dans lesquelles se trouve le soldat : il est dans une « cage » mais il dispose d’une marge d’autonomie.
– les activités du soldat : le soldat est isolé, il écrit. C’est un moment d’intimité que lui vole son chef.
Emmanuel Saint-Fuscien conclut qu’un délit ou un crime est d’abord un acte social mais que ce sont des processus culturels qui le mettent en évidence. Ici la culture de guerre influe sur la justice sociale : ce cas montre que les réalités sont irréductibles aux explications seulement sociales ou culturelles. André Loez complète en affirmant que se résume ici le débat sur ce qui fit tenir les soldats : la contrainte (la peur de la justice militaire) ou le consentement qui vient des représentations mentales et culturelles. La seule contrainte ne peut expliquer tout, le pur consentement n’est pas soutenable. Les soldats du front sont soutenus par un arrière qui attend qu’ils tiennent, et par une institution. Les comportements ne sont réductibles ni à une pure contrainte, ni à un pur consentement.
Hervé Mazurel qui a travaillé sous la direction d’Alain Corbin puis de Stéphane Audoin Rouzeau, déclare pratiquer une histoire plutôt ethnoculturelle et travailler sur les sensibilités pour renouveler l’histoire de la guerre. La guerre est un révélateur, elle donne accès à tout un univers relégué dans les profondeurs du non-dit en temps de paix. Il s’intéresse aux guerres oubliées et rappelle qu’au XIXe siècle il y a eu « un grand nombre de guerres projetées par les Européens sur le théâtre mondial », les Britanniques ont par exemple mené cinquante guerres au cours du XIXe siècle. Ces guerres opposent des sociétés très différentes, porteuses de modèles guerriers très différents et de cultures de guerre très différentes. La guerre est une interface de culture qui oppose les systèmes de valeurs différents.
Nicolas Mariot critique le fait que l’histoire de la première guerre mondiale ait été écrite, affirme-t-il, non sans exagération, à partir de 30 à 40 témoignages, toujours des témoignages de lettrés qui constituaient une infime partie de la société française : il y avait en 1914 6000 à 7000 bacheliers par an. La population des témoins s’avère ne pas être représentative de la population globale.
Tous ces historiens, qu’ils pratiquent une histoire plutôt sociale ou plutôt culturelle sont conscients de tout ce qu’ils partagent : une approche des acteurs par le bas, l’utilisation de sources individuelles, l’importance attribuée à l’événement. Mais ils estiment ne pas travailler de la même façon. Ils constatent aussi que l’histoire politique et diplomatique est devenue le parent pauvre de cette évolution historiographique.