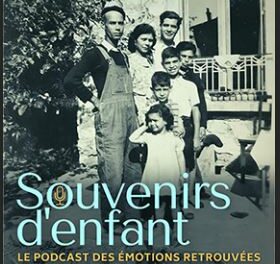« De l’histoire bataille à l’histoire totale », compte-rendu de Joël Drogland et Jean-Michel Crosnier
Hervé Drévillon, professeur à Paris1 Panthéon Sorbonne, « Batailles, scènes de guerres, de la Table Ronde aux tranchées » – Paris, Editions du Seuil (coll. « L’univers historique »), 2009
Yves Poncelet, modérateur, inspecteur général, excuse Alain Corbin, absent pour raison de santé à qui il souhaite au nom de l’assistance un rapide rétablissement.
YP : L’histoire bataille s’est imposée à nous. Pourquoi ?
C’est un retour (J Le Goff) de l’histoire politique comme donnée irréductible et pas seulement comme un élément de la superstructure (cf. Alain Rémond) écrasée par les infrastructures de l’histoire éco comme interdisciplinaire et narrative, le retour de l’événement en opposition à l’école des Annales qui ne considérait que la longue durée, l’événement ne faisant partie que de l’écume. Il est désormais considéré comme éclairant l’imaginaire des sociétés et les conditions de production des mémoires.
Il s’agit aussi du retour du récit de la narration, présent dans les programmes et redevenu un aspect majeur du temps de cours.
Enfin, le retour de la biographie comme genre avec laquelle l’école des Annales avait des relations ambivalentes (cf. Lucien Fèvre, Marc Ferro, Murray Kendall, Le Goff) qui nous dit quelque chose de la « durée d’une vie » et dépasse largement la démarche historienne pour mettre en avant l’individualité.
Eternel retour ? Si les noms restent les mêmes, les réalités sont très différentes. La catégorie « bataille » a d’ailleurs longtemps été jugée désuète…
YP : Par quel cheminement en êtes-vous arrivé à vous intéresser aux batailles ?
HD : je ne suis pas un précurseur (cf. G Duby qui a relégitimé la bataille dans « le dimanche de Bouvines »). Ces questions me sont venues comme historien des pratiques culturelles avec Roger Chartier, et je me suis mis immodestement dans les pas de Duby.
Mon 1er objet d’étude a été l’histoire du duel.
Donc comment la société d’Ancien Régime produit des normes et de la violence à la fois. Norme rigoureuse et codifiée mais violence extrême pour des raisons futiles, décrite par les traités d’escrime.
Ce que Duby a apporté, c’est l’idée que la bataille nous donne accès à des pratiques sociales et des pratiques de mise en écriture.
Ce qui avait disqualifié l’histoire-bataille était le récit national, voire nationaliste. John Keegan « Faces of the battle » (dont le titre français, plus explicite est : « Anatomie de la bataille ») réhabilite l’individu dans ses sensations, qu’il replace à hauteur d’homme : la contrainte imposée au corps, les sensations dans la bataille, l’odeur, le brouillard ; dans la bataille, après les premier tirs, on ne voit plus, on entend.
Il faut prendre en compte cette évocation, mais pas comme un artifice de romancier, mais pour comprendre ce qu’est ce moment où un Etat prend le pari de la violence et impose à l’ensemble des individus de le relever.
Par exemple, sous l’Ancien-Régime, personne n’oblige en effet les officiers royaux à se ruiner pour se payer un équipement. La bataille renvoie à chaque individu le reflet de son devoir. Que défend-t-on ? Le Roi, la nation et ce sera plus tard la République.
La bataille est aussi un moment paroxystique : grande intensité, violence, exposition à la mort. Elle n’est pourtant connue que par les récits qui en sont faits, du moins jusqu’à la période napoléonienne. La notion de bataille est donc indissociable de la narration, d’ailleurs comme dit plus haut, réhabilitée dans les pratiques scolaires avec le récit.
YP : Mais la bataille, c’est quoi ?
Elle se définit par la règles des 3 unités de temps, de lieu, et d’action, auxquels s’ajoutent les conventions acceptées entre les 2 armées et important, avec les 3 armes (sinon on parlera de « rencontres » ou « d’affaires » ou de « combats »).
Son nom (le lieu de la bataille) est également le résultat d’une convention, voire d’un enjeu (cf. la bataille de Marengo, corrigée comme répétition générale d’Austerlitz par Bonaparte)
Si la bataille existe déjà dans l’Antiquité, elle se transforme voire disparaît en 14-18. La Voie Sacrée brise totalement l’unité de lieu de Verdun : les moyens modernes de la logistique modifient radicalement l’agencement classique de la bataille. La question des moyens limités dans un espace ne joue plus. Les critères de « campagne » deviennent alors pertinents.
YP : Qu’en est-il des 3 temps dans les batailles ?
Il faut distinguer 3 temps pour le signification et la fonction de la bataille dans la guerre
1) De la fin de la guerre de Cent ans avec l’arrivée de l’artillerie et la naissance des armées modernes et de l’Etat moderne qui invente la Taille au début du règne de Louis XIV et qui se termine avec la bataille de Rocroi. Il est question ici de l’idéal nobiliaire (plutôt que chevaleresque) comme pratique culturelle (dont les formes ne sont jamais données une fois pour toutes, et varient en fait selon les pratiques sociales et militaires, jusqu’à ce que la cavalerie lourde entre en crise (cf. Bayard tué par un arquebusier anonyme en 1524 pendant les Guerres d’Italie). Or on le savait déjà un siècle avant, depuis Azincourt. Mais les idéaux ont la vie dure, ainsi, en 1590, Henri IV à Yvry mène la bataille dans le pur style chevaleresque, l’objectif politique étant de s’allier la noblesse contre les tentations « populaires » de la Ligue.
2) le temps de « l’économie de la violence » avec Vauban et le siège de Maastricht. La guerre s’inscrit dans des moyens limités, le siège, sans éviter une grande violence, à l’instar des grenadiers à cheval du Roi dont la devise est « la terreur et la mort » qui n’hésitent pas à égorger les prisonniers au siège de Valenciennes. La bataille de Fontenoy est d’une brutalité absolue : le comte d’Anterroches, en invitant les Anglais à tirer les premiers, condamne sa 1ère ligne à une mort certaine.
3) Avec la fin du XVIIIème, la conscription permet un potentiel illimité sans qu’on puisse parler encore de guerre totale, mais la question de l’anéantissement d’une société est posée.
On découvre alors que la guerre se fait avec des individus. Sous l’Ancien-Régime on mobilisait des soldats, qui une fois enrôlés, n’avaient pas de droits ; ils étaient des rebuts de la société qui, parce qu’ils avaient choisi de tuer, ne pouvaient être recommandables. Or la conscription a transformé le soldat en citoyen qui a des droits. On ne peut plus conduire le citoyen à la boucherie sans rendre des comptes. Vers 1812-13, l’individu réapparait à la faveur de la débâcle de Russie. Chacun veut sauver sa peau (déchainement de l’égoïsme). La question de l’individu est démultipliée par la conscience de la puissance des armes qui rend possible l’anéantissement total. La pensée militaire va prendre en compte cette donnée et prendre 2 directions opposées : celle de Jaurès qui s’interroge sur la notion de soldat-citoyen et estime que la guerre doit être respectueuse de l’individu, celle de Foch qui fait le pari que face à la capacité inouïe de destruction, il faut abréger le temps d’exposition des individus. Il sait que l’on peut creuser des tranchées comme lors de la guerre de Mandchourie. Mais il parie qu’une offensive à outrance est nécessaire pour éviter l’anéantissement. Il faut alors convaincre les soldats de monter à l’assaut sous des « orages d’acier » (Jünger) ; triomphe alors la notion d’entité nationale : les individus n’existent plus, ils se fondent dans le Tout de la nation comme corps animique. En Allemagne, triomphera après la guerre de 14 une conception qui ignore l’individu au profit de la masse, et qui portera en germe le totalitarisme nazi.