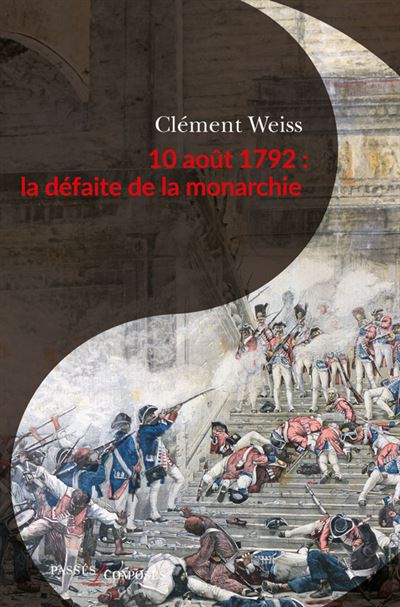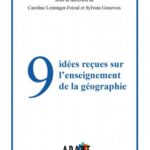Carte Blanche à l’IHMC Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine et à l’Institut de Recherche Historique du Septentrion. La Table ronde est organisée par Catherine Denys professeure émérite à l’université de Lille, Gilles Malandain, professeur à l’université de Versailles Saint Quentin au CHCSC, Valéria Pansini, maitresse de conférences à l’université Rennes 2, Clément Weiss, professeur en CPGE, docteur en histoire. La modération est assurée par Valéria Pansini.
Les combattants nous portent sur le champ de bataille, ce lieu si particulier où les vivants côtoient les morts, où les vivants font face de manière continuelle à la possibilité de leur propre mort. Mais c’est aussi le lieu de l’affrontement guerrier, où selon les époques historiques et les moments, la préparation du combat, l‘action elle-même et ses lendemains, la relation mort-combattant s’articulent différemment. Nous avons tous des images en tête, parfois construites qui, de cet affrontement, ne résistent pas toutes à une analyse historique.
Messieurs les anglais, tirez les premiers !
Clément Weiss, spécialiste de la période révolutionnaire, choisit de parler de ses images imprécises et parfois forgées de l’expérience au combat.
En relation avec les images mentales que l’on peut avoir de la guerre de l’époque moderne, il est possible que lorsqu’on se représente une bataille au XVIIIème siècle en se référant à la scène de bataille issue du film Barry Lindon réalisé par Stanley Kubrick. L’autre stéréotype le plus marqué concerne un des épisodes de la guerre de succession d’Autriche [1740 -1748], la bataille de Fontenoy qui s’est déroulée le 11 mai 1745. Elle est connue à double titre, d’une part parce qu’il s’agit d’une des rares victoires de l’armée française avant la période révolutionnaire, et d’autre part parce qu’elle est réputée pour un épisode particulier quasi proverbial. Lors de la confrontation entre l’armée française et l’armée britannique, et d’après un récit transmis par Voltaire, à l’époque où il est l’historiographe de Louis XV, le capitaine du régiment des gardes français le comte Joseph-Charles-Alexandre d’Anterroches (1710-1785) aurait dit : « messieurs les anglais tirez les premiers », phrase qui a aujourd’hui largement dépassé le cadre militaire. Cette anecdote est recoupée par d’autres témoignages même si, par exemple, le capitaine du régiment britannique, Lord Hay raconte dans ses Mémoires qu’à priori ce sont les anglais qui auraient proposé aux français de tirer les premiers, ce à quoi le Comte d’Anterroches aurait répliqué : « Messieurs nous ne tirons jamais les premiers, tirez vous-même ! ». Dans tous les cas, cet épisode est devenu archétypal de ce que l’historien américain John Lean appelle une esthétique de la guerre qui se serait forgée à l’époque de la guerre et que l’on a résumé à partir du XIXème siècle avec l’expression « guerre en dentelles », une guerre qui se ferait entre aristocrates et animée par des valeurs d’honneur et une certaine élégance, au final peu éloignée de l’idéal chevaleresque.
On en a tiré l’idée que les guerres étaient plus limitées, notamment en les opposant avec les guerres postérieures, celles de la période révolutionnaire et de l’Empire. Cette vision a été beaucoup remise en cause par les historiens, surtout depuis les travaux pionniers de l’historien britannique John Keegan qui a publié Anatomie de la bataille. Depuis, d’autres historiens lui ont emboîté le pas comme Hervé Drévillon qui reprennent certaines intuitions données par le Colonel d’infanterie Charles Ardant du Picq [1821-1870]. Ses écrits ont été publiés après sa mort sous le titre : Etudes sur le combat dans lequel il démontre que l’enjeu principal pour s’interroger sur l’expérience que peut avoir un soldat du feu c’est de réfléchir à sa capacité à maitriser sa peur, de la surmonter et de l’apprivoiser et donc d’agir sous le feu grâce à son expérience de la peur. Cette configuration particulière, correspond à la guerre de ligne, où nous avons les armées alignées sur trois ou quatre rangs et sur plusieurs kilomètres, les soldats se tirant dessus. C’est une configuration particulière où la capacité des soldats à endurer le feu est vraiment la clé. Des travaux, et des réflexions entamées dès le XVIIIème siècle expliquent que la proposition de l’officier français de laisser l’adversaire de tirer le premier n’était pas si aberrante car cela revient dans l’idée à retenir son feu en partant du principe que si l’adversaire tire en premier, il va pouvoir découvrir sa puissance de feu et si la ligne est capable de contenir ce feu, elle peut continuer à avancer. Mais, pour autant, si on se fie aux travaux de l’historien américain John A. Lynn, l’idée de retenir son feu pour laisser son adversaire tirer en premier est pertinente s’il y a 100 mètres d’écart ou plus entre les armées puisqu’à l’époque les soldats ont des fusils dont la portée utile, au-delà de 100 mètres, commence à se réduire drastiquement tandis que la cadence de tir est assez limitée à cause du temps de recharge (on tire au maximum deux à trois coups par minute), ce qui fait, qu’effectivement si vous laissez votre adversaire tirer, vous avez une fenêtre d’initiative pour avancer. Or, d’après les témoignages, à Fontenoy il y aurait eu entre 30 et 50 mètres d’écart entre les deux lignes, ce qui fait qu’à cette distance, même avec des fusils pourtant beaucoup moins précis que ceux d’aujourd’hui, même avec des tireurs peu aguerris (les soldats tirent à cette époque sans nécessairement viser !) ces derniers vont réussir à toucher quasiment à chaque coup, ce qui fait qu’Hervé Drévillon cite le Chevalier de Folard, théoricien de la guerre du début du XVIIIème siècle qui dit que dans une telle configuration c’est comme si les soldats se passaient réciproquement par les armes, comme si on condamnaient les soldats de la première ligne au peloton d’exécution.
Faire la guerre debout
On fait la guerre debout (on ne fait pas la guerre couché avant la fin du XIXème siècle, avec l’invention de la mitrailleuse). L’enjeu est donc d’avoir une endurance et une discipline pour être capable de faire face aux tirs ennemis. Du coup, cette configuration de la guerre debout et cette capacité d’affronter la mort en face à quelques mètres de distance, au-delà du cas de ces batailles de l’Ancien Régime c’est une approche de la guerre qui a posé la question d’un rapport particulier à la mort des combattants qui affronteraient de manière quasi stoïque le fait de potentiellement mourir mais qui auraient la capacité psychologique et mentale et la discipline de rester immobiles. Ceci fait que même dans des configurations de combat où finalement on est très éloigné de ce type de champ de bataille ouvert, on retrouve un peu cette esthétique de la guerre.

Un exemple nous est fourni avec la journée du 10 août 1792 qui marque la fin de la Monarchie française. Une troupe hétéroclite, composée de sans culottes et de gardes nationaux, se lance à l’assaut du château des Tuileries, défendu par des gardes suisses, des gardes nationaux royalistes et par des nobles, volontaires. A l’issue d’une journée de combats assez violents, Louis XVI perd son statut de Roi. En 1892, cent ans plus tard, une représentation de cette journée a été peinte par Henri-Paul Motte. Si le tableau a été depuis perdu, de nombreuses représentations parallèles nous donne une idée de sa composition. On voit que, dans la manière dont il représente la journée, sa vision est animée par sa vision de la guerre debout, et donc, de la guerre en dentelles.
Clément Weiss présente quelques unes des conclusions qu’il tire de cette représentation. Ce qui est intéressant dans son choix de représentation, Motte montre les combats les plus mal connus : ceux à l’intérieur du château, aux pieds du grand escalier des Tuileries. Nous avons d’un côté les gardes suisses, au sommet et les assaillants. On observe une forme de réduction chromatique : on voit avant tout du rouge et du bleu, ce qui revient à simplifier la réalité puisqu’il y avait, en fait, du bleu des deux côtés ! Des gardes nationaux se tiraient donc dessus car ils ne parvenaient pas forcément à se reconnaitre ! Mais nous retrouvons cette configuration du peloton d’exécution, car à une distance très réduite nous avons deux formations qui se font face. Un élément est frappant : autant les gardes nationaux tirent profit de la topographie des lieux pour se mettre à l’abri, autant les gardes suisses sont en plein milieu de l’escalier, certains sont sur la gauche et rechargent leurs armes mais ils ne bougent pas. Ils ne semblent pas tirer profit de l’escalier derrière eu mais, au contraire, bravent le feu tout en rechargeant leurs fusils, opération qui prend du temps. Cela montre une forme de configuration rappelant la guerre de ligne et la conception linéaire de la guerre. Les corps devant illustrent la violence des combats. La scène est donc à la fois saisissante, mais en même temps paraît assez improbable, puisque, compte tenue de la cadence de tirs des fusils, modèle 1777 dit de Chareville, qui tire 2 à 3 coups par minute, et qui, surtout, dégage une fumée, noire, très épaisse, donc dans une telle scène, au mieux il y aurait un seul échange de tir de chaque côté, puis les coups échangés auraient eu lieu à l’arme blanche ou en utilisant la crosse de son fusil mais dans tous les cas, recharger et se laisser tirer dessus est impossible. Le fait de reconfigurer ça comme une fusillade à bout portant, donne cette idée de reconnecter le combat avec cet imaginaire de la guerre linéaire comme si le peintre cherchait à harmoniser et ordonner les corps, et à exalter le courage des combattants des deux camps qui ont regardé la mort en face. Nous avons donc là aussi une forme esthétique du duel avec l’idée que le combat est quasiment une forme d’ordalie au bout de laquelle on voit qui reste encore debout. A noter que lorsque les combats ont débuté vers 9h du matin, le Roi n’était plus dans le château, la famille royale ayant été mise à l’abri plus tôt au siège de l’Assemblée nationale. L’enjeu du combat n’était donc même pas de capturer le Roi puisqu’il n’y était plus.
Par conséquent on plaque cet imaginaire de la mort en réalisant une espèce de vision miniaturisée de la guerre de ligne en réintroduisant une forme de géométrie tactique dans ces combats d’intérieur alors que, d’après les divers témoignages des survivants dont on dispose, l’assaut n’a jamais été ordonné de cette manière et nous avons plutôt, face à une mêlée chaotique et frénétique, des combats qui se déroulent à l’arme blanche et au corps à corps, et non au fusil, impossible à utiliser dans ces conditions. La scène est aussi simplifiée dans le sens où nous n’avons que des combattants qui sont représentés alors qu’à l’intérieur du château il y a aussi beaucoup de domestiques et de femmes, des individus qui fuient également, se cachent dans des escaliers ou des recoins, et dont le tableau ne fait pas mention. Nous sommes bien loin de la guerre de ligne mais plutôt dans des haines recuites qui se règlent lors des combats. Rejouer la guerre de ligne permet dont de rejouer sur cette fascination qu’exerce cette configuration comme le montre la scène de bataille dans Barry Lindon.
Cette configuration est fascinante car elle suppose une maitrise de soi paroxysmique et une forme de stoïcisme, mais aussi et surtout sur la discipline et une forme de coercition afin de garder la cohésion. En réalité cette capacité des armées à garder leur cohésion vient d’abord d’une discipline très stricte, accompagnée de châtiments corporels à l’époque des armées, ce que dans le cas de l’armée prussienne. Il y a donc aussi cet enjeu de la discipline avec lequel il faut compter.
***
Valéria Pansini enchaîne sur la dernière analyse de Clément Weiss et mentionne en guise de transition qu’il existe peu de représentations de gens en fuite dans les tableaux représentant les batailles. Or, rationnellement un individu ne peut pas rester stoïque et en première ligne, c’est assez irrationnel.
Etre efficace et discipliné
La question de la discipline est là et rejoint la question de contraindre l’individu à agir à l’intérieur du groupe et faire en sorte que la peur qui est individuelle et collective soit apprivoisée. La discipline est une base dans la création d’automatismes. Ce n’est pas seulement la peur d’une punition si on ne va pas au combat c’est aussi la création d’un ensemble d’automatismes tel que le soldat sait ce qu’il doit faire et le met en place sans réfléchir aux conséquences. L’enjeu est toujours le même : que l’armée soit efficace. La discipline est la solution et un modèle gagnant. Mais, être efficace veut dire aussi :
-garder la capacité de décision
-conserver la chaine du commandement
-garder la possibilité de l’action collective.
Il faut que l’armée continue de fonctionner comme un tout et non comme une série d’individus, agir pour contraindre le groupe de manière conjointe y compris en dépassant l’instinct personnel.
Cette discipline est aussi un modèle précis qui est inscrit dans un moment historique précis, un élément qui existe dans les armées de façon différente.
Le modèle le plus abouti est le modèle prussien du XVIIIème siècle, qui, vu de France, répond à une exigence pragmatique des armées : l’idée est de faire comme les prussiens qui gagnent. Pour simplifier, l’idée est la suivante : « ils sont disciplinés donc faisons comme eux pour gagner ». Du côté français, l’idée aussi est simple : les Prussiens gagnent contre nous alors que nous ne sommes pas disciplinés. En 1757, Rossbach pour l’armée française, le modèle de ce qu’il ne faut pas faire. Quant au modèle, l’armée française n’arrive jamais à atteindre ce modèle de discipline prussien car ce modèle évolue lui aussi selon les époques. A la fin du XVIIIème siècle et à la Révolution et sous l’Empire : le modèle de soldat change, et non le modèle de l’armée. On pense davantage à un soldat capable de s’affranchir non de la discipline mais des automatismes et qui va être capable de fougue, d’action d’éclat (la bravoure) donc la capacité de faire face à la mort et de la défier. Le soldat citoyen révolutionnaire devient l’accomplissement de ce type de soldat. A ce moment, ce sont les français qui deviennent alors le modèle de soldat à suivre, celui qui fait face avec bravoure et parfois jusqu’à l’excès.
La valeur de l’expérience combattante
Mais l’excès n’est pas non plus efficace, il faut trouver un équilibre. La bravoure peut être glorifiée, certes mais la question surtout à l’époque napoléonienne, avec des soldats qui restent en campagne très longtemps est celle du maintien en vie de ces derniers, l’économie des vies étant devenue centrale. Or cette armée connaissait aussi beaucoup de pertes mais il y avait aussi cette exigence de continuer à avancer dans des campagnes pouvant durer, parfois, des années. Devant cette exigence d’efficacité, l’avantage est donné à la question de l’expérience du combat. Ce qui est valorisé est l’expérience du feu, la capacité à lui faire face parce qu’on sait de quoi il s’agit. Une page célèbre de Clausewitz insère un calcul rendant compte de cette expérience : la première fois, le soldat, devant le feu et le danger et la tempête sensorielle que représente une bataille, peut rester pétrifié et incapable d’agir. Clausewitz calcule ce fait : il faut mettre les soldats devant un premier feu pour qu’ils deviennent prévisibles et utilisables car un soldat qui a déjà eu cette expérience sait à quoi s’attendre, capable d’agir par la suite.
Dans le même sens, dans les armées napoléoniennes, on considère de façon bien plus positive que le reste de l’armée, les « vieilles troupes ». Ces soldats, qui connaissent le feu et sont prévisibles sont aussi équilibrés car ils sont capables de faire face à la mort et ils savent éviter les risques inutiles. On peut donc compter sur eux. En prime, ce qui est très intéressant, est que ce sont des soldats qui intègrent les nouveaux dans un système où l’expérience des uns sert aux autres. Ces soldats expérimentés connaissent la peur et la mort des autres, la peur de leur propre mort, les blessures, ils savent ce qu’est le danger et à quoi s’attendre en général. Mais même dans des situations constamment stressantes, les mettant continuellement en danger, il y a parfois des moments qui dépassent ces possibilités. Ces troupes ne sont pas habituées à tout car il existe des limites. Au-delà de la mort quotidienne et des risques continuels auxquels ils sont confrontés, il y a aussi la mort exceptionnelle, des situations où le soldat fait face à une situation excessive. L’exemple nous est fourni lors de la campagne du Portugal et l’épisode de la chute d’Almeida en juillet-août, une petite forteresse située à la frontière tenue par des troupes portugaises et un commandant anglais. Des civils sont présents dans la forteresse. Les Français, commandés par Masséna, commencent le siège mais une bombe atterrit dans le château d’Almeida qui était aussi un dépôt de poudre. Une énorme explosion se produit, visible à des dizaines de kilomètres. On estime qu’environ mille personnes sont tuées. Dans les récits mémorialistes cette mort instantanée d’autant de gens, dont des civils est considérés comme quelque chose de très effrayant et d’excessif, et dont on n’a pas l’habitude. Des personnes qui écrivaient froidement sur d’autres batailles, face à celle-ci, où des mères cherchent les cadavres de leurs enfants, sont totalement désemparées face à l’ampleur des événements. Mais Almeida n’est pas un cas unique.
***
Catherine Denys prend la suite et évoque, pour commencer, la bataille méconnue de Malplaquet qui a eu lieu le 11 septembre 1709 et qui fait partie de cette longue guerre de succession d’Espagne [1701-1714] au cours de laquelle la France se bat contre les pays d’Europe de l’Ouest et se retrouve en difficulté dès le début. En 1708 : Lille est prise, puis les combats avancent lentement vers Paris.
Mais les batailles restent relativement rares dans les guerres d’Ancien Régime. Faire campagne veut dire tenir le pays et les villes mais pas forcément faire bataille. Les armées peuvent se suivre et s’observer à quelques kilomètres de distance mais sans livrer bataille. Il peut y avoir entre une ou deux par an à cette époque, par campagne, les généraux hésitant à livrer bataille pour la bonne raison que cette dernière est marquée par l’incertitude du vainqueur, même si l’armée est bien entrainée et à priori plus puissante que celle d’en face.
La bataille de Malplaquet est la plus meurtrière du XVIIIème siècle : elle aurait fait 30 000 morts en une journée en réalité courte, la bataille débutant à 8 heures du matin et se terminant à 15h, heure à laquelle l’armée française se retire en bon ordre en laissant le champ de bataille aux Anglais et aux Hollandais. Mais pourquoi tant de morts en une journée incomplète ? On le devine à l’aide d’une peinture réalisée par le peintre français Louis Laguerre [1663-1721] peintre du château du Duc de Marlborough, commandant de l’armée anglaise qui illustra la demeure de ce dernier avec les scènes de cette bataille. Sur ce tableau, nous voyons des individus qui enlèvent des arbres, tandis que des trous sont visibles. La veille de la bataille, l’armée française a creusé des tranchées dans un espace vide compris entre deux bois et s’était enterrée dans cet espace. Durant toute la journée, les anglo-hollandais ont tenté de traverser au milieu de ces deux bois, ce qui signifiait se faire massacrer au final par les français protégés par les tranchées. Par conséquent, ces derniers n’avaient qu’à sortir les fusils et tirer sur l’adversaire. En fait, la bataille s’est décidée sur les ailes dans les bois, et peu au centre. Les anglo-hollandais ont gagné avec davantage de morts sur le terrain que les français, la proportion étant de 2/3 contre 1/3. La bataille a été sanglante parce que la configuration des lieux ne permettait pas aux armées de bouger, même si nous sommes sur 8 kilomètres de large.

Cette masse de morts a beaucoup frappé les esprits malgré des batailles très sanglantes lors de la guerre de Succession d’Espagne. A cette époque, nous sommes sur des effectifs d’armées régulières assez élevés mais Malplaquet laisse aux contemporains l’impression d’un carnage allant au-delà de l’acceptable. Les récits de visites par des hollandais et des anglais surtout montrent qu’ils sont frappés par la quantité de morts restés là où ils sont tombés les uns sur les autres, constituant des grappes de morts pris les uns entre les autres, ce que représente le tableau de manière très euphémisée car nous ne voyons aucune goutte de sang ici, comme dans les autres tableaux. Mais nous voyons ici des morts, au centre, ce qui est assez rare dans les peintures de batailles à l’époque, et des morts déjà dépouillés présentés sur le tableau.
Un second tableau est présenté avec le duc de Marlborough et le prince Eugène qui entrent dans les tranchées françaises. Nous voyons des morts en train d’être dépouillés au premier plan. La bataille est au-dessus. Nous sommes dans un cas particulier qui préfigure quelque part Verdun. Nous sommes, dans ce cas, très éloigné de la guerre en dentelles.
***
Valéria Pansini enchaîne et signale pour introduire l’intervention de Gilles Malandain que l’on voit rarement des morts dans les peintures, introduits plutôt dans l’après-bataille. Que reste -t-il après ce déchainement de violences ?
Gilles Malandain nous propose de déplacer le propos en considérant que la bataille ne s’arrête pas forcément au moment où les armes se taisent, elle se poursuit parfois longuement tant qu’une mémoire en reste et en particulier une mémoire liée aux lieux. Que reste-t-il de l’expérience de la mort sur le champ de bataille sur la longue durée à travers les traces, les vestiges et les marqueurs mémoriels (tombes, chapelles et monuments divers) ?
Waterloo par William Turner
Gilles Malandain s’appuie pour sa démonstration sur un tableau du peintre anglais William Turner. Nous sommes à Waterloo, une des batailles les plus meurtrières de la période napoléonienne qui s’est jouée sur un espace très réduit. Le bilan des morts ne serait cependant que de 10 ou 11 000 au lieu des 40 000 morts souvent avancés, ce qui correspondrait plutôt aux pertes (morts immédiats, morts postérieurs à la bataille et blessés). Ici la représentation de Turner est particulière. Il n’a pas connu la bataille, il a visité le champ de bataille deux ans après durant l’été 1817. A ce moment, William Turner participe à un grand concours organisé cette année-là, prenant pour thème cette grande victoire nationale. Mais Turner le fait d’une manière atypique et choquante pour l’époque au point que son tableau fut mal reçu par la critique.
En juillet 1817 lorsque Turner visite Waterloo, il ne voit bien sûr aucun mort, ces derniers ayant été évacués en 3 ou 4 semaines, après la bataille. En comparaison, Walter Scott qui le visite 7 semaines après la bataille, en août 1815, avait dit qu’on sentait encore l’odeur des morts à ce moment. Mais pour Turner c’est différent, les morts ont disparu. Il n’y a pas de tombes individuelles. Beaucoup ont été incinérés sur place, d’autres ont été enterrés dans des fosses communes. Seul le village situé à proximité accueille quelques rares sépultures. Les carnets de croquis de Turner montrent ses premières vagues esquisses. Puis, il revient et élabore le tableau. Il réalise d’abord une aquarelle puis exécute son grand tableau présentant la scène de nuit, avec un champ de bataille jonché de morts. Les uniformes sont mêlés, s’indifférencient, sur les armes sont présents les monogrammes de Napoléon et du Roi d’Angleterre en évidence comme pour rappeler la responsabilité ultime de ce désolant tableau. Loin de représenter la bataille et des hommes debout et héroïques, Turner montre des hommes morts, couchés et surtout anonymisés. Ce parti-pris est choquant car on attend des peintres qu’ils représentent l’héroïsme des soldats anglais et de beaux soldats admirables dans le combat. A l’inverse le peintre présente le résultat de la bataille : des hommes seuls et abandonnés au sol.

Waterloo lieu touristique
Un tourisme du champ de bataille s’instaure avec Waterloo qui devient le lieu le plus visité dans le genre au XIXème siècle. Gilles Malandain glisse ici une référence à un ouvrage qu’il a co-dirigé avec Catherine Denys et Benjamin Bruel, professeur à Montréal et auquel a participé Valéria Pancini sur la campagne du Portugal. Une série de réflexions a été portée sur la mémoire des batailles telles qu’elles s’inscrivent dans leurs lieux et les différents usages des champs de bataille après l’événement. Sur les champs de bataille, les morts sont plus ou moins omniprésents, c’est un lieu de mort sur lequel plane le souvenir des morts de la bataille chez les visiteurs. Mais sur les champs de bataille traditionnels, on les voit très peu car il n’y a pas de tombes ni de cimetières particuliers. Des fosses communes existent mais elles ne sont pas marquées dans le paysage et sont rapidement oubliées. L’impression qui se dégage finalement est de marcher sur les morts car ils sont partout, mêlés à la terre où le visiteur se promène car il n’y a justement pas de lieu qui leur est dédié. Certes à Waterloo et sur d’autres champs de bataille du XIXème siècle on trouve quelques monuments individuels ou régimentaires. Mais les morts sont malgré tout présents comme le montre le tableau de Turner. Visiter les champs de bataille revient à retrouver d’une certaine façon les morts.
Un autre exemple nous est donné avec l’écrivain allemand libéral et romantique Heinrich Heine grand admirateur de Bonaparte qui s’arrête à Marengo. Il décrit en quelques lignes sa visite : il croit percevoir le fantôme de Napoléon dans la brume du matin, et pense à tous les soldats morts au nom de la liberté mais note dans le même temps qu’ils sont privés de toute mémoire : des soldats qui : « errent dans ces plaines comme des chiens privés de leur maître ».
L’exigence de sépulture, mutation majeure du XIXème siècle
Une mutation importante s’opère au XIXème siècle quant à la place des morts sur le champ de bataille. L’exigence de sépulture individuelle et si possible nominative, pour tous les soldats et pas uniquement les officiers, une démocratisation de la mort au combat se fait de plus en plus pressante et gagne jusqu’aux champs de bataille, comme en témoigne en 1860 l’invention dans l’armée prussienne de la plaque d’identité des soldats. Portée autour du cou, elle permet de les identifier et de pouvoir porter ensuite un nom sur une tombe ou une plaque commémorative. Les fosses communes sont quant à elles de plus en plus signalées, respectées voire sanctuarisées. Puis, le cimetière militaire apparait avec la guerre de Crimée : on assiste à une nécropolisation des champs de bataille qui deviennent ainsi des cimetières sans murs, où les morts sont à la fois omniprésents mais aussi mieux situés et mieux repérés qu’auparavant. Autre élément : on voir resurgir près 1850 en particulier en Italie, et en France après la guerre de 1870 la vieille forme monumentale de l’ossuaire à Solférino et San Martino, à Magenta … Cette ostentation macabre qui surgit fait que le mort est toujours visible. Dès avant 14-18 les monuments aux morts se multiplient, et sont conçus pour tous les morts, parfois nationaux mais aussi, à l’occasion, transnationaux. Ainsi, à Solférino, sont regroupés des ossements français, mais aussi italiens et autrichiens. Dans la foulée, certains champs de batailles anciens se voient attribuer des monuments aux morts au gré des commémorations organisées.
***
Quelles sources ?
Valéria Pansini prolonge le propos de Gilles Malandain en posant la question finale de la table ronde : quelles sont les sources permettant de savoir comment les soldats sont morts ? Quels sont les récits que l’on a ? Il y a un paradoxe : ce sont les survivants qui racontent, avec une culpabilité du survivant qui peut s’exprimer, mais selon les époques, des différences sont perceptibles.
Catherine Denys explique que pour les récits de la guerre des XVIIème et XVIIIème siècles nous disposons de très peu de témoignages qui évoquent des batailles et les seuls existants sont écrits par des officiers qui commandent et qui ne sont pas dans la position du simple soldat. Une exception cependant existe : le témoignage d’un soldat allemand mercenaire qui a tenu son journal pendant la guerre de 30 ans, mais avec une limite dans la mesure où il raconte peu les batailles. Donc nous ne savons pas comment les simples soldats vivaient la bataille. Du côté des officiers, les textes sont biaisés car ils écrivent rarement au moment de la bataille mais bien plus tard et ceux qui écrivent au XVIIème et XVIIIème le font pour se mettre en valeur durant la bataille, où ils ont forcément été au premier rang, et réalisé des exploits d’où l’aspect fanfaron dans ces mémoires. La peur n’est d’ailleurs jamais évoquée. Mais jusqu’en 1750, il est très rare en général de rencontrer un journal intime où les individus racontent leurs sentiments. Même dans les moments les plus critiques, leur héroïsme et leur habilité sont privilégiées. En prime, ils refont souvent la bataille. Mais rien n’est mentionné concernant la souffrance des soldats.
Clément Weiss souligne un paradoxe pour les XVIIIème et XIXème siècle, mentionné par Stéphane Audouin-Rouzeau à propos de la Grande Guerre : malgré la quantité de sources dont on dispose pour cette dernière, il est difficile de savoir comment les millions de soldats sont morts car malgré les outils dont l’historien dispose (archéologie, reconstitutions balistiques …), au mieux nous arrivons à reconstituer l’arme responsable, la blessure, mais par contre l’enchainement des gestes, parfois très courts, inconscient qui ont conduit à cette mise à mort échappe complètement aux historiens. Les sources écrites émanent de ceux qui ont survécu mais, au niveau de la mise en récit les survivants peuvent avoir l’impression d’avoir une dette à rendre aux morts, un hommage à leur rendre. Certains écrits au XIXème mettent ainsi en scène de manière fictive. En 1792-1793 : des recueils sont publiés et largement diffusés comme le Recueil des actions héroïques et civiques des Républicains qui raconte des morts héroïques de citoyens français ayant combattu dans les armées révolutionnaires et qui seraient morts au combat. Dans le camp adverse, les mêmes écrits circulent. Pour la journée du 10 août les officiers suisses qui ont survécu ont, pour certains, raconté leur appréhension de la bataille et rendent hommage à leurs frères d’armes qui sont tombés. On en arrive à des récits qui racontent de manière précise la mort de quelqu’un mais selon un mode fictif comme le montre l’exemple d’un sergent suisse qui a commencé à combattre en tuant sept hommes, qui a épuisé toutes ses cartouches, puis a eu le bras droit coupé à la hache, aurait pris ensuite son sabre de la main gauche et qui aurait eu encore le temps de tuer une vingtaine d’adversaires ayant de tomber !
D’un paradoxe à l’autre …
Mais ces témoignages créent d’autres paradoxes. Si nous restons sur le 10 août, les officiers nobles ayant survécu, quand ils racontent la journée, racontent toujours et bien entendu des scènes de massacres généralisés aux Tuileries, mais ne racontent jamais comment eux ont survécu au milieu de cette violence. On peut le comprendre de différentes manières : dans le cas de ces officiers nobles qui ont défendu la monarchie, on peut supposer une forme de mauvaise conscience du survivant qui s’exprime. Le jour du 10 août, ils ont échoué à protéger la Monarchie en tant que chevaliers servants. En général ils témoignent sous la Restauration dans le but de demander des pensions, en décrivant une populace avinée assoiffée de sang, des animaux, à l’opposé de leur idéal chevaleresque. La violence dont ils ont dû user ne correspondait pas à la « bonne guerre », la guerre contre pairs respectant le même code de l’honneur. Dans cette mesure, le fait qu’ils se contentent de périphrases vagues pour présenter leurs propres actions, et de propos généralistes évacuant les détails, peuvent exprimer cette idée que les combats qui ont eu lieu ce jour-là ont eu lieu au corps-à-corps.
Valéria Pansini précise pour conclure que la mort et les circonstances de la mort qu’on inflige sont rarement racontées dans les récits.
Rédaction compte-rendu et photographies : Cécile Dunouhaud
Ouvrages mentionnés durant la table ronde :