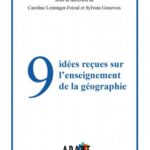Rapidement introduite par Valérie Hannin, la conférencière part de la présentation de la Marche sur Rome par l’exposition Mostra della Rivoluzione, ouverte du 28 octobre 1932 au 28 octobre 1934 au Palais des expositions de la capitale italienne.
Les Faisceaux de combat, fondés par Mussolini le 23 mars 1919, donnent naissance au Parti National Fasciste en novembre 1921. Son congrès de Naples fixe le scénario de la prise du pouvoir le 24 octobre 1922 : « Nous voulons devenir l’Etat ! ».
L’exécution est confiée aux « quadriumvirs », dits aussi les Ras (nom d’origine éthiopienne) : Italo Balbo, Michele Bianchi, Emilio De Bono et Cesare Maria De Vecchi. Des centres de commandement sont mis en place tandis que Mussolini retourne à Milan, observer de loin la tournure de la marche sur Rome. Le départ est donné le 27 et pendant trois jours des colonnes de chemises noires (26 000 hommes au total), légèrement armées, convergent vers la capitale, en attaquant en chemin des préfectures et des gares.
Le pouvoir organise une riposte : 28 000 soldats disposant d’armes lourdes attendent autour de Rome. Le président du conseil, Luigi Facta, demande au roi de décréter l’état d’urgence. Le souverain hésite puis refuse. Il expliquera plus tard qu’il voulait éviter une effusion de sang. En fait, il avait succombé aux pressions des milieux nationalistes, civils et militaires. On envisage un gouvernement Salandra, comprenant Mussolini. Celui-ci quitte Milan pour Rome quand il est assuré d’être nommé président du conseil.
Ce n’est pas une révolution, mais pas non plus un opéra-bouffe, comme disent certains antifascistes. Les apparences de la légalité ne sont sauves qu’en surface. Mussolini joue sur deux tableaux, la légalité et la violence.
Deux ouvrages récents sont riches d’informations :
- Giulia Albanese, La marcia su Roma, Rome, Laterza, 2006 ;
- Emilio Gentile, E fu subito regime. Il fascismo e la marcia su Roma, Rome, Laterza, 2012, tr. fr. Soudain le fascisme / La marche sur Rome, l’autre révolution d’Octobre, Paris, Gallimard, 2015
Jusqu’où remonter dans le temps pour comprendre le processus ?
On invoque le caractère tardif de l’unité – comme en Allemagne. Piero Gobetti (1901-1926) appréhende le fascisme comme une « autobiographie de la nation », autrement dit un révélateur de ses lacunes. Cependant, la démocratisation était bien engagée au début du XXème siècle, en Italie comme en Allemagne.
Paxton remarque que « tous les pays ayant un système politique de masse » ont connu un mouvement fasciste.
La pensée marxiste, inaugurée sur ce chapitre par Daniel Guérin, voit dans le fascisme une manière pour le capitalisme de retarder sa crise fatale.
Patrizia Dogliani propose une « histoire sociale du fascisme » montrant le rôle des grands propriétaires de la plaine du Pô, soucieux de mettre fin aux occupations de terres par les coopératives d’anciens combattants (on avait fait pendant la guerre des promesses de partage des latifundia) : les milices fascistes ont été utilisées comme des milices patronales (à rapprocher des origines de la mafia dans le Sud).
Cependant le fascisme est aussi soutenu par une partie des classes moyennes et par le lumpen-prolétariat, espérant que le fascisme pourra leur apporter ce que le libéralisme leur refuse.
Cela n’explique pas tout. L’autre événement à prendre en compte est la Grande Guerre. Les travaux de George L. Mosse ont été traduits très vite en italien. Le fascisme se forge dans le creuset de l’interventionnisme (1914-1915). Les faisceaux naissent à ce moment-là. Après la guerre, ils sont rejoints par des futuristes et des anarcho-syndicalistes. Tous aiment la guerre. Marinetti, chef de file des futuristes, écrit que « La guerre est la seule hygiène du monde. »
L’apologie de la violence par le fascisme commence, sous la plume de Mussolini, dans le Popolo d’Italia. « Les morts s’obstinent dans l’illusion de vivre » : la formule désigne les bourgeois. Il invente plus tard le mot « Tranchéocratie ».
Deux caricatures en disent long : l’une, antifasciste, montre la mort, qui tient le bébé du fascisme et le couche dans une mangeoire portant l’inscription « capitalisme ».
Une vignette du caricaturiste fasciste Pironi montre les morts sortant des tranchées et les combattants fascistes prenant leur relais.
Lors de la paix, l’Italie n’obtient pas tout ce qu’elle espérait, d’où la thèse de la « victoire mutilée ».
La guerre contribue à codifier le rapport du fascisme à la violence. Les Arditi sont des bataillons d’assaut, formés après le désastre de Caporetto. Tous les arditi ne passeront pas au fascisme (les Arditi del Popolo se démarquent).
Les socialistes étaient restés dans le camp de la neutralité. D’où le fait qu’ils sont combattus à double titre, en tant que socialistes et en tant que traîtres.
Autre conséquence de la guerre : l’épisode de Fiume, en Istrie, que l’Italie espérait annexer en raison de la présence d’une forte colonie italienne. Gabriele D’Annunzio, un écrivain très célèbre, organise une marche sur la ville avec des arditi. Il fonde un micro-Etat qui est un laboratoire du fascisme. Alceste De Ambris, qui deviendra antifasciste, rédige la constitution, avec une réelle dimension sociale. C’est un premier grand moment d’exaltation des foules et de communion entre la foule et un leader.
En ce moment une exposition à Trieste est consacrée à l’épisode et à D’Annunzio. Elle ne restitue de l’affaire de Fiume que la face positive, elle est totalement apologétique et gomme la responsabilité de l’écrivain dans l’arrivée du fascisme.
Mussolini garde ses distances à l’égard de l’épisode. Il voit dans D’Annunzio un rival.
Il n’y a pas de révolution, et pas même de tentative, pendant le Biennio nero qui précède la marche sur Rome. Il y avait seulement des aspirations révolutionnaires de gauche, exprimées notamment dans le journal Ordine Nuovo d’Antonio Gramsci. Ce qui a existé, cependant c’est le fantasme d’une révolution empêchée, conduisant notamment aux agressions contre les locaux du mouvement ouvrier, les usines occupées ou les occupations de terres, agressions bien décrites par Angelo Tasca dans Naissance du fascisme.
La violence a joué un rôle décisif, mais en amont. Le fascisme a réussi à donner crédit à l’idée que, grâce à lui, l’ordre régnerait. L’acmé de la violence survient au printemps 1921.
De nouvelles recherches seront nécessaires pour appréhender cette violence dans une démarche anthropologique.
Les expéditions punitives s’accompagnent d’une propagande. L’exposition de la violence compte autant que son résultat. On oblige les militants de gauche à défiler avec des pancartes humiliantes, on les oblige à avaler de l’huile de ricin, on popularise le manganello (gourdin), devenu l’arme fasciste par excellence. C’est parfois un simple bâton mais il peut être aussi très sophistiqué. L’arme à feu, moins mise en évidence, cause en fait plus de décès, mais sa valeur symbolique est moindre.
Parmi les moyens de la violence figure aussi le feu.
L’Avanti, le journal socialiste, est agressé le 15 avril 1921, il y a des morts.
Les expéditions punitives peuvent être massives, ou consister simplement en un tabassage par deux ou trois militants fascistes.
On installe l’idée que le fascisme est invincible.
Les forces de l’ordre s’opposent rarement : il y a des complicités dans l’armée et la police.
Le principal apport du livre de Giulia Albanese : les rumeurs et rêves de coup d’Etat, notamment pendant le Biennio rosso (1919-1920), habituent la classe dirigeante à l’idée d’une violation de la constitution pour rétablir l’ordre.
La peur, notamment du communisme, est un des deux facteurs décisifs, l’autre étant la division des forces de gauche.
Il y a donc un vide politique, que le fascisme viendra combler.
On me demande souvent si nous sommes à la veille d’un nouveau fascisme. Le refus de la violence semble bien ancré, mais la peur et le vide politique ne sont pas absents.
Conférence suivie par François Delpla