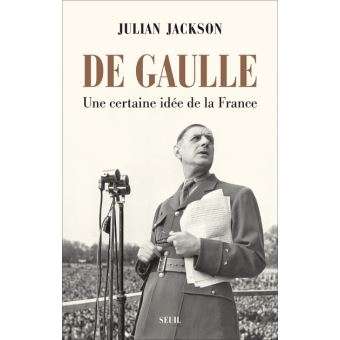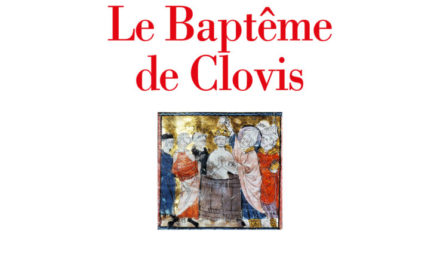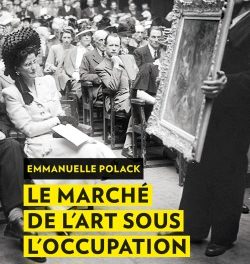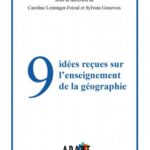Dans le salon de la préfecture, samedi, de 11h à midi, Oliver Wieviorka présente brièvement le plus français des historiens britanniques -une proximité rehaussée par le tutoiement. C’est aussi le premier universitaire (en poste à la Queens Mary University de Londres) qui ait écrit une biographie du fondateur de la Cinquième République française.
L’auteur, dans un français impeccable, commence en effet par faire remarquer que ses trois principaux prédécesseurs, Jean Lacouture, Paul-Marie de La Gorce et Eric Roussel, sont des journalistes, avant de s’étendre un peu sur le premier et le troisième, en les opposant. Biographe prolifique, Lacouture, qui a interrogé force témoins, entre dans la peau de ses personnages mais les tire un peu à lui (il a « tendance à lacouturiser tous ses sujets » !), en sorte qu’on a l’impression de lire toujours le même livre ; son de Gaulle est, d’autre part, un peu trop profondément et continuellement républicain, alors que son respect pour la forme républicaine du gouvernement tenait plutôt à son pragmatisme. Roussel, lui, le premier à travailler sur des archives étrangères, garde ses distances, mais trop, dans un « discret parfum d’antigaullisme ». Lui-même, Julian Jackson, n’étant pas français, ne se sent pas obligé d’entrer dans les querelles hexagonales et de se dire «gaulliste ou anti».
Il est le premier biographe à exploiter les archives de la France libre, déjà visitées cependant par Jean-Luc Barré pour son Devenir de Gaulle, et celles de la présidence du Général, ouvertes depuis cinq ans. Quant aux importants fonds laissés par Michel Debré, son premier ministre de 1958 à 1961, ils n’avaient jusqu’ici irrigué que quelques colloques sur Debré. Les journaux de Peyrefitte et de Foccart sont aussi des « sources magnifiques ». Cependant, « on n’arrive jamais au bout de De Gaulle et quand enfin on croit y être on s’aperçoit qu’il est trois ou quatre pas devant. »
Peu à l’aise, dans sa jeunesse, avec son grand corps, il est arrivé peu à peu « à l’apprivoiser et à l’utiliser ». Il était à l’aise avec les foules plus qu’avec les individus. Il n’avait pas besoin d’être aimé, contrairement à Chirac. Sa carapace d’intransigeance lui donnait énormément de force.
Churchill l’accueille, le 17 juin 1940, en pensant qu’il va pouvoir le manœuvrer. Il n’aurait jamais imaginé qu’il allait lui tenir tête. De son contact humain difficile il se fait une force. Il conseille un jour à Pierre Billotte : dans la négociation, commencer toujours par dire non. Cette rugosité de contact ne l’a pas servi pendant la guerre d’Algérie.
« Était-il visionnaire ? », demande le présentateur.
Cela dépend des sujets. Le 18 juin, il analyse bien la situation. Pendant sa présidence, il s’efforce toujours de penser l’après-guerre froide, estimant que le communisme ne durera pas. Il prévoit l’éclatement de la Yougoslavie et ne donne pas cher de l’unité de l’Irak. Pétri par l’histoire, il voit tout dans une perspective historique. Mais il n’est pas visionnaire en matière de décolonisation, il est très long à comprendre ce qui se passe. S’il avait été encore au pouvoir, il aurait déclenché la guerre d’Indochine.
Mais même quand il n’est pas visionnaire, il est toujours pragmatique : il sait écouter, absorber, quitter des positions impossibles. Cette capacité d’écoute est l’un des apports du livre. Beaucoup de gens ont espéré se servir de lui, en vain. En 1958, il écoute, sur la question algérienne Paul Delouvrier pendant une heure et demie sans prendre de notes et semble parfois s’endormir, mais en fait il a tout retenu.
« Quid des institutions ? »
Maurrassien pour les uns, très libéral pour les autres, il n’est pas démocrate au sens où -autre découverte du livre- il est très influencé par Gustave Le Bon. En témoigne le Fil de l’épée, où il dit qu’on ne mène les foules que par des sentiments élémentaires. « Le peuple veut être pris, mais refuse de se donner », dit-il à Claude Mauriac en 1944. Il réussit à réconcilier la gauche avec l’Etat et la droite aves la démocratie. Ce n’est pas un républicain à la Herriot ou à la Blum, il a créé une autre version de la République, en 1962 plutôt qu’en 1958. L’expression « monarchie républicaine » est appropriée. En 1958, Debré avait en tête une constitution à l’anglaise. Un livre américain récent parle d’un « charisme constitutionnalisé », à propos de De Gaulle, Khomeiny et Walesa (Bruce Ackerman, Revolutionary Constitutions / Charismatic Leadership and the Rule of Law, Harvard University Press, 2019). Par l’élection présidentielle au suffrage universel, il crée pour ses successeurs une légitimité.
« Quel est le bilan du président ? »
Quand Cyril Sulzberger lui pose la question en 1964, il répond que l’histoire seule peut décider du succès et de l’échec. Car l’un contient les germes de l’autre, et réciproquement. C’est du Bergson !
Ses deux grandes réussites ont consisté 1 ) pendant la guerre, à assurer la place de la France parmi les vainqueurs à force d’habileté et de rugosité, et 2 ) à doter le pays d’institutions consensuelles. L’émoi au lendemain de la mort de Chirac symbolise bien cette adhésion.
Le grand échec concerne l’Algérie, une affaire « pas très bien menée », un gâchis.
« Et l’économie ? »
Il a eu beaucoup de chance : en 1958 on est pendant les Trente glorieuses et en plein démarrage économique de la France. Il a profité, sur ce plan, des réussites de la Quatrième. Une partie de lui voulait le Plan mais il était aussi proche du très libéral Jacques Rueff et avait la hantise de l’inflation.
« On le crédite en général d’une politique extérieure efficace. Le livre est, sur ce point, dévastateur : il n’arrive pas à atteindre ses objectifs. Quelles sont selon toi les parts respectives de l’efficacité et de la gesticulation ? »
Je ne savais pas être dévastateur !
Il adorait provoquer et le faisait souvent. Il pensait toujours pour l’avenir, et posait des jalons. Il serait trop facile de le traiter d’anti-américain : les Etats n’ont pas d’amis.
A propos d’Israël, il a produit une remarquable analyse sur les territoires occupés.
En politique extérieure, personne ne réussit. Enoch Powell, le politicien anglais très à droite, disait que toute carrière politique se terminait en échec. Cela rejoint le pessimisme de De Gaulle.
Il dit à Foccart en 1967 : « Nous sommes sur un théâtre où je fais illusion depuis 1940. La France est avachie. Après moi, tout cela retombera. »
Cependant, le « non » chiraquien sur l’Irak est une réussite d’outre-tombe.
Questions de la salle :
« Vive le Québec libre » ?
Il avait le sentiment que son temps était compté.
« Résistance et Cinquième République ? »
Quelquefois, son intransigeance londonienne n’était pas nécessaire. Il développait, vis-à-vis des ambitions anglaises au Moyen-Orient, une paranoïa ridicule, enracinée dans la période où lui-même était en poste au Liban.
« Que pensez-vous du film intitulé Darkest Hour ? Ne rapproche-t-il pas Churchill de De Gaulle en montrant sa solitude dans son propre pays en mai-juin 1940 ? »
Beaucoup de mal, le film a nourri l’idée du Brexit.
L’idée de deux solitudes est intéressante… mais ne marche pas.
« Et 1968 ? »
Le vieil homme est dépassé.
Mon interprétation de la fuite à Baden Baden : il veut échapper à Pompidou, qui gère tout avec efficacité. C’est une façon de se montrer, plutôt que de se cacher.
« Que pensez-vous du livre de François Kersaudy sur de Gaulle et Churchill ? »
Un chef d’œuvre, mais même lors de ses colères les plus homériques Churchill savait bien que son gouvernement l’empêcherait de rompre.
Conférence suivie par François Delpla