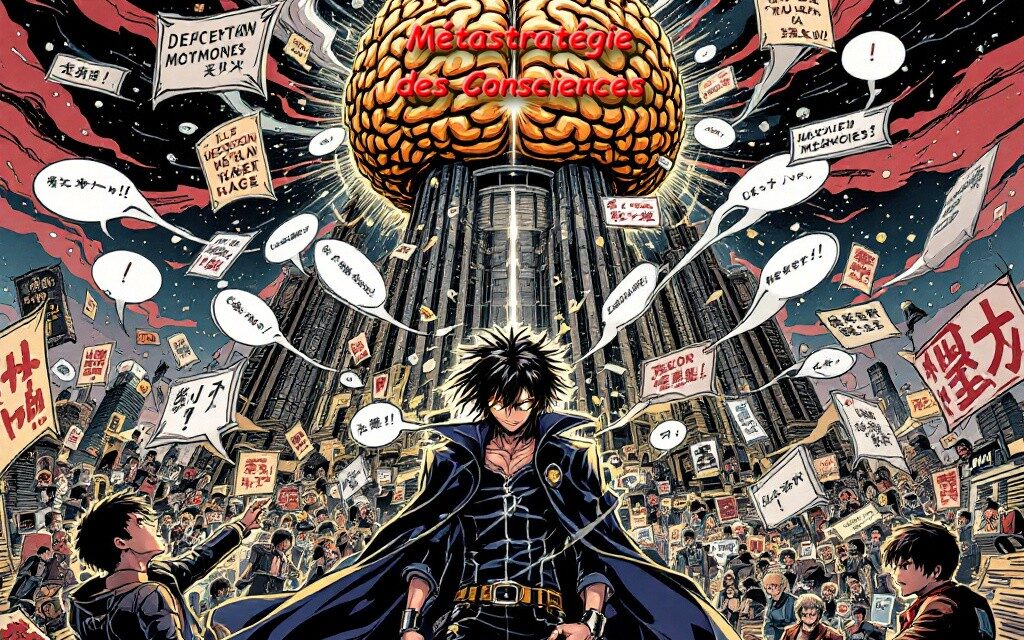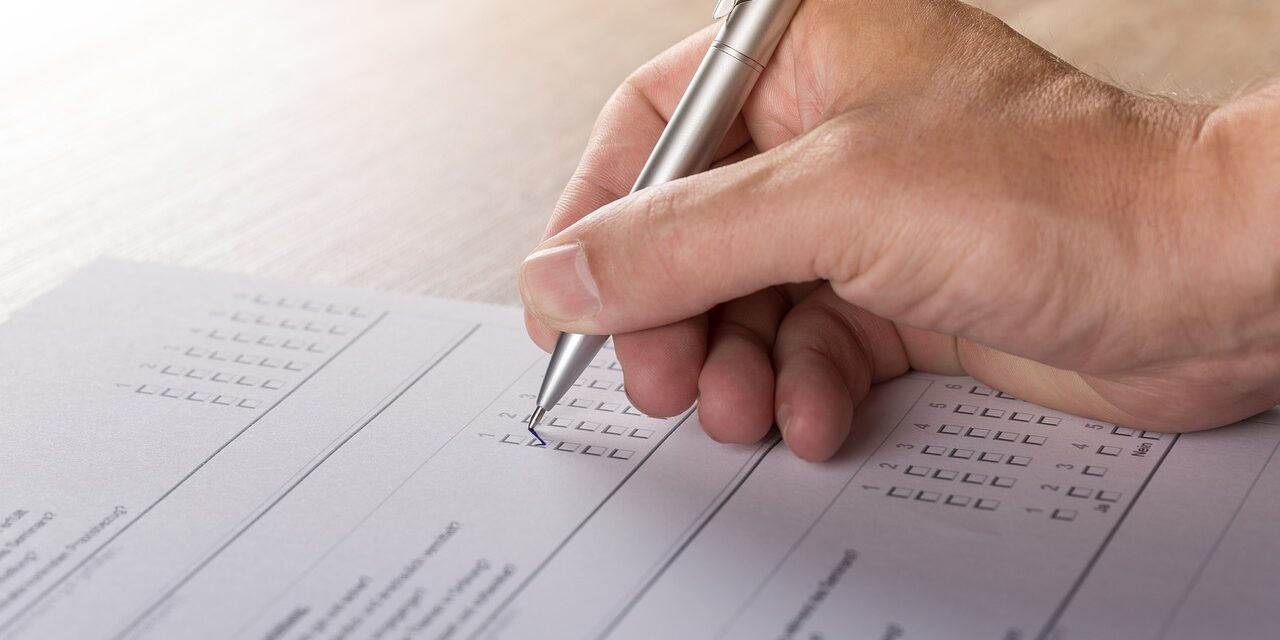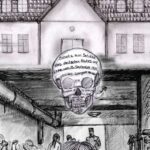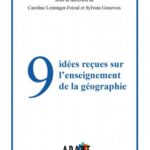Guerre cognitive et Pop culture. La guerre cognitive ouvre-t-elle des portes vers d’autres mondes ? Dans le multivers de Michael Moorcock, le champion éternel navigue entre les réalités, pris dans l’éternel conflit entre l’Ordre et le Chaos. Elric de Melniboné, dernier empereur d’une civilisation décadente, manipulé tant par les seigneurs du Chaos que par sa propre épée démoniaque Stormbringer, incarne parfaitement cette lutte cosmique où les perceptions et les consciences sont les véritables champs de bataille.
« Tous les héros sont des aspects d’une même personne, tout comme les vilains. Tous les dieux sont un seul dieu. Tous les démons sont un seul démon, » nous dit Moorcock dans La Reine des épées, second tome des chroniques de Corum. Cette vision d’une réalité fragmentée mais interconnectée résonne étrangement avec notre époque où les conflits se déplacent vers les territoires invisibles de l’esprit.
La malédiction d’Elric, condamné à se nourrir des âmes que dévore son épée noire pour maintenir sa propre existence, n’est-elle pas une métaphore saisissante de ce que nous nommons aujourd’hui la « guerre cognitive » ? Un paradigme où les consciences sont à la fois le terrain, l’enjeu et l’arme du conflit, où l’affrontement ne vise plus la destruction physique mais la reconfiguration des perceptions.
Si la guerre cognitive représente ce « sixième domaine opérationnel » après la terre, la mer, l’air, l’espace et le cyberespace, alors les récits du champion éternel de Moorcock, dans sa lutte perpétuelle pour maintenir l’équilibre cosmique, peuvent offrir une grille de lecture inattendue mais féconde pour comprendre ces nouveaux territoires de conflit où, comme pour Elric manipulé par les forces qui le dépassent, nos consciences deviennent le théâtre d’opérations stratégiques invisibles.
La guerre cognitive constitue un paradigme émergent dans les conflits contemporains. Bernard Claverie, directeur de l’École Nationale Supérieure de Cognitique, en a proposé une analyse fort stimulanteBernard Claverie. “Cognitive Warfare” – Une guerre invisible qui s’attaque à notre pensée. Jean François Trinquecoste. Faut-il s’Inquiéter ?, Éditions de l’IAPTSEM, pp.89-115, 2024, ISBN 978 2487 388000. ffhal-04586061.
L’OTAN s’est emparée de la question au point d’y consacrer des ressources pour non seulement comprendre les mécanismes en jeu, mais développer une réelle résilience, à tous les niveaux.
La Red Team défense, dans le cadre des réflexions alliant militaires et auteurs de Science Fiction pour travailler sur des scenarios prospectifs, a délivré en juillet 2021 un travail passionnant sur le sujet, mais aussi glacial.
Définition et mise en perspective de la guerre cognitive
La guerre cognitive représente donc le « sixième domaine opérationnel ». Bernard Claverie la définit comme « l’utilisation de capacités cognitives humaines comme terrain de guerre, visant à altérer non seulement ce que les gens pensent, mais comment ils pensent ».
L’OTAN, notamment à travers son Innovation Hub, a formalisé ce concept en identifiant le cerveau humain comme « le champ de bataille du 21e siècle ». Le rapport « Cognitive Warfare » publié par l’OTAN souligne que cette forme de guerre vise explicitement les processus cognitifs individuels et collectifs.
Caractéristiques principales
La « guerre cognitive » peut se distinguer de diverses manières. De façon schématique voici ce qui pourrait la caractériser au mieux :
- L’exploitation des biais cognitifs et des vulnérabilités psychologiques
- L’utilisation des neurosciences et des technologies cognitives
- La manipulation de l’information pour déstabiliser les perceptions
- L’objectif d’influencer la prise de décision et le comportement des populations et des décideurs
- L’absence de frontières claires entre temps de paix et temps de guerre
De la même façon les opérations de guerre cognitive emploient diverses approches. Elles utilisent la désinformation massive et ciblée, la manipulation narrative à travers les médias sociaux, l’utilisation d’intelligence artificielle pour personnaliser les messages, la surcharge informationnelle pour épuiser les capacités cognitives et enfin l’exploitation des divisions sociales préexistantes dans un espace donné. Agir sur le cerveau pour obtenir un avantage décisif, parfois avant même la confrontation armée, dans la droite ligne des pensées de Sun Tzu : gagner la guerre sans avoir à la mener ou « Gagner toutes vos batailles n’est pas la meilleure chose ; l’excellence suprême consiste à gagner sans combattre ».
Quelles implications stratégiques ?
Selon ces travaux, la « guerre cognitive » présente des potentialités majeures :
- Elle transforme les populations civiles en cibles directes
- Elle brouille la distinction entre combattants et non-combattants
- Elle opère en continu, sans déclaration formelle d’hostilités
- Elle peut compromettre la cohésion sociale et la confiance dans les institutions
- Elle peut affaiblir une nation sans confrontation militaire directe
Le problème est que l’expression soulève des questions essentielles. D’ailleurs Bernard Claverie souligne dans l’article précédemment cité que :
« Cette pratique est aujourd’hui à la base de toute préparation d’action armée et du soutien à l’action kinétique des états belliqueux et de ceux qui veulent se prémunir. Ainsi, elle agit aussi en temps de paix, pour un suprémacisme masqué ou pour préparer les populations attaquées à leur future défaite et à leur soumission. On cherche des parades pour protéger ses propres acteurs et populations ; en ce sens, il s’agit d’une problématique de défense globale, à la fois militaire et civile, à l’endroit et au temps des conflits mais aussi ailleurs, voire partout où la menace peut se concrétiser. On en retrouve la doctrine sous différentes appellations selon les pays ou les disciplines qui l’abordent : « cognitive warfare », « cognitive dominance », « cognitive superiority », « cognitive control », « réflexive control », « influence cyber-psychologique », « human cyberdefence », « maskirovka numérique », « ingénierie psychosociale orientée », « neuro-technologies », etc. Peu importe le mot, le but est toujours le même : l’altération cognitive quel qu’en soit le niveau de l’atteinte et quels qu’en soient le nombre et le niveau d’organisation des cibles ou des personnes à défendre et protéger ».
Aucune de ces approches ne me convient totalement car elles se réduisent pour l’essentiel au champ militaire. Or je crois qu’il est possible, nécessaire, d’aller plus loin. Je me propose ainsi dans cet article d’explorer cette altération cognitive en essayant de proposer une problématique permettant d’exploiter la Pop Culture dans cette perspective. Dis ainsi, je conviens que l’approche puisse être surprenante. Mais surprendre c’est déjà prendre le pas sur l’autre, un peu, si je puis oser, dans une logique de « dialectique des intelligences » chère à Hervé Coutau-Bégarie lorsqu’il définit la stratégie dans son remarquable traité de Stratégie. … Ceci s’inscrit dans une réflexion de long court que je compte bien poursuivre.
Je proposerai donc dans un premier temps de discuter de l’emploi du mot « guerre ». Guerre contre la pauvreté sous la houlette du président JohnsonLa « guerre à la pauvreté », cinquante ans plus tard, le Monde, 30 janvier 2014, contre le Covid par le président Macron, contre l’illettrisme, la grippe, les écrans, la drogue, de l’information … on ne compte plus le nombre de fois où la guerre est déclarée. Au point que le mot ne fasse plus sens. Il faudra donc reprendre quelques bases auprès de Clausewitz pour remettre les choses à leur place.
Ceci posé, j’explorerai une alternative à cette « guerre cognitive », afin de préparer le terrain à mon idée centrale : exploiter la Pop Culture comme champ de recherche, de réflexion, dans la reconfiguration des consciences contemporaines. Puissent les quelques approches proposées trouver quelques intérêts.
***
I – La guerre cognitive : une contradiction dans les termes ?
La violence comme essence de la guerre selon Clausewitz
Pour Clausewitz, dès le Livre I, la guerre est intrinsèquement liée à la violence physique, au sang. Elle implique en effet un affrontement direct, un rapport de force matériel, un risque de destruction physique, l’engagement des corps et des moyens militaires. Elle peut, au moment de la Révolution française qu’il connait, se rapprocher de son caractère « absolu ».
Si l’on pousse un peu plus loin l’analyse, voici ce que nous pouvons avancer. Tout d’abord la formule « la guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens », qui résume bien trop souvent sa pensée, au point de la caricaturer, signifie que la guerre n’est pas un acte isolé, mais une extension rationnelle de la politique nationale, un instrument de la raison d’État.
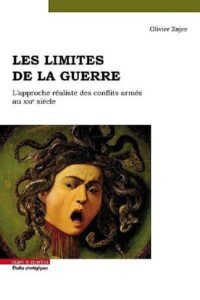
Le concept de guerre absolue, considéré sous cet angle, me semble être le gorgonéion de Vom Kriege : point vers lequel convergeraient toutes les lignes (ou les regards), il assumerait un rôle fonctionnel dans la pensée clausewitzienne, envisagée comme une pédagogie ‘Sumida 2001). Et ce serait la prise de conscience latente de la possibilité de cette guerre absolue, fût-ce sous la forme d’un « cas-limite », qui engendrerait chez les duellistes le besoin de négocier.
Ainsi dans la réalité concrète, la guerre est toujours limitée par des considérations politiques, des contraintes matérielles et des facteurs psychologiques, finissant par une négociation entre les personnes en fonction. Dans un cas extrême la négociation peut tourner court comme pour une capitulation mais la guerre cesse. Le but de la guerre n’est pas l’annihilation même si la violence en est le chemin, mais bel et bien d’arriver en position de supériorité, afin que la victoire militaire puisse, éventuellement, se transformer en victoire politique. Ce qui ne va pas de soit, l’Irak et l’Afghanistan l’ont montré depuis 2001.
Dans tous les cas, le terme ne semble pas très opportun pour une grille de lecture de la Pop Culture … À moins de s’engager dans une analyse fine des guerres dans Star Wars ou l’Univers de Dune, mais ceci est une autre histoireSi vous ne pouvez attendre, je conseille vivement de vous plonger dans les analyses de Michel Goya sur le sujet, et notamment cet article : L’art de la guerre dans Dune, disponible sur le site « C’est plus que de la SF ».. Nous y reviendrons le moment opportun.
La trinité paradoxale de la guerre
Clausewitz propose également une trinité remarquable qui caractérise la nature complexe de la guerre dès son Livre I. Il est possible de présenter ainsi cette « étonnante trinité » (je fais le choix de la liste pour rendre le propos plus clair) :
- La violence primaire :
- Haine, brutalité, passion populaire
- Dimension émotionnelle et irrationnelle
- Le jeu probabiliste, le hasard :
- Calcul stratégique
- Probabilités, risques, manœuvres
- Rationalité technique
- L’élément politique, sa rationalité :
- Raison d’État
- Objectifs politiques
- Dimension instrumentale
Cette trinité montre que la guerre n’est ni purement rationnelle, ni totalement irrationnelle, mais un phénomène complexe où s’entremêlent passion, probabilité et intention politique. Dans ce sens elle est non-linéaire parce mue par des interactions multiples, permanentes, comme l’a admirablement abordé l’historien Alan Beyerchen dans un article à méditerClausewitz: Non Linéarité et Imprévisibilité de la Guerre.
Quels effets pour la guerre cognitive ?
Si nous partons des travaux de Clausewitz, l’expression « guerre cognitive » soulève donc plusieurs contradictions fondamentales :
- Absence de violence physique
- Pas de confrontation corporelle
- Pas de risque de mort immédiate
- Manipulation par l’information et les représentations
- Remise en cause de la définition clausewitzienne
- La politique n’est plus continuée par des moyens physiques
- Transformation de l’affrontement en influence
- Substitution de la contrainte par la persuasion
- Dilution des frontières
- Brouillage entre guerre et communication
- Effacement de la distinction entre conflit et influence
- Perte de la dimension rationnelle et calculée de la guerre
Moment de respiration entre deux mondes
Le terme guerre possède une forte dimension mobilisatrice mais tend à simplifier des phénomènes complexes en les réduisant à une logique binaire d’affrontement entre entités clairement identifiées. L’expression « guerre cognitive » apparaît donc à tout le moins comme un oxymore : elle décrit un conflit sans violence, une lutte sans affrontement physique, une confrontation sans risque corporel. Elle ne constitue pas une guerre au sens clausewitzien du terme, mais plutôt une forme sophistiquée de rapport de force informationnel, incluant un paradigme stratégique émergent, une transformation des modalités de confrontation et un déplacement des enjeux de pouvoir.
Le chemin semble complexe et nous nous enfonçons dans une forêt bien dense. Gageons que le terme de « cognitive » sera plus limpide à explorer. Avec un peu de chance nous y retrouverons l’un des avatars du champion éternel, Corum Jhaelen Irsei …
De la cognition
Dans la revue Hermès, Benoît Leblanc propose en 2018 l’approche suivante :
La cognition désigne les activités mentales qui mettent en jeu la perception, l’attention, le langage, la mémoire, le raisonnement ou encore la décision. Tous ces processus ont été mis en évidence de façon différenciée, pour sortir du paradigme behavioriste posé au début du xxe siècle. Celui-ci cherchait à qualifier des couples stimulus-réponses observables entre comportements et environnements sans avoir recours aux états internes du sujet, en retirant de la discussion tout ce qui a trait à la conscience et à l’introspection. Rompant avec le behaviorisme, le cognitivisme s’est ensuite développé à partir des années 1970, sans revenir aux notions d’états mentaux mais en ouvrant le champ aux fonctions et processus mentaux pour décrire les comportements humains. Tirant profit des travaux sur la cybernétique, l’étude de la cognition s’est alors organisée en interdiscipline, associant les sciences de l’homme et de la société (SHS), celles de la vie et du système nerveux (SDV) et celles de l’information et de la communication (STIC).
Partant de cette approche, nous pouvons retenir que l’adjectif « cognitive » associé à la guerre renvoie à l’ensemble des processus mentaux permettant l’acquisition de connaissances, le traitement de l’information, de façon globale la compréhension et, point essentiel pour notre étude, la transformation des représentations.
Il est temps de se plonger aux sources de notre questionnement : comment dépasser la « guerre cognitive » pour explorer la Pop Culture ?
***
II – Métastratégie des consciences
La notion de « guerre cognitive » représente donc moins un concept qu’un symptôme : celui de la mutation anthropologique contemporaine où les territoires de la puissance se déplacent des espaces géographiques vers les espaces mentaux, des confrontations physiques aux architectures de sens. Cette phrase pourrait tout à fait avoir été écrite par Thulsa Doom.
Points de convergence
La définition de la guerre cognitive proposée par Bernard Claverie comme « l’application des sciences cognitives au domaine de la guerre« , visant à « altérer ou détruire la pensée rationnelle, les processus et la vie cognitive normale » rejoint l’idée de l’émergence d’un nouveau champ de conflictualité ciblant directement les structures mentales et les processus de pensée. Cependant, si l’on désire explorer la richesse de la Pop Culture dans cette optique, nous sommes assez vite bridés.
Limitations conceptuelles
Plusieurs limitations conceptuelles peuvent en effet être identifiées :
- Perspective militarisée : risque de rester d’une logique clausewitzienne en transposant mécaniquement le concept de « guerre » à des phénomènes qui transcendent le cadre conflictuel traditionnel.
- Vision réductrice de la cognition : la cognition est principalement envisagée sous l’angle de la rationalité à altérer, négligeant les dimensions constructives et créatives des processus cognitifs, ce qui poserait problème dans l’analyse des œuvres de Pop Culture.
- Cadre limité : le maintien d’une séparation artificielle entre les champs « matériel« , « virtuel » et « cognitif » ne permet pas à mon sens d’aborder leur profonde interpénétration.
Si l’on se place du point de vue, plus large, de la guerre informationnelle / de l’information, nous nous retrouvons aussi avec des blocages, du moins des limitations. David Colon à travers ses divers travaux (voir par exemple l’excellent La guerre de l’information, les États à la conquête de nos esprits, Tallandier, 2023 ou encore, entre autres, son audition au sénat en décembre 2023 ou lors des RSMED 2024 à Toulon), cite le cas de Jiang Zemin qui, en 1993, alors président de la République populaire de Chine, a décrit une « guerre mondiale sans fumée » menée par les États-Unis. Cette expression renvoie selon le dirigeant à l’utilisation de l’information comme arme stratégique dans un conflit global où les outils numériques et médiatiques remplacent les armes traditionnelles. Notons dans un premier temps qu’il est bien question de conflit et non de guerre.
Cette « guerre de l’information » représente dans la logique de Jiang Zemin un déplacement du champ de bataille vers les systèmes d’information et les infrastructures de communication. Cette conception anticipe de fait la militarisation du cyberespace et le ciblage des architectures informationnelles comme préalable à toute action militaire conventionnelle. Elle s’inscrit également dans la tradition militaire chinoise qui valorise la victoire sans combat et l’affaiblissement préalable de l’adversaire.
David Colon a analysé avec brio les opérations d’influence et de désinformation contemporaines en soulignant leur dimension systémique et leur impact sur les démocraties. Sa conception de la guerre de l’information intègre davantage les dimensions psychologiques et les effets sur l’opinion publique, tout en conservant une perspective conflictuelle héritée des sciences politiques occidentales. Cependant pour notre approche liée à la Pop Culture, la grille perd en efficacité car elle présente plusieurs limitations significatives :
- Persistance du paradigme conflictuel : le terme « guerre » maintient l’analyse dans une logique d’affrontement et de confrontation directe. Il s’agit moins à mes yeux d’une « altération » que d’une « reconfiguration » des matrices perceptives.
- Focalisation sur l’information plutôt que sur la cognition : la guerre de l’information se concentre sur les contenus informationnels et leur circulation. Il faut s’intéresser plus fondamentalement aux architectures cognitives qui déterminent comment ces informations sont perçues, interprétées et intégrées dans des systèmes de signification.
- Vision instrumentale et linéaire : les approches héritées de Jiang Zemin conservent une dimension instrumentale où des acteurs identifiables déploient des stratégies pour atteindre des objectifs définis. Il manque une vision plus complexe des phénomènes d’émergence et de rétroaction.
- Absence de la dimension culturelle profonde : enfin bien que la guerre de l’information reconnaisse l’importance des perceptions, elle ne prend pas suffisamment en compte les soubassements culturels et mythologiques – donc la Pop Culture – qui structurent les consciences collectives.
Cheminement vers une redéfinition par la métastratégie des consciences
Dépassement de la logique guerrière
La « guerre cognitive » suppose une violence directe exercée contre l’esprit, alors que la métastratégie des consciences propose à mes yeux une approche plus nuancée, plus efficace :
De l’altération à la reconfiguration : plutôt qu’une simple destruction ou altération, il s’agit d’une transformation des matrices de perception et d’interprétation.
De l’affrontement à l’influence : la dimension conflictuelle cède le pas à une logique d’influence et de transformation systémique.
***
Proposition conceptuelle : la « Métastratégie des consciences »
Grilles de lectures stratégiques
Tour à tour Alexandre Svietchine, Hervé Coutau-Begarie ou encore Olivier Zajec ont nourri ce qui va suivre. Je renvoie aux différentes notes pour des références précises sur ces auteurs que j’ai déjà utilisés.
L’approche stratégique d’Alexandre SvietchineVoir l’analyse précieuse du spécialiste français de Svietchine, Benoist Bihan, dans Les Maîtres de la stratégie, sous la direction du général Benoît Durieux et d’Olivier Wierviorka, Seuil, Paris, 2025, p.83-106
Alexandre Svietchine, théoricien militaire soviétique des années 1920, a développé une pensée stratégique particulièrement originale et influente, bien que longtemps méconnue en Occident.
Svietchine n’emploie pas le terme de stratégie. Ses écrits brossent le tableau d’un terme qui dépasse largement le cadre strictement militaire et englobe l’ensemble des facteurs politiques, économiques et sociaux. Tout est dialectique, dialogue, échange. Mener une guerre ne peut s’entendre sans avoir préalablement réfléchi à des objectifs en adéquation avec les moyens disponibles et, tout aussi important, en prenant en compte les spécificités politiques et sociales des belligérants, les siennes et celles des adversaires.
Une des contributions pragmatiques de Svietchine est sa distinction entre deux formes fondamentales de stratégie :
- La stratégie d’anéantissement : vise la défaite rapide et décisive de l’adversaire par des batailles décisives, s’inspirant du modèle napoléonien et prussien
- La stratégie d’usure : privilégie une approche progressive, exploitant l’ensemble des ressources économiques, diplomatiques et militaires pour affaiblir l’adversaire sur la durée
Svietchine critique la fascination excessive pour la stratégie d’anéantissement, qu’il juge souvent inadaptée aux réalités géopolitiques et économiques modernes. L’auteur insiste sur la subordination nécessaire de la stratégie militaire aux objectifs politiques, aux moyens disponibles.
Une notion centrale chez Svietchine est l’importance de l’adaptabilité. Il rejette l’idée de formules stratégiques universelles et souligne que :
- Chaque guerre possède sa logique propre
- La stratégie doit s’adapter aux conditions spécifiques (géographiques, économiques, technologiques)
- Les dirigeants doivent éviter le dogmatisme stratégique
Cette approche dialectique offre à mes yeux un cadre théorique particulièrement fécond pour analyser les stratégies narratives et l’impact de la Pop Culture contemporaine. Sa distinction entre stratégie d’anéantissement et stratégie d’usure trouve un écho surprenant dans l’évolution des productions culturelles populaires.
D’un côté, certaines œuvres adoptent une logique d’anéantissement, cherchant l’impact immédiat et spectaculaire sur les consciences – pensons aux blockbusters hollywoodiens qui saturent l’espace cognitif par une surenchère d’effets visuels et narratifs. De l’autre, des productions plus subtiles déploient une véritable stratégie d’usure, s’infiltrant progressivement dans les imaginaires collectifs à travers des séries au long cours, des univers transmédiatiques ou des mythologies qui se déploient sur plusieurs décennies.
La critique svietchinienne du dogmatisme stratégique nous invite également à considérer la Pop Culture non comme un bloc monolithique, mais comme un archipel d’œuvres dont chacune déploie sa propre logique d’influence. Les États-Unis ne sont pas le Japon, qui n’est point la France ou le Mexique. Les franchises qui réussissent à reconfigurer durablement nos matrices perceptives sont précisément celles qui, à l’instar de ce que préconise Svietchine, s’adaptent constamment aux conditions spécifiques – technologiques, sociales, économiques – de leur réception.
Enfin, sa vision de la subordination nécessaire de la stratégie aux objectifs politiques nous permet d’interroger la finalité même des productions culturelles populaires : sont-elles de simples divertissements, ou constituent-elles les vecteurs d’une métastratégie plus vaste visant à reconfigurer nos modes de perception et d’interprétation du monde?
Dans cette perspective, l’analyse de la Pop Culture à l’aune des concepts svietchiniens nous révèle moins un champ de bataille qu’un espace de reconfiguration permanente des consciences, où l’efficacité stratégique se mesure moins à la violence de l’impact qu’à la profondeur et à la durabilité de la transformation.
Hervé Coutau-Bégarie

- Tactique : Art d’utiliser les forces dans l’engagement
- Stratégie : Art d’utiliser les engagements au service de la guerre
- Politique : Art d’utiliser la guerre au service de la politique
Il évoque implicitement un niveau supérieur où la stratégie elle-même devient objet de réflexion, où s’élaborent les conditions de possibilité de la pensée stratégique.
La hiérarchisation des niveaux stratégiques proposée par Hervé Coutau-Bégarie offre un prisme analytique éclairant pour décoder les mécanismes d’influence de la Pop Culture sur les consciences individuelles et collectives.
Au niveau tactique, les œuvres populaires déploient un arsenal de techniques narratives, visuelles et sonores pour captiver l’attention et susciter l’engagement émotionnel immédiat du public. Une scène de combat dans Game of Thrones, un dialogue percutant dans Breaking Bad ou une séquence ludique dans un jeu vidéo constituent autant d’engagements tactiques dans la bataille pour la conscience du spectateur.
Cette série illustre les concepts de territorialité criminelle et d’économies illicites transfrontalières, particulièrement pertinents dans l’analyse des zones grises géopolitiques. Le commerce de drogue entre les États-Unis et le Mexique permet d’analyser la porosité des frontières et les défaillances de l’État, offrant un cas d’étude sur les défis sécuritaires transnationaux. Mais ces personnages alimentent aussi des mèmes viraux sur les différents réseaux sociaux, s’insinuant profondément dans nos esprits !
Au niveau stratégique, ces moments tactiques s’articulent en systèmes cohérents – des saisons entières, des univers narratifs, des franchises – qui orchestrent leur déploiement au service d’une guerre plus vaste pour l’occupation des imaginaires. L’univers Marvel, par exemple, ne se contente pas d’aligner des scènes spectaculaires mais élabore une architecture narrative qui maximise l’emprise sur la conscience du spectateur à travers le temps et les différents médiums.
Au niveau politique, la Pop Culture devient un instrument au service d’objectifs qui la dépassent : promotion de valeurs, diffusion de visions du monde, légitimation de pratiques sociales ou politiques. La manière dont les séries américaines ont normalisé certaines pratiques antiterroristes après le 11 septembre illustre cette subordination de la guerre des récits à des finalités politiques plus larges.
Cette série incarne la construction des identités nationales à travers la culture populaire. Elle reflète l’anxiété post-11 septembre et normalise certaines pratiques controversées (torture, surveillance) au nom de la sécurité nationale. 24h Chrono permet d’analyser comment les récits médiatiques façonnent les perceptions des menaces géopolitiques et légitiment certaines politiques étrangères.
Mais c’est peut-être dans ce que Coutau-Bégarie évoque implicitement comme un niveau supérieur – la métastratégie – que l’analyse de la Pop Culture devient la plus féconde. À ce niveau, les productions culturelles populaires ne sont plus seulement des instruments, mais deviennent le lieu même où s’élaborent les conditions de possibilité de la pensée stratégique contemporaine. En façonnant nos cadres interprétatifs, nos horizons d’attente et nos modes de raisonnement, la Pop Culture configure la manière même dont nous concevons la stratégie.
La science-fiction, par exemple, n’est pas un simple divertissement mais un laboratoire où s’élaborent et se diffusent de nouveaux paradigmes stratégiques qui informeront ensuite la réflexion militaire, économique ou politique. Quand Black Mirror explore les implications de certaines technologies, elle ne décrit pas seulement des tactiques ou des stratégies, elle reconfigure les conditions mêmes de notre pensée stratégique face à l’innovation technologique.
La hiérarchie stratégique de Coutau-Bégarie nous révèle ainsi la Pop Culture non comme un simple champ d’application de stratégies élaborées ailleurs, mais comme le lieu privilégié où s’élaborent aujourd’hui les matrices cognitives qui détermineront notre conception même de ce qu’est une stratégie efficace dans le monde contemporain.
L’apport d’Olivier ZajecVoir, entre autres lectures, l’article paru dans DSI « Étudier la stratégie : quel cadre de réflexion ? », celui paru dans la revue Conflits « Stratégie militaire : vers la fin de l’hémiplégie doctrinale ? » ou encore La mesure de la force. Traité de stratégie de l’Ecole de guerre, écrit avec Martin Motte, Georges-Henri Soutou, Jérôme de Lespinois, Tallandier, 2022, en plus des Limites de la guerre déjà cité
Olivier Zajec enrichit cette réflexion en introduisant :
- La notion d’horizontalité stratégique : interconnexion des différents domaines (militaire, économique, culturel, informationnel)
- L’approche systémique : prise en compte des effets de rétroaction et d’émergence
- La complexité stratégique : dépassement des modèles linéaires et mécanistes
L’horizontalité stratégique permet de comprendre comment la Pop Culture ne fonctionne pas en vase clos mais s’interconnecte avec les domaines militaire, économique et informationnel. Ainsi, l’univers cinématographique Marvel n’est pas simplement un divertissement mais un carrefour où convergent des enjeux technologiques, économiques et sociopolitiques qui façonnent collectivement nos perceptions de la sécurité mondiale et de l’intervention. Ce n’est pas pour rien que ces franchises ont explosé après le 11 septembre 2001.
Dans une autre approche, pour quitter le biais américain, il est possible de prendre la mer avec Eiichirō Oda. Ainsi, One Piece n’est pas simplement un manga de divertissement mais un carrefour où convergent des enjeux de géopolitique (avec son monde fragmenté en nations aux intérêts divergents), d’économie (à travers les inégalités et la corruption du Gouvernement Mondial), et de pouvoir informationnel (via le contrôle des médias et la réécriture de l’histoire). Cette œuvre illustre parfaitement comment une création culturelle peut articuler des problématiques stratégiques complexes tout en influençant les perceptions de millions de lecteurs à travers le monde.
Cet anime présente un monde fragmenté en îles et nations sous la gouvernance du « Gouvernement Mondial », reflétant les dynamiques de pouvoir géopolitiques. Il explore les thèmes de l’impérialisme, de la piraterie moderne, des frontières contestées et de la souveraineté.
L’approche systémique révèle comment les productions culturelles génèrent des effets de rétroaction sur la société elle-même. Par exemple, si nous reprenons l’exemple de cette franchise, la manière dont 24 heures chrono a influencé les débats sur la torture démontre cette dynamique circulaire où la fiction reconfigure les attitudes réelles, qui à leur tour influencent de nouvelles productions culturelles.
Enfin, la complexité stratégique nous invite à dépasser les analyses simplistes de la Pop Culture pour reconnaître son caractère multidimensionnel et non-linéaire, ce qui nous permet de retrouver les approches mises en avant par Alan Beyerchen. Le succès mondial de Squid Game illustre cette complexité où s’entremêlent critique sociale, divertissement global et soft power culturel dans un système d’influences réciproques qui échappe aux modèles d’analyse traditionnels. De la même façon le phénomène mondial de Game of Thrones illustre cette complexité où s’entremêlent métaphores géopolitiques, divertissement global et réflexions sur le pouvoir dans un système d’influences réciproques qui échappe aux modèles d’analyse traditionnels.
Critique sociale et économique du capitalisme mondial, Squid Game illustre la manière dont les inégalités systémiques internationales créent des vulnérabilités exploitables. La série expose les disparités économiques résultant de la mondialisation et offre en quelque sorte une métaphore des relations de pouvoir dans le système international, où les nations les plus faibles sont soumises aux règles imposées par les puissances économiques.
En somme, les concepts d’Olivier Zajec nous permettent d’appréhender la Pop Culture non comme un simple miroir du monde mais comme un champ stratégique actif où se configurent les matrices perceptives et cognitives qui structurent notre rapport au monde contemporain.
Glissement vers la métastratégie
Le philosophe Jean Guitton est le père de ce néologismeJean Guitton, La pensée et la guerre, 1969, Paris, Desclée de Brouwer, 2017que nous allons reprendre pour dépasser la « guerre cognitive ». Dans le cheminement de la pensée stratégique, il apporte une dimension culturelle essentielle. La clé réside ici dans la recherche par les sociétés, dans leur mémoire, transmise sous toutes les formes possibles, y compris les mythes, les récits fictionnels, de motivations, de méthodes, d’acquis. En quelque sorte d’une détermination supplémentaire pour affronter les périls, l’incertitude du monde. Cette réflexion s’inscrit dans un contexte de guerre froide, sous le regard du feu nucléaire, de la colère de Gojira. Comment justifier l’utilisation d’une arme qui aboutirait à la destruction de l’humanité, du moins d’une grande partie d’entre elle ? Le philosophe répond que cet acte peut s’expliquer non pas tant par des finalités politiques (donc dans la droite ligne des analyses de Clausewitz qu’il critique) mais par une sorte d’obsession, de délire presque, nourrit par un substrat culturel profond.
Or, à notre époque – comme je le dirai à la fin de cet ouvrage – le problème du suicide passe du plan individuel au plan collectif : et, pour la première fois dans l’Histoire, l’espèce humaine prise dans son ensemble est librement capable de se détruire elle-même par un suicide réciproque. De sorte que sa survie ne tient pas d’un instinct de vie (l’instinct, ici, ne suffit plus pour vivre) mais à un acte de raison réciproque, à une persuasion profonde que la vie est bonne pour l’espèce, que le désespoir de l’un ne peut ni ne doit entraîner la mort de tous. Cet acte de libre raison, de confiance dans l’homme et dans l’existence, auquel est suspendue dans un proche avenir la continuation de notre espèce, est au fond un acte de pensée, de pensée portant sur les questions ultimes ; tranchons le mot : un acte métaphysique. C’est pourquoi j’ai cru devoir créer un mot neuf, celui de métastratégie, pour signifier que désormais l’acte stratégique devient aussi un acte philosophique. C’est l’audace de ce livre écrit par un civil. […]
Quelle idée se dégage de ces réflexions ? Celle-ci d’abord que la fonction de la pensée s’accroît dans l’usage même de la violence, qu’une révolution est en train de s’accomplir : que, pour approfondir le sens de ce qui se passe sous nos yeux, il faut dépasser les spécialités de la politique, du droit et de la morale, et de la guerre, de ces formes diverses de l’action-pensée, voir tout, – d’un seul regard et du plus simple regard.
Comment caractériser la phase présente des conflits armés ?
En disant que nous voyons coïncider le mythe et la réalité, c’est-à-dire : d’une part une forme neuve de la guerre, qui est une stratégie de type psychique, se proposant d’agir sur l’inconscient humain par des mythes ; et, d’autre part, une forme inédite de l’arme, qui est fondée sur les puissances de composition et de libération de la matière, laquelle diffère toto caelo de tout ce que l’on avait nommé arme depuis le silex, le fer et le feu. C’est cette coïncidence qui est improbable et remarquable. C’est l’ÉVÉNEMENT du siècle ! […]
Le concept de métastratégie me semble, dans cette perspective, porteur de réflexions fécondes.
Dans la conclusion du livre le philosophe expose plusieurs réflexions complémentaires sur la puissance de la propagande, sur l’art de créer des narratifs à même d’influencer les foules.
Car l’esprit est fait pour connaître ce qui est conforme à la raison et l’expérience de ce qui est vrai. On a beau dire qu’il n’est point sur de réussir. On n’en a pas moins d’utiliser les procédés massifs de propagande, c’est gâcher le trouble. Lorsque le zèle claque au vent, c’est parce qu’il y a quelque faille de confiance, quelque fissure, quelque inquiétude parce qu’il y a quelque inquiétude, dans un pays, la densité ne fait donc pas confondre, dans un pays, la densité de la propagande qui s’y répand avec l’intensité de l’énergie morale qui y correspond. J’oserais même dire que ces deux choses ont parfois chance d’être en raison inverse l’une et l’autre. [ …]
Le suffrage universel partout répandu, même dans les régimes de dictature, a rendu les peuples sensibles aux procédés de propagande. La presse quotidienne permet d’implanter des idées et des sentiments par un martèlement continu. Enfin la radio a le singulier privilège de supprimer l’obstacle jusqu’alors absolu des frontières : elle agit sur le cœur du peuple opposé.
La propagande commence par dissocier les forces adverses. Puis, au moment venu, intervient le coup de surprise. Surprise qui opère encore sur l’esprit, et qui est encore une action d’influence. L’armée se montre partout à la fois. Il s’agit d’une opération en quelque sorte chirurgicale avec anesthésie préalable.
La comparaison qui vient à la pensée est plus encore celle de la chute d’un arbre sous le travail du bûcheron. La propagande remplit l’office de la scie. Elle détruit l’équilibre et la structure de ce beau chêne, mais sans affecter les apparences. Et il suffira d’un coup aussi violent que brutal pour tout faire tomber. L’armée alors, aura son rôle, mais elle ne fera que cueillir le fruit. Guerre psychique, avant tout, conçue sur le type de la tactique révolutionnaire où le dernier coup ne fait que consommer ce qui a été longuement préparé dans le secret. […]
La propagande est bruyante et précipitée. Il faut qu’elle aboutisse tout de suite. Elle ne sait pas attendre. Elle agit sur les nerfs et non sur l’’âme. Elle ne vit que dans l’instant.
La force morale s’étend dans la durée. Elle se renouvelle d’elle-même et sans avoir besoin d’un secours étranger. Comme le dit notre beau mot d’endurance, elle sait supporter et attendre. Celui qui a le bon droit pour lui n’a plus peur de la longueur du temps.
La propagande agit sur les nerfs : elle propose des images ; elle ne se contente pas de les proposer, elle les assène ; à force de répéter, elle croit convaincre.
La force morale n’a pas besoin de ces truchements ; si on les emploie, elle se défie. Elle s’est édifiée sur des expériences nombreuses, certaines, et qui valent mieux que les paroles et les promesses. L’expérience nourrit : elle fait vivre dans l’espérance. La propagande est capable de mentir. Elle ment même toujours un peu. Elle ne s’occupe jamais que d’un côté.
Elle dissimule les autres. Elle cache les revers. Elle exagère les succès. En somme, elle fait vivre dans l’apparence.
La force morale n’a pas peur de voir les choses comme elles sont. Les voyant comme elles sont, elle les voit toutes à la fois. Le mal ne lui cache pas le bien. Ni l’ombre ne lui dissimule la lumière.
La propagande ne peut vivre que de succès. Elle ne supporte pas les revers. Elle s’exalte et elle s’abat.
La Pop Culture est plus puissante que la propagande. Le philosophe insiste dans ses lignes consacrées à d’Hilter :
Hilter avait le sentiment très net qu’il inventait, aidé par la pensée communiste, une nouvelle stratégie, qui n’est pas celle du corps mais celle des âmes : une stratégie psychique.
Écoutons encore ses confidences à Forster :
-Non, la stratégie ne varie pas ; en tout cas, pas du fait des découvertes techniques. C’est une erreur absolue. […]
Au contraire dans la guerre pratique. Celle-ci-ci a pour caractère de se faire avant la guerre, de vaincre invisiblement avant l’opération des corps d’armes par une opération sur le psychisme. Elle ne consiste pas à chercher la bataille, mais à faire l’économie de la bataille ce qui revient à dire (ce que Bonaparte n’avait pas discernée) que la vrai technique n’est pas celle d’Arcole ou de Rivoli, mais celle de Saint-Cloud et du 18 Brumaire.
Distillée dans le temps long, de façon plus subtile que les lourdeurs imposées par des régimes totalitaires que le philosophe a connu à son époque, la Pop Culture peut s’immiscer partout. De façon volontaire ? Parfois oui, et nous le montrerons, mais parfois, aussi, de façon complètement indirecte, comme le fruit des réflexions d’un auteur souhaitant divertir, mais vivant dans une époque qui le modèle.
Conclusion : une écologie des consciences
L’écologie des consciences propose donc une métaphore : penser les consciences comme des écosystèmes dynamiques et interconnectés.
Il est temps de passer par la case étymologie, ce qui ne fait jamais de mal, en s’arrêtant en 1866 avec biologiste allemand Ernst Haeckel, inventeur du mot :
- Oikos (οἶκος) : la maison, le lieu
- Logos : discours, raison
- Conscience : du latin « conscientia », connaissance partagée
Si nous reprenons l’approche pour notre métaphore, trois constats se dégagent. Tout d’abord une perspective systémique : les consciences sont abordées comme systèmes complexes, avec des interactions non linéaires et des dynamiques d’émergence.
Puis un paradigme relationnel qui permet le dépassement du sujet isolé, la notion de réseau, la circulation des affects, la porosité des frontières individuelles.
Enfin une modélisation dynamique des flux informationnels, leurs transformations continues, au service d’une résilience nourrie par une capacité d’adaptation.
Dans ce cadre il s’agit donc de l’art de configurer les architectures cognitives, les matrices perceptives et les cadres interprétatifs qui déterminent les conditions de possibilité de l’action stratégique dans le domaine des consciences individuelles et collectives. Elle opère à plusieurs niveaux : structuration des régimes narratifs et des conditions de la connaissance, configuration des systèmes de signes/symboles et de significations pour les infuser dans les consciences, organisation des systèmes de valeurs et de préférences pour s’adapter le cas échéant aux cibles et, enfin, projection et construction des horizons d’attente et des futurs possiblesVoir à ce sujet l’essai passionnant de Jérôme Clech, La prospective stratégique, Hermann, 2023.
La « métastratégie des consciences » repositionne dans cette perspective la problématique du conflit qui était suggérée avec le terme de guerre. Elle replace la puissance sur le terrain mouvant des significations, où la capacité stratégique se mesure à l’art de reconfigurer les matrices de perception et d’intelligibilité du réel.
Elle désigne alors l’ensemble des processus par lesquels des entités reconfigurent les matrices de perception, de compréhension et d’interprétation des acteurs, en vue de transformer leurs possibilités d’action et leurs horizons de sens.
***
Pause entre les mondes – Pertinence de termes alternatifs ?
Le terme « confrontation »
Ce terme, en lieu et place de celui de « guerre » offre plusieurs avantages conceptuels :
- Étymologiquement plus précis : du latin « confrontare » (mettre en présence, comparer), il désigne la mise en présence de positions, visions ou systèmes différents sans nécessairement impliquer une dimension destructive.
- Gradation d’intensité possible : la confrontation peut être de basse, moyenne ou haute intensité, permettant de nuancer l’analyse des interactions entre systèmes cognitifs.
- Dimension relationnelle : le terme met l’accent sur la relation et l’interaction plutôt que sur l’élimination de l’adversaire, s’alignant mieux avec l’approche écologique proposée.
- Compatibilité avec l’horizontalité stratégique : la notion de confrontation s’accommode de l’approche horizontale et systémique d’Olivier Zajec mentionnée plus tôt, permettant d’appréhender des dynamiques multidimensionnelles.
Le terme « conflit »
Ce dernier présente également des caractéristiques intéressantes :
- Étymologie révélatrice : du latin « conflictus » (choc, lutte, combat), il désigne un heurt, une opposition entre forces contraires, mais reste plus ouvert que « guerre » quant aux modalités de cette opposition.
- Tradition sociologique établie : les théories du conflit en sociologie (Simmel, Coser) ont montré que le conflit peut être productif et structurant pour les sociétés, dépassant une vision purement destructrice.
- Dimension intégrable : le conflit peut être intégré dans des systèmes plus larges sans les détruire, rejoignant la perspective écologique des consciences.
- Application à différentes échelles : le terme s’applique aussi bien aux conflits internes (cognitifs, psychologiques) qu’externes, permettant une analyse multi-niveaux.
Ainsi, dans le cadre spécifique de la métastratégie des consciences, le terme « confrontation » semble offrir les avantages les plus significatifs :
- Cohérence avec la métastratégie : la confrontation met l’accent sur la rencontre entre systèmes de signification et matrices perceptives différents, sans préjuger de l’issue destructrice que suggère la guerre.
- Compatibilité avec l’approche écologique : dans une écologie des consciences, différentes architectures cognitives se confrontent, s’influencent et se transforment mutuellement sans nécessairement s’éliminer, ce que le terme « confrontation » exprime adéquatement.
- Intégration de la dimension transformative : la confrontation peut aboutir à des synthèses, des hybridations ou des transformations mutuelles, correspondant à cette idée avancée dans le document que l’enjeu n’est pas l’altération mais la reconfiguration des matrices de perception.
- Flexibilité analytique : le terme permet d’englober aussi bien les dynamiques de soft power culturel que les opérations d’influence plus directes, sans les réduire à une logique guerrière.
Dans l’analyse de la pop culture comme champ métastratégique, le terme « confrontation » permet à mon sens de mieux saisir comment différentes productions culturelles confrontent les publics à des mondes alternatifs, des valeurs divergentes ou des futurs possibles. Cette confrontation ne vise pas à « détruire » des consciences mais à les transformer à travers l’exposition à des narratifs concurrents.
Par exemple, une analyse du Marvel Cinematic Universe comme construction d’un imaginaire géopolitique post-11 septembre relèverait davantage d’une confrontation entre différentes visions de la sécurité mondiale que d’une guerre au sens clausewitzien. Justement, il est temps de passer à la pratique …
***
III – Pop Culture et métastratégie des consciences : une cartographie des imaginaires contemporains
La Pop Culture comme champ métastratégique, entre géopolitique et écologie des consiences
La Pop Culture, souvent reléguée au rang de simple divertissement, constitue en réalité un terrain privilégié d’observation et d’application de la métastratégie des consciences.
Suivant les analyses de Jason Dittmer et Daniel Bos dans Popular Culture, Geopolitics, and Identity, que j’ai déjà eu l’occasion de présenter par ailleurs, nous pouvons essayer de déterminer ce qui est entendu par l’étude de la culture populaire comme espace d’action géopolitique. Les réflexions de Dittmer et Bos proposent que la culture populaire n’est pas simplement un divertissement mais un « espace d’action géopolitique ». Les auteurs illustrent cela par des exemples variés :
- Des séries comme « Homeland »
- Des films comme « Jack Ryan: Shadow Recruit »
- Les événements sportifs avec leurs rituels nationalistes
Ils montrent comment ces médias nourrissent les événements géopolitiques et façonnent notre identité nationale et notre vision du monde.
L’influence réciproque entre culture populaire et événements géopolitiques
Les auteurs utilisent l’exemple de l’attaque du 11 septembre 2001 et ses représentations dans la culture populaire selon un processus non linéaire :
- Comment des films antérieurs comme « Independence Day » ont fourni un langage pour parler des attaques
- Comment des films ultérieurs comme « The Avengers » ont réinterprété visuellement ces événements
- Comment l’univers cinématographique Marvel explore des thèmes géopolitiques post-11 septembre
Ils soulignent que cette relation est reconnue par le gouvernement américain, qui collabore avec l’industrie du divertissement et utilise même les bandes dessinées comme outil de diplomatie publique au Moyen-Orient.
La géopolitique populaire et ses mécanismes
Au cœur de leur réflexion les auteurs définissent la géopolitique populaire comme le discours géopolitique quotidien dans lequel les citoyens sont immergés. Ils explorent:
- Comment elle influence et est influencée par la politique étrangère
- Le rôle central des médias dans la formation des perceptions géopolitiques
- L’exemple des films anticommunistes pendant l’ère Reagan
- La dimension corporelle et vécue de la géopolitique populaire
- Le potentiel de transformation géopolitique par les actions individuelles
Les auteurs adoptent une approche constructiviste et critique qui met l’accent sur les discours et les représentations plutôt que sur les « vérités » géographiques objectives, s’intéresse aux relations de pouvoir sous-jacentes. Ils proposer d’examiner comment les identités nationales et géopolitiques sont construites socialement, reconnaissant le rôle actif des citoyens ordinaires dans la création et la transformation des réalités géopolitiques.
En synthétisant les différentes perspectives présentées dans cet essai, la définition de la géopolitique qui émerge est la suivante :
La géopolitique est une tradition de pensée et un mode d’analyse qui examine les relations entre le pouvoir, l’espace géographique et l’identité. Elle ne se limite pas aux actions des États ou aux théories des experts, mais englobe également les discours médiatiques et la culture populaire qui façonnent notre compréhension du monde et des relations internationales.
Cette définition est particulièrement pertinente dans le monde contemporain où l’information circule rapidement à travers divers médias et où la distinction entre politique étrangère « officielle » et perceptions populaires devient de plus en plus floue. Elle nous invite à considérer notre propre rôle dans la création et la transformation des réalités géopolitiques à travers notre consommation médiatique et nos actions quotidiennes.
Le dernier apport essentiel à notre exploration prend la forme du concept de « transmedia » abordé par les chercheurs.
Pour Dittmer et Bos, le « transmédiatique » désigne la manière dont les récits, les discours et les représentations circulent à travers différentes plateformes médiatiques, créant ainsi un écosystème narratif interconnecté (ce qui peut valider au passage notre métaphore de l’écologie des consciences). Cette approche va au-delà d’une simple adaptation d’un contenu d’un médium à un autre ; elle implique plutôt une expansion cohérente du contenu qui exploite les spécificités de chaque plateforme. La cohérence exploitant les spécificités, nous ne sommes plus très loin du plan …. De la stratégie.
Dans leur ouvrage Dittmer en particulier développe l’idée que les représentations géopolitiques se construisent et se diffusent à travers un réseau transmédiatique qui inclut la littérature, le cinéma, les jeux vidéo, les bandes dessinées et d’autres formes d’expression culturelle.
Ces analyses mettent en évidence plusieurs caractéristiques clés du transmédiatique :
- La complémentarité des médias : chaque plateforme apporte une contribution unique à l’ensemble narratif
- L’engagement actif du public qui navigue entre ces différentes plateformes
- La création d’un univers narratif cohérent mais distribué
- La dimension participative qui permet aux publics de contribuer à l’expansion de l’univers narratif
Très clairement ces réflexions peuvent vous aider pour comprendre comment les imaginaires géopolitiques contemporains se construisent et circulent dans notre société médiatisée.

Enfin la Pop Culture peut être explorée à partir des réflexions pragmatiques de Svietchine (et pourquoi pas y inclure une grille de lecture de l’art opératifVoir l’excellent livre de Benoist Bihan et Jean Lopez, Conduire la guerre, entretiens sur l’art opératif, Perrin, 2023), des niveaux stratégiques de Hervé Coutau-Begarie, des complexités explorées par Olivier Zajec, dès lors que nous entrons dans le champ de la stratégie, des rapports de pouvoir, de puissance.
***
Mise en relation de l’écologie des consciences et de la géopolitique critique
En examinant les deux approches théoriques présentées – la « métastratégie des consciences » (écologie des consciences) d’une part et la géopolitique incluant sa dimension populaire d’autre part – plusieurs points de convergence et de distinction émergent.
Quels points de convergence ?
Dépassement des cadres traditionnels : les deux approches transcendent les conceptions classiques de leurs domaines respectifs. L’écologie des consciences dépasse la notion clausewitzienne de guerre pour proposer « l’art de configurer les architectures cognitives », tandis que la géopolitique critique dépasse la vision stato-centrée pour intégrer les dimensions culturelles et médiatiques.
Importance accordée aux représentations : les deux approches placent au centre de leur analyse les imaginaires collectifs et les matrices perceptives. L’écologie des consciences s’intéresse à la « reconfiguration des matrices de perception » tandis que la géopolitique critique examine comment les discours « construisent notre perception du monde ».
Rôle central de la culture populaire : les deux approches identifient la pop culture comme un terrain d’opération majeur. Dans l’écologie des consciences, elle constitue « un laboratoire de métastratégie » configurant les cadres interprétatifs, tandis que dans la géopolitique critique, elle représente un niveau distinct (géopolitique populaire) façonnant notre compréhension des relations internationales.
En quoi ces approches divergent ?
Origine disciplinaire : l’écologie des consciences que je propose dérive des études stratégiques (Svietchine, Coutau-Bégarie, Zajec) et propose une alternative à la notion de « guerre cognitive », tandis que la géopolitique critique s’inscrit dans une tradition géographique et relationnelle.
Rapport au pouvoir : la métastratégie des consciences conserve une dimension instrumentale, visant à transformer les possibilités d’action des acteurs, alors que la géopolitique critique adopte une posture plus analytique qui se concentre davantage sur la compréhension des discours que sur leur manipulation.
Portée conceptuelle : l’écologie des consciences propose une vision plus englobante où les consciences sont considérées comme des écosystèmes dynamiques et interconnectés, tandis que la géopolitique critique, bien qu’élargie, reste ancrée dans l’étude des relations entre le pouvoir, l’espace géographique et l’identité.
Quelle approche est la plus pertinente ?
La question de la pertinence relative de ces deux approches dépend largement du contexte d’analyse et des objectifs poursuivis. Selon les sujets il sera possible de privilégier l’une ou l’autre approche, ou d’en exploiter la synergie.
Une approche synthétique pourrait ainsi s’avérer particulièrement féconde, où l’écologie des consciences fournirait un cadre métastratégique global tandis que la géopolitique critique apporterait des outils analytiques plus précis pour examiner les manifestations spécifiques de ces dynamiques dans les relations spatiales et identitaires.
La pertinence comparative dépend également de l’objet d’étude : l’écologie des consciences semble plus adaptée à l’analyse des transformations cognitives à l’ère numérique et des opérations d’influence contemporaines, tandis que la géopolitique critique offre un cadre plus solide pour comprendre comment les représentations spatiales et identitaires structurent les relations internationales.
Dans un monde où les frontières entre information, cognition et action stratégique s’estompent, ces deux approches apparaissent complémentaires plutôt qu’exclusives. Leur mise en dialogue permet, je crois, d’enrichir notre compréhension des dynamiques contemporaines où la reconfiguration des consciences et la construction des imaginaires géopolitiques s’entrecroisent constamment.
Ces analyses nous mènent, loin des tourments de Vecna, vers une problématique que j’espère fructueuse :
Comment la Pop Culture opère-t-elle comme un laboratoire de métastratégie des consciences, configurant les cadres interprétatifs, les horizons d’attente et les architectures cognitives qui structurent notre rapport au monde et aux conflits contemporains ?
Dans un premier temps voici des pistes de réflexions rapides servant à illustrer la richesse potentielle de ces approches. L’effet catalogue est assumé, il s’agit de jeter quelques pistes pour démontrer la richesse des possibles.
***
La Pop Culture comme écosystème sémiotique, ou la quête d’Oghma
La Pop Culture contemporaine constitue un véritable écosystème sémiotique où s’élaborent, circulent et se transforment les signes et les significations qui structurent notre rapport au monde. La référence à Oghma, puissante divinité de la connaissance et de l’écriture dans Donjons et dragons, évoque cette dimension fondamentalement cognitive et scripturale de la Pop Culture : elle est le lieu où s’écrivent et se réécrivent les récits qui configurent notre compréhension du monde.
La production des imaginaires géopolitiques
Les productions culturelles populaires ne se contentent pas de refléter des réalités géopolitiques préexistantes; elles participent activement à leur élaboration en configurant des cadres interprétatifs qui structurent notre compréhension des relations internationales et des enjeux de pouvoir.
Exemple : Marvel Cinematic Universe
Comme je l’avais suggéré plus tôt, l’univers cinématographique Marvel illustre parfaitement cette fonction métastratégique de la Pop Culture :
- Construction d’un imaginaire géopolitique post-11 septembre : le MCU traduit les anxiétés collectives nées des attentats du 11 septembre en un récit cohérent où la menace est à la fois extérieure (Thanos, Ultron) et intérieure (Hydra infiltrée au sein du S.H.I.E.L.D.), produisant une cartographie cognitive de la menace qui recode nos perceptions du terrorisme et de la sécurité globale.
- Reconfiguration du concept de sécurité et de menace : en déplaçant progressivement la menace de l’échelle nationale (Captain America) à l’échelle globale (Avengers) puis cosmique (Guardians of the Galaxy, Infinity War), le MCU participe à la reconfiguration cognitive de la menace et à l’extension illimitée du périmètre sécuritaire, légitimant indirectement l’expansion globale des dispositifs sécuritaires.
- Normalisation des interventions « super-héroïques » extra-juridiques : la figure du superhéros opérant en dehors des cadres légaux traditionnels (accords de Sokovia dans Civil War) normalise l’idée d’une action d’exception, tout en explorant les tensions entre sécurité et liberté à travers le conflit Iron Man/Captain America, offrant ainsi un laboratoire exploratoire pour penser les limites de l’état d’exception.
- Articulation entre sécurité nationale et responsabilité globale : le MCU met en scène la tension entre la protection des intérêts nationaux (posture de départ du S.H.I.E.L.D.) et la responsabilité planétaire (Avengers), reflétant et reconfigurant les débats sur la souveraineté et l’intervention humanitaire dans le monde contemporain.
Accords de Sokovia
La structuration des temporalités stratégiques
La Pop Culture ne se contente pas de représenter l’espace géopolitique, elle configure également notre rapport au temps stratégique, produisant des temporalités spécifiques qui structurent nos horizons d’attente et nos capacités d’anticipation.
Exemple : la science-fiction dystopique contemporaine
- Dune : au-delà de son aspect spectaculaire dans l’adaptation du roman de Frank Herbert par de Denis Villeneuve, Dune propose une temporalité stratégique expansive, articulant des projections millénaires (le plan multigénérationnel des Bene Gesserit) avec des enjeux immédiats de ressources et de pouvoir. Cette représentation de la longue durée stratégique reconfigure notre perception du temps politique habituellement confiné aux cycles électoraux courts.
- The Expanse : cette série, adaptée du roman des auteurs américains Daniel Abraham et Ty Frank (alias James S.A. Corey) reconfigure notre appréhension des temporalités géopolitiques en projetant les dynamiques de pouvoir actuelles dans un futur où l’humanité a colonisé le système solaire. L’oeuvre explore comment l’expansion spatiale transforme les calculs stratégiques et les identités politiques, offrant une métaphore des relations centre-périphérie et des dynamiques coloniales contemporaines.
Cette série illustre parfaitement les concepts de Dittmer et Boss sur la géopolitique populaire. Elle présente un système solaire colonisé divisé en trois factions (Terre, Mars, Ceinture) et explore les tensions géopolitiques découlant de ressources limitées, les inégalités structurelles et les luttes pour l’autonomie territoriale.
- Élaboration d’horizons d’attente catastrophistes: La récurrence des scénarios d’effondrement climatique, technologique ou social normalise l’idée d’un futur précaire, produisant des affects particuliers (anxiété, résignation, nostalgie anticipative) qui structurent notre rapport au temps politique et nos capacités d’action collective.
- Normalisation de futurs précaires et de la gouvernance par la crise: Ces récits contribuent à légitimer des formes de gouvernance exceptionnelle au nom de la gestion de crises permanentes, reconfigurant ainsi notre acceptation des mesures d’exception comme horizon normal de la gouvernance.
Mécanismes métastratégiques de la Pop Culture
La reconfiguration des paradigmes stratégiques
La Pop Culture ne reflète pas simplement la réalité géopolitique ; elle participe activement à sa transformation en influant sur les paradigmes à travers lesquels nous pensons la stratégie et la sécurité.
Exemple : 24 heures chrono et la normalisation de la torture
- Légitimation de l’exceptionnalisme sécuritaire : la série justifie systématiquement les violations des droits fondamentaux au nom de « l’urgence absolue », contribuant à normaliser l’idée que certaines menaces justifient l’abandon des principes démocratiques. Cette reconfiguration narrative prépare le terrain cognitif pour l’acceptation de politiques sécuritaires exceptionnelles.
- Diffusion du paradigme de « ticking bomb scenario » : en répétant le scénario de la « bombe à retardement » où la torture devient le seul moyen d’obtenir des informations critiques, la série naturalise ce dilemme moral artificiel, le transformant en cadre interprétatif dominant pour penser les arbitrages sécurité/droits humains.
- Impact documenté sur les attitudes publiques et professionnelles : des études ont montré l’influence de la série sur les perceptions publiques de la torture et, plus préoccupant encore, sur les attitudes de certains professionnels du renseignement, démontrant la capacité de la fiction à reconfigurer les pratiques professionnelles.
- Influence sur les débats juridiques et éthiques : enfin la série a infiltré le langage même des débats politiques sur la torture, avec des références explicites au « scénario Jack Bauer » dans les auditions du Congrès américain, illustrant comment une fiction peut coloniser le cadre interprétatif des délibérations politiquesVoir par exemple « La jurisprudence « Jack Bauer », par Christian Salmon ».
La production de nouvelles subjectivités stratégiques
La Pop Culture ne se contente pas de représenter des sujets stratégiques préexistants : elle participe activement à la configuration de nouvelles subjectivités, de nouvelles manières d’être et de se penser comme acteur stratégique.
Exemple : les jeux vidéo stratégiques et la conscience géopolitique
- Call of Duty et la militarisation de l’expérience ludique: la série normalise une vision militarisée des relations internationales où le recours à la force devient l’outil principal de résolution des conflits. Cette immersion répétée dans des scénarios de combat reconfigure la perception du rôle légitime de la force dans les relations internationales.
- Simulation de prise de décision stratégique : des jeux comme Civilization ou Age of Empires configurent une conception particulière de la rationalité stratégique, où le développement historique est réduit à des calculs de ressources et d’expansion territoriale, naturalisant une vision néo-réaliste des relations internationales.
- Formation d’une expertise tactique profane : ces jeux produisent une familiarité avec le vocabulaire, les concepts et les logiques militaires qui transforme les joueurs en « experts » profanes, capables de mobiliser ces cadres interprétatifs pour décoder les événements géopolitiques réels.
- Incorporation de schémas cognitifs stratégiques : l’exposition répétée à ces simulations implante des modèles mentaux qui structurent la perception des événements internationaux, créant une grille de lecture prédisposée à interpréter les conflits géopolitiques à travers des paradigmes spécifiques.
Vers une métastratégie consciente de la Pop Culture ?
Pour les acteurs stratégiques plusieurs questions peuvent se poser : nécessité d’une intelligence culturelle stratégique, reconnaissance de la Pop Culture comme terrain d’opération métastratégique et développement d’une expertise en écologie des imaginaires.
Les enjeux éthiques et politiques sont tout aussi centraux : tensions entre soft power culturel et manipulation des consciences, responsabilité des créateurs et des diffuseurs, éducation aux médias comme contre-stratégie.
***
La Pop Culture comme terrain métastratégique majeur
Loin d’être un simple reflet des réalités géopolitiques, la Pop Culture constitue donc, nous le croyons fermement, un domaine fondamental de configuration des matrices cognitives et perceptives qui déterminent notre rapport au monde stratégique. Elle opère comme un laboratoire où s’élaborent, se diffusent et s’incarnent les cadres interprétatifs qui structurent les possibilités d’action et de pensée stratégiques.
La métastratégie des consciences trouve ainsi dans la Pop Culture non seulement un objet d’étude privilégié, mais un terrain d’application concret, où les imaginaires collectifs se reconfigurent et où les subjectivités stratégiques se transforment, souvent à l’insu des publics eux-mêmes.
Là où la guerre cognitive vise à influencer la manière dont les individus prennent leurs décisions dans un contexte militaire, la Pop Culture, en particulier dans les sphères geek, produit une adhésion profonde aux univers qu’elle met en scène. Les dystopies cyberpunk, par exemple, inculquent un regard critique sur la surveillance de masse, tandis que les space operas inspirent des visions expansionnistes du progrès humain.
La question fondamentale devient alors : dans quelle mesure ces imaginaires, largement façonnés par des industries culturelles occidentales et asiatiques, participent-ils à un affrontement idéologique global ?
Guerre froide, lutte contre le terrorisme et divergence des grilles culturelles
L’histoire récente offre de multiples exemples où la Pop Culture a été un instrument de « guerre cognitive » dans le sens des travaux de Bernard Claverie, dans sa dimension militaire. Durant la Guerre froide, la culture populaire occidentale a joué un rôle clé dans la promotion du modèle capitaliste et démocratique face à l’idéologie soviétiqueVoir par exemple Frances Stonor Saunders, Qui mène la danse ? La CIA et la Guerre froide culturelle, Denoël, juin 2003. Des films comme Rocky IV, où le boxeur américain affronte un adversaire soviétique, ou Red Dawn, qui imagine une invasion des États-Unis par l’URSS, ont contribué à ancrer un narratif où l’Amérique se posait en dernier rempart contre l’oppression.
En parallèle, les récits de science-fiction dystopiques dans le bloc de l’Est exprimaient souvent des critiques voilées du régime.
Ces récits dystopiques avaient une particularité propre aux contextes dans lesquels ils ont été produits. Par exemple :
- Nous Autres (1924) de Ievgueni Zamiatine, considéré comme un précurseur décisif de 1984, illustre un État totalitaire où la surveillance et le conformisme sont omniprésents.
- L’Inassouvissement (1930) de Stanisław Ignacy Witkiewicz met en scène une société où une drogue annihile l’esprit critique, reflétant les stratégies d’endoctrinement.
- Solaris (1961) de Stanisław Lem interroge les limites de la connaissance humaine et du contrôle sur la réalité, une thématique récurrente dans les œuvres produites sous des régimes totalitaires.
- Pique-nique au bord du chemin (1972) des frères Strougatski, adapté par Tarkovski en Stalker, joue avec l’idée d’un pouvoir mystérieux qui échappe à l’entendement humain, métaphore du secret d’État et du contrôle de l’information.
Dans un autre contexte, après le 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme a engendré une nouvelle vague de récits justifiant des interventions militaires et la surveillance de masse. Des jeux comme Call of Duty: Modern Warfare ont mis en scène des conflits asymétriques inspirés des guerres en Irak et en Afghanistan, façonnant une vision du terrorisme comme menace omniprésente et légitimant certaines actions militaires au nom de la sécurité nationale.
Mais la réalité est bien plus féconde encore dès lorsque l’on prend le prisme de la métastratégie des consciences, visant à étudier la construction des imaginaires et leur influence sur notre façon de penser. Voici quelques œuvres posant cette question, selon une logique de « guerre cognitive » :
Inception et la manipulation de la pensée
L’exemple le plus évident est Inception (2010) de Christopher Nolan, qui illustre parfaitement l’idée que la manipulation la plus puissante ne consiste pas à imposer une idée, mais à planter une idée dans l’esprit de quelqu’un de manière à ce qu’il pense l’avoir eue lui-même.
C’est exactement ce que cherche à faire une attaque cognitive : influencer un individu ou une population pour qu’ils prennent leurs propres décisions contre leur intérêt, sans se rendre compte qu’ils ont été guidés.
La fantasy et le contrôle des esprits : Sauron et la désinformation
Dans Le Seigneur des Anneaux, Sauron ne se contente pas d’être une force brute, il excelle dans la manipulation mentale :
- Il altère la perception d’êtres comme Denethor, qui tombe dans le désespoir en croyant que toute résistance est inutile.
- Il divise ses ennemis, en jouant sur la peur et l’ambition (Saroumane, Boromir).
Comme dans une guerre cognitive, il ne cherche pas à combattre directement, mais à déstabiliser mentalement ses adversaires pour les amener à se détruire eux-mêmes.
Cyberpunk et postmodernisme : Ghost in the Shell et Matrix
Dans Ghost in the Shell (1995), le Puppet Master est un hacker qui infiltre les esprits humains (cyber-cerveaux) pour altérer leurs souvenirs et leurs perceptions du réel. Ce qui est terrifiant, c’est que la victime ne se rend même pas compte qu’elle a été manipulée.
On retrouve cette idée dans Matrix (1999) : la guerre ne se fait pas sur un champ de bataille, mais dans l’esprit des humains, dont la perception de la réalité est totalement contrôlée par un système invisible.
Jeux vidéo et contrôle des foules : Metal Gear Solid et Deus Ex
Les jeux vidéo de type cyberpunk explorent souvent la guerre cognitive à travers des scénarios de contrôle de l’information et de la perception collective.
- Dans Metal Gear Solid 2, l’IA des Patriotes manipule l’opinion publique en filtrant l’information pour rendre la vérité indiscernable du mensonge.
- Dans Deus Ex, l’enjeu n’est pas juste de contrôler les armes ou l’économie, mais de posséder le monopole du récit et de la perception de la réalité.
Guerre Cognitive et Pop Culture : un levier d’influence ?
David Peyron expliquent que la pop culture, la culture geek n’est pas seulement un divertissement, mais un espace de construction d’imaginaires et de normes sociales. On pourrait alors se poser la question suivante : les récits de la Pop Culture influencent-ils notre manière de penser et de percevoir le monde ?
Les théories du complot, par exemple, se nourrissent largement d’un imaginaire geek où une élite cachée manipule le monde depuis les coulisses, une idée très présente dans une œuvre phare de la Pop Culture : X-Files. Oui, le levier d’influence existe.
***
Conclusion : L’âge hyperboréen de la guerre cognitive
Dans les récits de Robert E. Howard, Conan le Cimmérien évolue dans un monde où la force brute côtoie la sorcellerie insidieuse.
« Sache, ô prince, qu’entre les années où l’océan engloutit l’Atlantide et les royaumes resplendissants, et celles de la montée des fils d’Aryas, il y eut un âge oublié où le monde était jeune… »
Cette phrase introductive des chroniques de Conan évoque un passé mythique pour mieux questionner notre présent.
Les sorciers de l’ère hyperboréenne – comme Thoth-Amon ou Xaltotun – ne dominent pas par la puissance physique, mais par la manipulation des perceptions et des croyances. Dans « L’Heure du Dragon », Conan affronte un adversaire qui contrôle non pas les corps mais les esprits de ses ennemis. Cette dichotomie entre la force directe de Conan et la manipulation cognitive de ses adversaires fait écho à notre réflexion sur la métastratégie des consciences.
Lorsque Conan déclare au détour d’un affrontement avec ces sorciers « Je sais que je ne peux pas battre vos sortilèges, mais je peux fendre votre crâne« , il illustre parfaitement la tension entre l’approche clausewitzienne traditionnelle et les nouvelles formes de conflictualité cognitive. Pourtant, même le barbare comprend que certains combats ne peuvent être gagnés par l’épée seule.
Cette exploration de la guerre cognitive à travers le prisme de la Pop Culture soulève plusieurs questions fondamentales qui mériteraient des développements futurs :
- Les architectures narratives de la fiction contemporaine sont-elles consciemment conçues comme des vecteurs de métastratégie, ou sommes-nous face à une émergence systémique non intentionnelle ? Les créateurs de Game of Thrones ou de Marvel sont-ils des stratèges qui s’ignorent ?
- Existe-t-il une hiérarchie d’efficacité entre les différents médiums culturels ? Les jeux vidéo, par leur dimension interactive et immersive, constituent-ils des vecteurs plus puissants de reconfiguration cognitive que le cinéma ou la littérature ?
- Comment les différentes aires culturelles résistent-elles ou s’adaptent-elles à ces flux métastratégiques ? L’Asie, avec ses propres traditions narratives et mythologiques, présente-t-elle des modalités spécifiques de réception et de transformation de ces influences ?
- Dans quelle mesure le soft power est-il une forme sophistiquée de métastratégie des consciences ? Les exportations culturelles sud-coréennes ou japonaises relèvent-elles d’une stratégie délibérée ou d’une dynamique spontanée ?
- Comment les technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle, transforment-elles les possibilités de reconfiguration cognitive à grande échelle ?
Comme Conan naviguant entre les royaumes de l’ère hyperboréenne, nous sommes peut-être à l’aube d’un âge où la compréhension des mécanismes de façonnage des imaginaires collectifs deviendra une compétence stratégique aussi cruciale que la maîtrise des armements conventionnels. La métastratégie des consciences n’offre pas seulement un concept théorique. Elle est à mes yeux une réalité opérationnelle que les récits de fiction nous aident, paradoxalement, à mieux appréhender.
***
Le champ est infini et il est temps de laisser murir ces réflexions. Je poursuivrai cette exploration à travers quelques études de cas précises afin de défendre cette idée que la Pop Culture a beaucoup à nous apporter, n‘en déplaise aux tenants d’une culture « légitime » qui n’ont que mépris pour mangas et autres histoires d’imaginaires obscurs.
***
Note : l’image d’illustration a été générée par IA