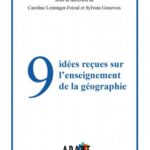Pour son séminaire 2017-2018, Pierre Rosanvallon, titulaire de la chaire Histoire Moderne et Contemporaine du politique, nous propose une analyse des évolutions de la démocratie à partir de la rupture, mal évaluée, de Mai 68 et, au-delà, de réfléchir à la façon dont on pourrait repenser l’émancipation dans un monde hélas marqué par bien des régressions et un « effritement démocratique ». Pour cela, nous dit l’historien, il faut tout d’abord identifier la nature des mutations que nous connaissons en nous munissant de clés d’interprétation plus pertinentes que les seuls concepts de « crise », « mondialisation » ou « néo-libéralisme » souvent trop flous pour permettre une interprétation satisfaisante.
La leçon inaugurale est une plongée dans cette histoire de la modernité et de l’émancipation que Pierre Rosanvallon nous invite à resituer dans sa longévité. Le théoricien de la démocratie revient ainsi, à grands traits, sur les philosophies politiques et économiques des XVIIIe et XIXe siècles. Par ailleurs, Pierre Rosanvallon rappelle sa définition de l’histoire conçue comme « un laboratoire actif de notre présent » et souligne qu’il y a aujourd’hui une urgence à réagir. Dans son ouvrage, « La Démocratie à l’œuvre » (Seuil, 2015), il explique :
« Je suis devenu universitaire pour apporter une réponse plus solide à mes questions matricielles – autour de l’entropie démocratique et de l’égalité sociale. Un universitaire d’ailleurs atypique, puisque je n’ai jamais enseigné au sens de donner des cours. Mon élection en 1983 à l’école des hautes études en sciences sociales (EHESS), puis au collège de France en 2001, deux institutions particulières (Bourdieu parlait de la seconde comme d’un refuge pour « hérétiques consacrés ») m’a donné pendant plus de 30 ans la possibilité de concevoir mes enseignements comme une mise à l’épreuve publique des livres en cours ».
Ainsi ses leçons prennent-elles en compte non seulement le travail de l’historien mais également les engagements individuels du citoyen.
Leçon n°1 : Une histoire longue de la modernité et de l’émancipation
Actuellement l’Histoire véhicule des régressions et dessine des menaces qui génèrent un douloureux sentiment d’impuissance. Les sociétés se délitent et avec elles la démocratie. Le mot de « crise » utilisé depuis la fin des années 1970, à la suite des Trente Glorieuses, est un mot-valise qui recouvre plusieurs réalités et n’aide guère à comprendre les changements à l’œuvre. En effet il souligne deux choses différentes : la référence à un « virage » de l’Histoire ; des moments critiques dans les domaines économiques et financiers. Les mutations de l’ordre structurel du monde ont été décrites avec un nouveau vocabulaire dans lequel dominent les références au néo-libéralisme, à la mondialisation, à l’Union européenne, au néo-conservatisme. Cet arsenal conceptuel largement utilisé demeure cependant trop flou pour permettre de saisir la réalité et cela engendre un fatalisme morose et désabusé (que l’on pourrait résumer par le consentement au célèbre TINA). L’impuissance, nous dit Pierre Rosanvallon, s’enracine tout d’abord dans la difficulté à interpréter le monde et à donner sens à l’Histoire. Si le pessimisme est permis et s’avère même parfois nécessaire en tant que lucidité, il faut savoir « l’organiser » (Pierre Naville). Sinon, faute de comprendre la nature du moment historique que nous traversons, nous sommes condamnés à errer sans repères.
1968-2018 : il faut replacer ces cinquante dernières années dans une histoire longue de l’émancipation. Si l’idée d’un peuple libre est immémoriale (L’Odyssée, La Bible…) et si la modernité n’a pas entièrement crée l’idée d’individu, force est de constater que cette dernière lui a donné une place centrale. Rousseau, Locke, Kant résument cet avènement. Le premier a fait de la quête de l’indépendance la clef du bonheur individuel. Le second, dans son « Deuxième traité du gouvernement civil » (1690), a élaboré une théorie de l’homme libre comme « individu propriétaire de lui-même ». La loi étant pour Locke l’instrument permettant de préserver et d’augmenter la liberté et non de la restreindre (l’Etat de droit). Cela implique une absence de sujétion et un affranchissement des volontés extérieures. Cette théorie de l’autonomie est donc adossée à une vision politique annonciatrice de l’idéal démocratique. Pour le philosophe anglais la liberté en société consiste à ne relever d’aucun autre pouvoir législatif que celui établi en République d’un commun accord. Pour sa part, Kant a défini les Lumières comme « la sortie de l’homme de l’état de minorité dans lequel il se maintient par sa propre faute ». Ainsi « l’état de minorité » est « l’incapacité de se servir de son propre entendement sans être dirigé par un autre ». John Millar, quant à lui, a inscrit les Lumières écossaises dans une philosophie progressiste consacrant l’individu. Pour Millar tout mouvement de civilisation est une marche inéluctable vers l’émancipation des individus. Dans cet esprit, l’indépendance n’est pas strictement liée aux capacités de l’individu mais constitue une forme sociale. La société est alors fondée sur une réciprocité des consciences libres (Jean Starobinski). Dans le cas français cela se traduit par la consubstantialité des droits de l’homme « et » du citoyen, la citoyenneté active et égalitaire étant la condition de l’autonomie de chacun.
Les Lumières appréhendent l’autonomie selon trois critères : la propriété, le marché, l’Etat de droit. La propriété étant comprise, depuis Locke, comme étant ce qui permet de mener une vie indépendante. La propriété d’alors est la terre, l’atelier, l’échoppe. Au cours de la Révolution le droit à la propriété est constamment réaffirmé, le marché étant considéré comme le moyen d’être libre. Dans l’esprit des Lumières la non-représentation en politique ou en économie est à la base de l’émancipation et le marché impose un mode de relations sociales abstrait, non personnalisé. Pour Adam Smith cette « main invisible » est liée à une dimension morale et sociale, tout comme le « déterminisme économique » de Millar. De nos jours cette conception, assimilée au néo-libéralisme, peut être perçue comme la source de tous les maux. Or, au XVIIIe siècle, les sociétés vivent sous des régimes despotiques et le marché, espace vierge, peut faire figure de front pionnier de la liberté sous la forme d’un capitalisme utopique. D’autre part, et cela est intimement lié, les Lumières souhaitent l’avènement de la loi en lieu et place du pouvoir d’un seul. La loi se doit d’être impartiale, objective, désintéressée. Elle est faite pour rendre libre en obligeant les hommes sans les dominer, en les contraignant sans les violenter. Ici se dessine donc un libéralisme optimiste, fondement intellectuel de la première modernité. Or, durant la Révolution, resurgissent les mécanismes de rejet du luxe, de la dépense somptuaire, considérés comme les ferments de la division sociale. La frugalité et la mesure, la tempérance, deviennent valeurs essentielles. Est alors glorifié un ascétisme devant permettre la maîtrise des passions et la régulation sociale.
Dès l’Antiquité se sont multipliées les lois somptuaires pour limiter les excès de luxe et la manifestation outrancière des inégalités. Adam Smith, père de l’économie politique, partage cette vision morale et n’est en rien un chantre de ce que l’on nomme aujourd’hui la « société de consommation » : « L’estomac du riche n’est pas en proportion avec ses désirs et ne contient pas plus que celui du villageois grossier ». Cette conception lui permet de développer sa théorie des sentiments moraux, c’est-à-dire l’égalisation relative des intérêts et des besoins. Montesquieu ou Rousseau, tout comme le radical curé Meslier, stigmatisent également le luxe comme vecteur des inégalités sociales. Le premier libéralisme est une culture de l’autonomie car il naît dans un monde qui n’a pas encore vécu la perturbation sociale radicale engendrée par la révolution intellectuelle. En effet, progressivement, la culture de ce libéralisme originel est peu à peu invalidée par la réalité de l’évolution sociale. Face à l’évolution des sociétés industrielles européennes il y a d’abord eu une vision minimale de l’égalité des droits et des chances justifiée par des raisons naturelles et morales. Ce courant de pensée est dominant au début du XIXe siècle en Europe. Les révolutions invalident les espoirs du premier libéralisme et l’autonomie est alors conçue de manière restrictive : le peuple est assimilé à une humanité restée dans l’enfance. Ce libéralisme étroit définit l’idéologie bourgeoise qui justifie l’état existant des choses. Ainsi, le libéralisme bourgeois fige l’utopie libérale, la déshabille de son dynamisme pour l’inscrire dans un ordre jugé naturel. Cela conduit à une appréciation négative du mot « libéralisme », confisqué par la bourgeoisie. Cependant, il y a, parallèlement, au XIXe siècle, des tentatives pour réactualiser, revivifier le libéralisme utopique. Ainsi, Marx, récusant les vertus de la frugalité, annonce que l’abondance créera des effets positifs et qu’il convient d’abolir l’ordre contingent des besoins en révolutionnant les systèmes de production ce qui permettrait au libéralisme utopique, dans sa phase post-révolutionnaire, de s’installer.
Une autre forme envisagée pour réactiver le libéralisme utopique est la mise en place de modalités de production et de techniques économiques permettant aux individus de s’émanciper. Ainsi apparaît l’idée coopérative, très répandue dans le monde ouvrier, et théorisée par Proudhon dans sa définition des nouvelles corporations inscrites dans une vision sociale fédéraliste. Selon Proudhon, la Révolution française a eu le tort de supprimer les corporations et aurait du les réinventer. Proudhon tente de redonner sens à cette vision économique de l’autonomie avec une technique novatrice de crédit : création d’une Banque du peuple pour renverser les rapports entre le capital et le travail. Le capitalisme étant le système dans lequel le capital achète la force de travail et asservit l’ouvrier, il convient de permettre au travail de louer le capital à travers un système de crédit facilement accessible. A côté de cette voie socio-économique, la volonté d’autonomie se manifeste, de façon plus politique, par le développement de nouvelles pratiques institutionnelles, en particulier celle du suffrage universel. Ce dernier est perçu comme devant être le correcteur des dysfonctionnements de la pensée émancipatrice du XVIIIe siècle (propriété, marché, loi). Déjà, en Angleterre, les Chartistes l’ont compris en soulignant que si le riche est puissant c’est qu’il détient aussi le pouvoir législatif et que le suffrage universel constitue bien la solution aux maux ouvriers. Cette idée est également présente en France et en 1848 le peuple estime que le suffrage universel (masculin) est une libération. Pour Ledru-Rollin le suffrage universel permet même d’effacer le statut de prolétaire. C’est pour cela qu’en bon observateur de la société anglaise Engels considère le suffrage universel comme une arme révolutionnaire. Or, toutes ces façons de faire advenir l’utopie libérale vont échouer.
Le développement du capitalisme, destructeur des idéaux des Lumières, coïncide en outre, à la fin du XIXe siècle avec un fort mouvement d’internationalisation (circulation accélérée des marchandises, des hommes et des capitaux) que l’on peut définir comme la première mondialisation. L’entrée dans cette nouvelle ère économique entraîne une approche différente de l’idée d’émancipation. L’individu n’apparaît plus comme le sujet pertinent de l’émancipation et la société est de plus en plus analysée en termes de groupes, de classes. Les syndicats et partis politiques sont l’expression de cette mutation que valide la sociologie naissante. La Révolution française est accusée d’avoir trop considéré que la bonne société était une société d’individus libres et indépendants. Léon Bourgeois, auteur de « Solidarité » (1902), affirme que « l’homme seul n’existe pas ». Affirmation qui conduit des républicains et des radicaux à refonder leur culture politique. On tente alors de faire des réformes pour encadrer, canaliser et corriger le nouveau capitalisme. Dès lors ce n’est plus l’individu autonome qui est la mesure de l’émancipation mais la classe protégée. Cette nouvelle approche entraîne trois orientations : la mise en place de la taxation progressive des revenus pour réduire les inégalités ; la limitation du poids des aléas sociaux (chômage, maladie, accidents, retraite) ; la régulation, et non plus l’abolition comme avant 1914, de la condition salariale. Pierre Rosanvallon évoque alors la révolution keynésienne : « elle n’est pas seulement une intervention de l’Etat », mais surtout la reconnaissance « des données économiques » comme des « variables d’action et pas seulement des variables de résultats ».
Ces trois orientations constituent la nouvelle approche de l’émancipation et la plupart des pays européens mettent en place des mesures de ce type qui ont pour avantage de calmer la pression sociale, de repousser le spectre de la révolution et de contenir les tentations de national-protectionnisme qui se développent, notamment en France. Le national-protectionnisme, fondé sur une critique de la modernité, veut faire d’une nation exclusive le nouveau vecteur de l’émancipation. Cette conception est marginalisée par le système réformateur et tend à disparaître avec l’installation du keynésianisme et de l’Etat-Providence. Cependant elle a récemment ressurgit car le deuxième âge de l’émancipation a vacillé à partir des années 70 et cela pour trois raisons. Une raison économique : le ralentissement de la croissance (choc pétrolier de 1973) qui, en réalité, est plus structurel que conjoncturel car il correspond à la fin du cycle de rattrapage des économies européennes par rapport à l’économie américaine, provoquant une crise financière et la montée du chômage de masse. Une raison sociétale : l’effondrement du deuxième âge de l’émancipation et l’entrée dans un nouvel essor de l’individualisme qui est un individualisme de la singularité se superposant à l’individualisme d’universalité des droits de l’homme. Ce dernier est constructeur d’une forme sociale tandis que le nouvel individualisme exige que chacun puisse trouver une voie personnelle. Ici Mai 68 fait référence pour appréhender ce basculement décisif qui a modifié les attentes des individus et des sociétés ainsi que le fonctionnement des institutions. Le déclin du syndicalisme en constitue un exemple marquant. Ainsi, depuis 1968, ce sont des formes nouvelles de l’individualisation qui apparaissent. Cette individualisation que l’on juge nuisible à la cohésion sociale n’est en réalité qu’un appel à d’autres formes d’une cohésion sociale enrichie et, paradoxalement, n’est pas très éloigné de la formule de Marx selon laquelle chaque individu doit être artiste de sa propre existence. La société, dès lors, entre dans une troisième modernité. Face à cette mutation trois types de réponses dominent : le retour au libéralisme utopique de la première modernité avec une vision optimiste de l’économie-monde ; le national-protectionnisme qui fait aujourd’hui souvent cause commune avec le populisme ; la tentative de reformuler les réponses de la deuxième modernité. Hélas, nous dit Pierre Rosanvallon, parmi toutes ces réponses aucune ne propose une nouvelle forme d’émancipation pour répondre aux défis actuels…
Jorris Alric