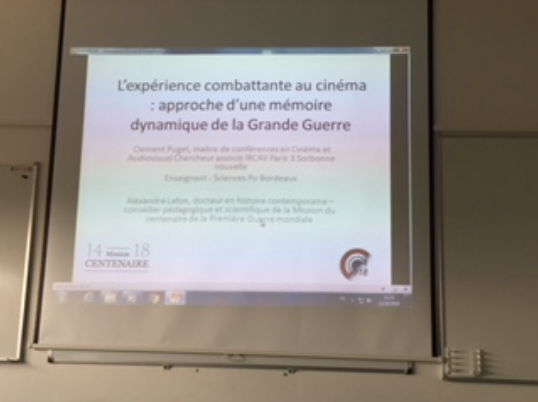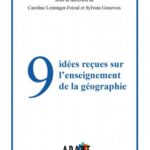Clément Puget, maître de conférences en Cinéma et Audiovisuel, chercheur associé à l’IRCAV (Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel) Paris III Sorbonne Nouvelle, enseignant à Sciences-Politiques Bordeaux-Montaigne.
Alexandre Lafon, docteur en histoire contemporaine, conseiller pédagogique et scientifique de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale.
Alexandre Lafon :
« Dans le cadre aujourd’hui de la fin du cycle de commémoration de la Première Guerre mondiale, le choix pour cet atelier est de montrer comment le cinéma peut être abordé dans les classes dans un travail de mémoire et d’histoire – et non pas « devoir de mémoire et d’histoire ».
En particulier, il s’agit de proposer deux directions :
- l’étude du cinéma comme support pédagogique dans les classes, dans le cadre du travail autour de l’expérience combattante.
- l’étude du cinéma comme support pédagogique de production par les élèves. »
La salle découvre ici un court métrage, production d’élèves d’école primaire. Dans un jeu de rôle, ils interprètent des militaires, des aviateurs à l’aide de costumes et d’accessoires. On les voit successivement autour d’une carte d’état-major, incarnant des pilotes alliés recrutés puis découvrant leur plan de vol et enfin réalisant la mission à l’aide de maquettes d’avions. La fin du court-métrage montre le lien avec la population villageoise et le cadre familial.
Après avoir mentionné que la Mission du centenaire a labellisé plus de 2000 projets pédagogiques venant d’écoles, de collèges ou de lycées généraux et professionnels, Alexandre Laffont rappelle que l’expérience combattante de la Première Guerre mondiale est présente dans les programmes en CM2, au cycle 3 comme en troisième et au lycée ,voire parfois, dans les programmes des classes préparatoires et souhaite montrer l’intérêt de ce type de travail avec les élèves.
« La production visionnée, reprenant les éléments du cinéma et de la musique américains afin de réinvestir une culture cinématographique, est une re-présentation de la Première Guerre mondiale cent ans après, à travers des images et des mémoires produites aujourd’hui. Ce qui est intéressant dans cette production est le lien entre le présent et le passé, point important car la commémoration ne veut pas aujourd’hui seulement s’appesantir sur le passé mais partir du présent.
D’une part, ce travail pédagogique a permis l’interprétation de ce qu’a pu être la Première Guerre mondiale par les élèves et leurs enseignants, à travers des images qui ont été montrées aux élèves et un travail sur les archives, notamment autour des uniformes et des avions. La problématique de départ a été celle de l’expérience combattante qui a ouvert la possibilité, dans le cadre d’une commémoration, de l’appropriation par les élèves de cet événement centenaire.
Ainsi, l’exemple de cette production pédagogique montre l’interrogation au présent du passé, réinscrite à la fin du film, dans laquelle on voit les élèves aller sur des sites de la Première Guerre mondiale. La visite a été préalable à leur construction d’un scénario.
Pour les enseignants, la connaissance des faits de la Première Guerre mondiale, la question des mémoires et l’appropriation contemporaine de celles-ci ont pu se réaliser à travers des compétences autour du cinéma.
La question de l’expérience combattante, le travail de mémoire à l’occasion des commémorations, donc le travail d’histoire, passent alors par la construction de nouveaux repères iconographiques appropriés et iconiques. Ainsi, les élèves en travaillant sur d’autres images cent ans après, s’approprient cet événement en produisant par le cinéma des images qu’ils vont sans doute intégrer. Dans un effet de transmission, ils vont pouvoir devenir alors les héritiers de la mémoire qui doit être un patrimoine proche. En effet, l’école se situe à Chézy-sur-Marne, à proximité du front de la Marne de la première bataille en septembre 1914, comme de la seconde bataille de la Marne en juillet 1918. Ils ont pu aussi faire un travail d’appropriation de leur espace proche. »
Après cette présentation introductive, Alexandre Lafon évoque la présence du cinéma dans les commémorations et dans l’action pédagogique et propose des outils pour l’utiliser
« Les commémorations du cycle de la Première Guerre mondiale restent un enjeu majeur pour les élèves. Les témoins ont disparu, la mémoire directe n’existe donc plus, le dernier combattant français, Lazare Ponticelli, étant mort en 2008. La disparition des acteurs pose la question de la transmission, les associations des anciens combattants qui étaient le rouage de cette dernière disparaissent également.
Aujourd’hui, deux vecteurs assument ce rôle : le vecteur familial mais qui n’est plus aussi opérant avec la perte des anciennes générations et celui de l’école qui se retrouve alors en première ligne.
Se focaliser dans un centenaire de la Première Guerre mondiale correspond aussi à des enjeux de proximité. La mémoire familiale perdure, les mémoires locales sont très fortes à travers la présence du monument aux morts communal, qui appartient à l’espace proche des élèves, et les mémoires nationales très importantes, le monde entier étant venu se battre sur le champ de bataille français. Des mémoriaux internationaux aux histoires liées à la présence de troupes internationales, la mémoire est aussi celle du vécu de l’arrière comme les mémoires portées par le monde combattant. Ainsi, l’expérience combattante est au cœur de ces dernières, les anciens combattants étant plus de 6 millions à la fin de la Première Guerre mondiale. Les intellectuels vont porter la mémoire et l’écrire mais également les enseignants et instituteurs fortement touchés par ce conflit.
Les traces en sont multiples dans les paysages et l’environnement des élèves : noms de rue (exemple de Bordeaux avec la place de la Victoire, le cours de l’Argonne, le cours de la Somme), noms des stades (Aimé Giral à Perpignan, Boyau à Dax), hommages aux sportifs combattants pendant la Première Guerre mondiale. Il existe, de plus, une présence culturelle très forte, encore aujourd’hui, à travers la littérature dont est emblématique le roman de Pierre Lemaître en 2013, Au revoir là-haut, adapté ensuite au cinéma.
Par ailleurs, depuis les années 1990, le cinéma qui intègre la Première Guerre mondiale se développe dans le contexte de la disparition des témoins directs. La Grande Guerre devient sujet fascinant de la violence du XXe siècle qu’elle condenserait (en discussion chez les historiens) et la fascination pour la mobilisation massive de toute la société a fortement marqué l’empreinte mémorielle.
Enfin, il y a un repositionnement des approches, notamment lié à la chute du mur de Berlin, qui alimente la production cinématographique enrichissant les supports pédagogiques utilisables dans les classes. Les sentiers de la gloire (Stanley Kubrick 1957), Joyeux Noël (Christian Carion 2005), Les Fragments d’Antonin (Gabriel Le Bomin 2006) répondent par exemple aux représentations que nous avons du soldat-victime de la guerre, plus qu’à celles des années 1920 à 1950 du soldat-héros.
Ces enjeux de la commémoration à l’école passent aussi par l’appréhension des usages politiques de la Première Guerre mondiale.
Le 11 novembre prochain, le centenaire sera l’acmé du cycle commémoratif. Le président Macron a invité plus d’une centaine de dignitaires étrangers sous l’Arc de Triomphe pour la commémoration de la matinée et l’après-midi, un forum pour la paix se tiendra afin de construire, à partir de cette mémoire, une réflexion commune sur le futur.
Les élèves, futurs citoyens, doivent pouvoir mesurer ces enjeux. Ainsi, la commémoration Mitterrand-Khol, en 1984 à l’ossuaire de Douaumont, scelle ou réactive le traité de l’Élysée d’amitié franco-allemande. En 1998, le premier ministre Lionel Jospin réintègre dans la mémoire nationale celle des fusillés pour l’exemple ouvrant un débat politique. En 2012, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, la loi de 28 février transforme le 11 novembre en élargissant l’hommage aux combattants de toutes les guerres morts pour la France et engage un débat sur son devenir vers une sorte de mémorialité à l’américaine.
Ces enjeux-là sont ainsi des enjeux scolaires d’appropriation par les élèves de l’époque contemporaine.
Par ailleurs, la Mission du centenaire dépend directement du cabinet du premier ministre et c’est une mission interministérielle (ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Armées, de l’Economie, de la Culture, de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur). La pluridisciplinarité montre que cent ans après, ce n’est pas seulement le ministère des pensions de guerre des anciens combattants qui a l’apanage de la mémoire de ce conflit, mais que les enjeux sont suffisamment importants pour que ce soit une vision globale. D’ailleurs, la feuille de route proposée indique que ce n’est pas seulement les professeurs d’histoire et géographie qui sont les fers de lance de la transmission des mémoires et de la compréhension de l’histoire, mais que ce doit être un projet scolaire porté par l’école dans son ensemble et donc par toutes les disciplines. En effet, aujourd’hui la Première Guerre mondiale est en quelque sorte un produit pluridisciplinaire avec des productions massives de courts-métrages et de productions massives d’œuvres cinématographiques (adaptation d’Au revoir là-haut) et de documentaires.
Il s’agit donc d’assumer le rapport présent-passé en partant du présent et des questions posées pour interroger le passé, de s’appuyer sur un espace proche sur les repères culturels des élèves.
Partir du présent, c’est aussi partir des traces du passé avec les archives (départementales, municipales, fonds d’archives de la section photographique de l’armée) d’images fixes et animées que l’on retrouve dans les 2000 projets proposés à la Mission du centenaire. Le site centenaire.org permet de consulter les courts-métrages produits par les élèves.
Une vraie attente sociale autour des mémoires de la Première Guerre mondiale, à travers la question de la violence au cœur des interrogations historiographiques, passe par l’école. Cette mobilisation de l’école pluridisciplinaire a donné lieu à divers projets :
- fabrication d’assiettes patriotiques à Quimper à partir des motifs iconographiques produits en 1917. Les élèves invités à refaire un jeu d’assiettes en fabriquant à nouveau l’image, le discours et l’objet en réinterrogeant l’histoire de la Première Guerre mondiale.
- travail sur les uniformes pour en recomposer les couleurs en lycée professionnel .
- productions théâtrales ou productions de livres dont les problématiques étaient de retrouver l’expérience de l’épreuve individuelle mais aussi des expériences collectives.
D’autre part, l’étude du cinéma comme source de la Première Guerre mondiale, films de fiction ou fils d’actualité produits pendant la Grande guerre, comme support pédagogique prend de plus en plus d’importance. Pour chaque film de fiction qui sort autour de la Première Guerre mondiale, un dossier pédagogique lui est associé. Celui de Au revoir là-haut est d’une richesse pédagogique remarquable avec un lien entre l’image et le cinéma et la littérature. Par ricochés, la dernière phrase de Jean Blanchard, fusillés pour l’exemple de Vingré en 1915 dans la Marne, dans sa dernière lettre à sa femme « Au revoir là haut » provient de la correspondance de ce soldat publiée il y a une dizaine d’années par les historiens. On peut donc, par le biais du cinéma de fiction, aller jusqu’à la source et travailler avec les élèves la place dans les mémoires, aujourd’hui du cas des fusillés pour l’exemple et de ses mémoires problématiques. La problématique de la sortie de guerre, la question du regroupement des corps qui a été un choix français, la question de la construction du monument aux morts, peuvent aussi être abordées.
La Mission du centenaire propose, avec Bruno Veyret et Claude Puget, des sources pédagogiques et des archives (sur le site voir l’accès cinémathèque) afin d ‘élaborer un travail pédagogique de cette « puissance mémorielle » pour reprendre le thème des RDV de Blois.
Pour terminer, Alexandre Lafon expose un photo-montage très utilisé dans les cours et les manuels scolaire et qui engage à faire attention à la question des sources. Elle est extraite d’un film qui se veut historique, donc véridique (Verdun, vision d’Histoire, Léon Poirier 1927) et devient alors une image mémorielle de la Première Guerre mondiale, image iconique mais qui n’a pas été une image produite pendant la guerre.
« Pour moi, la question du cinéma, de l’expérience combattante et des commémorations doit pouvoir allier la question la prise en compte de la mémoire c’est-à-dire : tout ce dont on se souvient ensemble ou individuellement à propos du conflit, avec sa compréhension qui passe par l’histoire. On se sert des mémoires pour faire de l’histoire en comprenant bien quelles sont les sources que l’on utilise. Le cadre des commémorations est un temps de réflexion collective sur le récit du passé et permet la réalisation aujourd’hui par les élèves de nouvelles images. Ces dernières doivent alors être aussi puissantes pour eux afin qu’ils puissent s’approprier ce qu’il s’est passé. »
Clément Puget expose ensuite une série d’exemples montrant le traitement évolutif de l’expérience combattante par le cinéma.
« Mon but n’est pas de donner un guide de ce qu’il faut faire en cours mais je proposerai des exemples avec leur analyse filmique. L’idée est d’avoir un panorama des films de la Grande Guerre, plutôt extraits du cinéma français.
L’usage du cinéma comme source de connaissances de la Première Guerre mondiale est intéressant mais utiliser le cinéma en classe, c’est peut-être aussi s’intéresser au cinéma proprement dit. Dans le cadre de la Première Guerre mondiale, il faut comprendre comment et pourquoi on a filmé la guerre, pourquoi on continue à le faire aujourd’hui. Les élèves pourraient se dire cela fait cent ans qu’on fait des films, qu’est-ce qu’on a d’autres à montrer ? J’espère que les exemples que j’ai choisis montreront cette évolution, du déroulement des faits jusqu’à leur mémoire.
Pour premier exemple, une citation de Paul Virilio, qui n’est pas cependant un historien de la Première Guerre. Lorsqu’il parle d’Edward Griffith, réalisateur de Cœurs du monde (Hearts of the World 1918), il dit : « le champ de bataille qu’il a devant lui n’est apparemment composé de rien, plus d’arbres, plus de végétation, plus d’eau, même plus de terre, vide de corps à corps le couple homicide-suicide s’est perdu de vue ». Le personnage du film se trouve dans une situation qu’il n’imaginait pas, celle d’un champ de bataille qui ne ressemble peut-être pas à ce qu’il attendait. On est en 1918, pendant la guerre qui n’est pas terminée, Griffith réalise son film avec l’appui des forces militaires. C’est la première fiction américaine, premier film de long-métrage, en temps de guerre. Il donne une approche, une représentation de la guerre. Attention, il n’y a pas de présentation originelle mais toujours des représentations de la guerre. Ainsi, lorsque Barbusse écrit le feu, c’est déjà une représentation et même si on peut juger que son travail par rapport un film est plus proche de l’événement, il est déjà un discours sur l’événement.
Au cinéma c’est la même chose, Griffith va être confronté à ce qui lui pose question : comment traiter de la guerre ?
Un peu antérieure, une photographie (que diffuse aussi le site de la Mission du centenaire) proposée de la SPCA (section photographique cinématographique de l’armée), née en février 1917 et issue de la création antérieure des sections cinématographique de l’armée (mars 15) et photographique de l’armée (avril 1915). C’est une photographie d’opérateur qui, le 16 avril 1917, filme la guerre, le champ de bataille d’un lieu. Donc, les premières images de la guerre sont d’abord des images d’opérateurs. Dans le cas français, les opérateurs militaires ont commencé à travailler en 1915 seulement; ainsi, entre août 1914 et février 1915, il n’y a pas d’image militaire tournée au front ou à proximité du front par des opérateurs français. En revanche, il y a des images sur les écrans de cinéma, dans les actualités qui proviennent de l’étranger. Les années 1916 et 1917 sont par contre des moments intéressants et décisifs en terme de représentation et de profusion des images militaires.
Pour autant, la question qui se pose et peut-être même à cet opérateur, est : que filmer ? Immédiatement une double volonté s’affirme : filmer pour qu’il reste une connaissance, un savoir, donc constituer une archive dans le service cinématographique et photographique de l’armée mais aussi montrer la guerre telle que les civils ne peuvent pas la voir. Cette double problématique se pose dès le temps de guerre avec des réponses assez différentes.
Autre exemple : un film de fiction, qui n’est pas une production militaire, mais produit par Pathé, anonyme car beaucoup de films ne sont pas signés dans cette période de 1915, 1916,1917. Pathé fait chaque année à peu près une centaine de courts-métrages, films qui font entre 20 et 30 minutes, et assez peu de longs-métrages. Ici il y a une séquence combattante, en 1916, en plein contexte de guerre, à l’écart de la production officielle qui est celle des opérateurs de l’armée. Dans cette séquence, on voit l’agonie du héros et la fiction est assez évidente, on aurait du mal à croire que l’assaut est tourné en direct pendant la guerre. On trouve des uniformes à la fois belges, français et allemands. C’est l’histoire de la bataille de l’Yser, connue, pour laquelle le cinéma n’apporte rien en terme de connaissance de l’événement. Le film nous intéresse ici pour la représentation qu’il propose de l’ennemi allemand qu’on visualise. Les troupes belges le défont mais on assiste à l’agonie du héros français. Le film choisit le cadre d’une histoire vraie pour évoquer une situation de combat qui relève donc de l’expérience combattante, certes, caricaturale et peut-être exagérée ou édulcorée selon l’impression que l’on peut en avoir. En tout cas, c’est ce que le spectateur découvre pendant le temps de guerre pour qui, ce type de scène est la représentation de la guerre. À côté de ces images de fiction, dont on pourrait penser qu’elles évacuent totalement la guerre, il y a d’autres images qui ont la prétention ou le statut d’images dites « d’actualité », images militaires tournées par des militaires.
Un autre exemple pris dans le film très connu « The Battle of the Somme« , premier film de long-métrage documentaire produit par l’armée britannique à l’occasion de la bataille de la Somme. La séquence la plus connue mais aussi la plus isolée est un peu unique. Deux plans, les seuls qui pourraient s’apparenter au combat, montrent une sortie de tranchée. Les Britanniques passent le parapet pendant la bataille de la Somme lors de l’offensive alliée de juillet 1916. Mais, à l’image, le combat se fait contre un ennemi invisible donc absent. Dans les plans décrits, l’opérateur filme les soldats de dos. Il existe une différence entre les deux plans quant à son positionnement. Dans le premier, l’opérateur est protégé, le plan pourrait avoir été tourné dans le réel de la bataille, sur les lieux mêmes, dans la Somme. Dans l’autre, c’est beaucoup moins envisageable dans la mesure où l’opérateur semble suivre à hauteur des hommes qui partent dans le no man’s land vide, ce qui correspondrait à une trop grande mise en danger. Or, ces images britanniques vont faire sensation mais vont rapidement aussi être analysées comme telles donc elles ne vont pas mentir longtemps. Cependant, il existe bien des plans de sortie de tranchées analogues, tournés au même moment du côté français en 1916, dans lesquels on voit que l’opérateur se protège filmant dans une légère contre-plongée, plus bas que les hommes qui sortent. La position de l’opérateur donne, sinon l’assurance, au moins le sentiment fort que ce plan est tourné à proximité du feu, de la ligne de front même si l’ennemi reste encore invisible. En terme de représentations, les spectateurs qui voient ces images de cinéma de fiction ou d’actualité, ne voient pas d’Allemands. En effet, le cadre réglementaire jusqu’en 1916 interdit sur les écrans, mais aussi au théâtre et dans toute représentation artistique, d’utiliser ou de représenter un uniforme allemand. Beaucoup de films de fiction ont été tournés dans les années 1914-1915, dans lesquels les personnages étaient des Allemands, mais ils n’ont pas été vus à ce moment-là parce qu’on ne pouvait pas les montrer à l’écran. En 1916, cette interdiction est levée parce que l’État français comprend que montrer l’Allemand peut agir sur la détestation qu’on a à son égard et permet de lutter culturellement et moralement auprès des civils. Auparavant, on ne montre pas les Allemands parce qu’ils sont source de chaos, d’agitation, d’insultes, de situations assez incontrôlables dans les salles ou les théâtres.
Après guerre, en 1919, côté français, Abel Gance réalise J’accuse. Dans une séquence, une image de la guerre tranche avec les précédentes et l’absence relative de l’expérience du combat. Abel Gance, le réalisateur, et son équipe sont assistés de Blaise Cendrars. Donc c’est un film qui se réfère à une littérature déjà combattante en même temps qu’il est une fabrication, une création, une invention de la guerre. Dans un des plans, l’explosion que l’on voit provient du sol. L’explosif est placé au sol et fait un feu d’artifice au moment de la charge des soldats. Or, un obus ne peut tomber évidemment que du ciel. On repère cela très facilement dans de nombreux films. Ainso, onpeut déjouer les erreurs dans Verdun, vision d’histoire, souvent cité par des documentaristes abusés par le côté spectaculaire du film. Ainsi, ces images prouvent qu’il s’agit bien d’une fiction. En même temps, Gance utilise des plans d’archives de l’armée française, qu’il n’a pas tournés mais qu’il a récupérés et montés. Le film J’accuse mêle alors des plans militaires d’actualité que les Français ont peut-être déjà vus au cinéma, dans les actualités de guerre françaises, de 1916, 1917, 1918. Dans ce film de fiction de 1919, il est intéressant de voir comment Gance va combler un manque : la guerre n’a pas été suffisamment visible et visuelle. Il réalise pour cela ces plans très spectaculaires d’opposition de combattants. Cependant, il ne se détourne pas des images d’archives dont il pense, comme avec son plan d’images de canons, qu’elles apportent aussi une authenticité du conflit. Il est enfin important de ne pas tomber dans une caricature qui serait « on a rien vu pendant la guerre, l’après-guerre permet de tout voir » car on se tromperait sur la production réelle des images en temps de guerre et d’après-guerre.
L’exemple suivant est celui du film américain : La grande parade de King Vidor en 1925. Il est tourné exclusivement aux Etats-Unis, au Texas, même s’il entend représenter l’Argonne. Cela fait quelques années que l’on est sorti du conflit, c’est un film de l’après-guerre qui en terme de représentation combattante propose quelque chose de novateur d’inattendu. En effet, on y trouve la présence frontale et plein cadre, dans le champ, de l’ennemi allemand, quasiment absente des productions précédentes, même chez Gance en 1919. S’il y a de multiples façons d’évoquer les ennemis, l’opposition de cette expérience combattante entre deux combattants existe visuellement. Kind Vidor donne un visage à l’ennemi qui empêche le spectateur de rester dans un régime de diabolisation de celui-ci. Il a été celui de la propagande du temps de guerre ou même de l’avant guerre car le patriotisme et la haine de l’Allemand est déjà présente en 1911-1912 dans les films. Ici, le réalisateur choisit de mettre face à face Alliés et Allemands.
En comparant Verdun, vision d’histoire avec La grande parade qui arrive trois ans après en 1928, on remarque que Léon Poirier, tout en accordant du temps et de la place dans son récit aux soldats et officiers allemands, distinguant bien d’ailleurs ceux qui sont officiers de ceux qui ne le sont pas, reste tout de même un cinéaste français dans un régime de représentations patriotiques. Il donne au fond la préférence aux poilus français et leur rend hommage, dans le film les poilus meurent peu et plutôt dans un esprit de sacrifice.
Chez Raymond Bernard, c’est un petit peu différent en 1932 avec l’adaptation des Croix de bois de Roland Dorgelès. Le cinéaste, déjà très connu à ce moment-là, travaille alors sur la manière de filmer le combat avec des plans assez impressionnants mais surtout, notamment dans l’épilogue du film, il montre une guerre qui se termine mal, notamment pour le personnage Gilbert Demachy conformément au roman de Dorgelès. C’est une nouveauté. Que la guerre s’achève par la mort est une première dans le cinéma français de divertissement. On s’aperçoit ainsi que la guerre a tué, jusqu’alors les films s’achevaient par le retour à la terre, le retour à la ferme et la réunion de la famille.
Les sentiers de la gloire de Stanley Kubrick (1957) vont marquer une rupture pour deux raisons. Une rupture chronologique car on est à la fin des années 1950. La Première Guerre mondiale est filmée par Stanley Kubrick avec des mouvements de caméra tout à fait innovants, plans que l’on retrouvera à de nombreuses reprises et continuellement, par exemple dans Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Ce dernier reprend presque quasiment à l’identique les sorties de tranchées. Ce qui est essentiel dans l’expérience combattante chez Kubrick et dans ce qu’il dit de l’expérience combattante dans l’armée française c’est que celle-ci vit une implosion voire une dégénérescence. En effet, le contexte très particulier de la fin des années 1950 est celui de la guerre d’Algérie mais aussi de la guerre de Corée qui s’est achevée quatre ans auparavant. Dax est joué par Kirk Douglas dans le rôle titre d’un officier à la fois héros de cette histoire et victime. Il y a ici une évolution du récit cinématographique vers une prise en compte de la souffrance du soldat. A partir des années 1960, elle devient essentielle dans les représentations filmiques.
Le dernier exemple est un paroxysme de la représentation du combat dans la Première Guerre mondiale. Film sorti en 1996 réalisé par un cinéaste passionné d’histoire. Bertrand Tavernier produit un travail sérieux sur la question et opère des choix pour représenter l’expérience du combat et des combattants. L’armée d’Orient est dirigée par le général Franchet d’Espèrey. La séquence se situe à la fin de l’année 1918, en septembre, au moment de l’ascension de la montagne qui ouvre l’offensive dite « Franchée D’Espèrey » permettant de briser le front immobilisé depuis Gallipoli. A ce moment précis, dans cette histoire connue que les historiens ont déjà raconté, Tavernier propose cinématographiquement une lecture des événements qui n’est peut-être pas celle des ouvrages d’histoire. Il met en scène une compagnie franche ou corps franc qui travaille pour et du côté de l’armée française mais qui n’en a ni l’uniforme, ni la conduite, ni le nombre. C’est un petit groupe qui se distingue par des individus isolés dans le champ de la caméra ; dans certains plans ils sont seuls à l’écran. Grâce au montage alterné, le film associe aussi l’armée régulière d’Orient. Tavernier propose ainsi deux actions qui se déroulent dans un temps qui est le même et font partie de la même bataille. Ces plans alternés lui permettent d’évoquer l’expérience combattante qui n’est pas seulement celle des soldats réguliers et de montrer qu’à l’intérieur de l’armée, il y a des troupes, « compagnies franches » qui œuvrent différemment ,participant d’une autre manière à ce qui sera une victoire. L’intérêt du film est ici non pas de dire « est-ce que ça s’est passé comme ça ? », mais de dire qu’une partie de l’armée française ne combat pas de la même manière que les troupes dites régulières. En terme de représentations, les corps francs vont être de plus en plus isolés à la fin du film. Tavernier et d’autres cinéastes représentent alors l’échec personnel, parfois militaire par opposition aux films des années 1930, âge d’or des représentations héroïques d’une armée collectivement unie et collectivement victorieuse.
Pour conclure, une citation : « les films amènent à repenser l’historicité de l’histoire elle-même à travers une réflexion qu’ils imposent sur les modalités du récit aussi bien à propos de la question du temps qu’à propos de la relation entre réalité et représentation, vérité et fiction » et cela pour ne pas trancher un peu trop rapidement ou abusivement entre les images faites en temps de guerre et les images d’après-guerre.
NB : tous ces films cités sont disponibles en DVD et faciles à utiliser. »
Par Carole ESQUERRE SAIDANE pour les Clionautes.