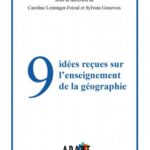Fabrice Delsahut se présente comme un ethno-historien qui s’est donné pour défi de mettre en avant cinq siècles d’évolution de l’image de l’Indien d’Amérique du nord. Le propos, fort intéressant et riche débordera quelque peu l’horaire imparti.
Nous remontons ainsi avant la conquête où un imaginaire de l’étranger prend forme dans l’Imago Mundi de Pierre d’Ailly en 1410. Cette iconographie berce les travaux de Colomb qui, une fois en Amérique, recherche les Cynocéphales (hommes à tête de chiens) et les Monoculi (un seul œil) parmi les populations locales. Lorsqu’il entend parler du peuple caribe, il y voit un indice très clair qu’il touche au but : caribe, canibe, le grand khan ? la recherche des Indes… Il ne manque d’un pas pour faire de l’Indien d’Amérique un cannibale…
Au XVIe siècle, Théodore de Bry grave l’image de l’Indien à partir des témoignages qu’on lui apporte. On alterne entre le « bon sauvage » (gravure ci-contre vers 1590, BNF), accueillant et l’anthropophage. Thanksgiving est d’ailleurs une commémoration de l’aide apportée par les Indiens lors de l’installation des Pères Fondateurs. Ils apparaissent nus, digne tenue d’Adam, seulement protégés d’un tissu retenu par une corde autour de la taille. C’est oublier les hivers bien froids du nord ! Déjà, certains témoins cherchent à rétablir la vérité comme le baron de Lahontan plus tard.
Théodore de Bry utilise également ses gravures comme message politique. Lorsqu’il dénonce les massacres commis par les Conquistadores, il utilise des évènements réels comme le dressage de chiens pour manger ou encore le fait de jeter les enfants contre les murs. Cependant, le contexte est celui des guerres de religion en Europe;Théodore de Bry s’est converti au protestantisme, les Espagnols catholiques sont pris pour cibles, devenant des assassins en Europe comme outre-Atlantique.
Dans la gravure de Jacques Le Moyne de Morgues (1533-1588), une « esthétique de l’Indien » naît : grand, beau, musclé, ni noir, ni blanc, jeune. Colomb témoigne que certains se peignent le visage en rouge, voilà la création du Peau-Rouge! L’Indien naïf finit par sombrer dans l’alcool.
Le XVIIe siècle est le temps des premières « ambassades amérindiennes ». Des Indiens sont conduits en Europe pour être montrés. Certains sont utilisés comme petit personnel, ainsi que le Marquis de La Fayette le fit. Le mythe autour d’une Pocahontas se développe. Celle d’une « petite effrontée » comme signifie son nom et d’une histoire d’amour avec John Smith. La réalité est autre. Elle a 9 ans lorsqu’elle rencontre John Smith… et elle épouse un John Rolfe, cultivateur de tabac. Le commerce transatlantique est en pleine expansion et est l’objet de rivalités. Rebecca, de son nom christianisé, est la fille d’un chef indien powhatan, elle est donc très utile pour négocier avec les populations locales. Son portrait est occidentalisé : une jeune femme blanche.
Les XVIIIe et XIXe siècles sont l’époque des salons. De nombreux tableaux représentent les Indiens, mettant en valeur des paysages en arrière-plan, parfois bien fantaisistes. Les Indiens des plaines dans les montagnes, par exemple. Chateaubriand, dans Atala, dresse les amours impossibles de Chactas et Atala. Le premier indien qui s’enfuit avec la seconde, captive espagnole, qui ne peut s’unir à son bien aimé car un vœu de chasteté la retient. Elle se suicide. L’iconographie reprend cette histoire, nous sommes en plein romantisme. Mais c’est aussi un regard plus critique sur la colonisation, teinté de regret qu’émettent des auteurs comme George Sand ou Voltaire. Fabrice Delsahut rappelle ici que les Indiens ne sont pas morts à cause des combats : 80 à 90 % des morts sont dus au choc microbien.
En 1888, Albert Bierstadt présente The Last of the Buffalo (The Corcoran Gallery of Art, Washington) dans un salon parisien. Il est refoulé. Le tableau est hors sujet : les enclosures ont empêché les migrations des troupeaux, la construction des lignes de chemin de fer s’est appuyée sur le massacre de bisons servant à nourrir les ouvriers d’une part, affamer les Indiens d’autre part. Enfin, les Indiens ne chassent plus, en tout cas, plus avec des lances. Ils sont équipés de fusils. Les Comanches avaient d’ailleurs un matériel plus efficace que celui des colons. Le tableau repart aux Etats-Unis où il connaît un franc succès.


Le début du XXe siècle est marqué par les clichés de Curtis. L’impression que les Indiens et leurs savoirs disparaissent donne une urgence à les saisir. Pourtant, ceux-ci craignent les photographes qu’ils considèrent comme des « voleurs d’âmes ». Ainsi, lorsque des documentaristes viennent filmer une cérémonie hopie, ils sont surpris de ne pas retrouver le process décrit précédemment par des chercheurs. Les Hopis avaient changé le déroulé.
Dans les années 1950, des images indiennes sont utilisées par des équipes sportives comme mascottes. Ainsi, les Washington Redskins font partie des 60 % d’équipes possédant des noms indiens. Dans les années 1970, à l’instar du Black Power, les natifs se lancent dans des batailles juridiques pour faire reconnaître leurs droits.
La figure de l’Indien apparaît dès le début du XXe siècle au cinéma : Little Dove’s Romance, 1911 ; The Battle of Elderbush Gulch, 1913. Les acteurs sont de vrais indiens mais à l’image erronée : plumes, indiens des plaines, peu importe le décor, brute sanguinaire… Dans The Wanishing American, 1925, il est considéré comme un Américain. Il faut dire que la première Guerre mondiale est passée par là. Les Indiens ayant participé au conflit ne pouvaient être récompensés, faute d’avoir la nationalité. En 1924, ils l’obtiennent enfin. The Silent Enemy, 1930, donne une place importante à la famine, donc aux persécutions et difficultés pour survivre. Dans les années 1940, c’est le retour du « bon sauvage » qui permet de s’évader de la seconde guerre mondiale. Dans les films de John Ford, l’Indien est figuré avec un bandeau à plumes, construction cinématographique pour faire tenir le costume pendant les cascades. L’Indien des plaines tourne dans le désert, il reprend les cris des animaux et se promène avec des colliers de doigts autour du cou. Les dialogues sont enregistrés en anglais puis diffusés à l’envers afin de représenter les langues indiennes. La filmographie de Ford évolue avec Les Cheyennes en 1964. Les Blancs sont ceux les auteurs de violences. Les acteurs indiens sont toujours payés avec de l’alcool mais autorisés à pratiquer leur langue, donnant l’occasion de se défouler : « espèce de sale serpent ». Les histoires d’amour entre indiens et blancs sont enfin possibles mais à condition de s’enfuir ou que l’un des deux meurt…
Dans les années 1970 émerge un cinéma pro-indien avec Willie Boy en 1969. Ils s’y révoltent contre leurs conditions de vie difficiles. Les évènements historiques et culturels sont davantage respectés. On peut citer : Un homme nommé Cheval en 1970 ; Little Big man, 1970. Des acteurs s’engagent aux côtés de l’American Indian Power comme Marlon Brandon qui refuse de récupérer son oscar pour Le Parrain et laisse son temps de parole à une jeune indienne. Lorsque Chief Georg est nommé dans la catégorie meilleur second rôle, un débat s’engage. Après tout, est-ce un acteur puisqu’il joue son propre rôle d’indien ?
Dans Danse avec les loups, 1980, les modes de vie sont mis en avant mais l’humiliation reste : le Blanc vient apprendre aux guerriers comment combattre. De plus, il séduit la seule Blanche de la tribu, illustrant une fois de plus que le métissage n’est pas possible. Disney sort son Pocahontas.
Il faut attendre 1989 et Powwow Highway pour avoir le premier film indien. La vie des réserves est montrée avec beaucoup d’humour. On peut encore mentionner : Cœur de tonnerre, 1992 ; Incident at Oglala, 1992 ; Phoenix, Arizona, 1998 (là aussi réalisé par des Indiens et montrant la violence dans les réserves, très appréciés par les communautés) ; Les Chansons que mes frères m’ont apprises, 2015…
Une mention spéciale est portée sur Atanarjuat, 2001, qui reprend une légende inuite avec des Indiens et par des Indiens. Selon le réalisateur, il opère un devoir de mémoire. Le film est récompensé par la caméra d’or à Cannes. Un vrai travail de recherche a été mené autour du scénario.
Fabrice Delsahut nous invite donc à visionner ces films tout en insistant sur le fait que l’Indien en lui-même n’existe pas, qu’il n’est qu’une construction… Il termine son exposé sur la citation de John Trudell : « We’re not Indians ans we’re not Native Americans. We’re older than both concepts. We’re the people, we’re the human beings. »