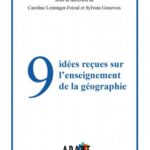Introduction : Avons-nous cru trop vite que le combat contre les pandémies avait été gagné par le génie humain ? Nous avons oublié les leçons du passé et redécouvert notre fragilité. Au Sud comme au Nord, avec des modalités différentes, l’intensification des échanges semble avoir recréé les conditions de la libre circulation des pathologies, ou l’émergence de nouvelles. Comment vivre avec et faire face au retour de la grande peur ? En partenariat avec The Conversation
Intervenant(s) : Philippe Cinquin, Professeur – Praticien Hospitalier – Université Grenoble Alpes ; Sébastien Cognat, Chef d’unité – Bureau de l’OMS à Lyon ; Frédéric Keck, Directeur de recherche – CNRS Laboratoire d’Anthropologie Sociale ; Benoît Tonson, Chef de rubrique Science – The Conversation France
Introduction de Benoît TONSON, journaliste scientifique à The Conversation France :
Cela fait déjà plus d’un an que nous vivons avec la pandémie de Covid 19. Est-ce qu’on a cru un peu trop vite que le combat contre les épidémies était gagné ? Est-ce que nous avons nous-mêmes créé les conditions parfaites de ces émergences virales avec notre empiètement sur la nature et des déplacements sont plus nombreux lointains et rapides ? Quelles leçons avons-nous apprises pour éviter une nouvelle pandémie ?
Pour y répondre, Philippe CINQUIN : professeur de santé publique et chercheur à l’université Grenoble, au CHU de Grenoble et au CNRS.
Frédéric KECK : anthropologue au CNRS
Sébastien COGNAT : chef d’unité au bureau de l’OMS à Lyon.
Question à Sébastien COGNAT :
C’est l’OMS qui, le 11 mars dernier, annonçait que le Covid 19 était une pandémie. Quel est votre travail au sein du bureau de Lyon ?
Sébastien COGNAT : le bureau de l’OMS à Lyon existe depuis 20 ans, il est rattaché au siège de l’OMS de Genève. Sa vocation est d’aider les pays à renforcer leurs capacités en vue de la préparation et de la réponse aux urgences sanitaires. Les interventions du bureau ont pour but de renforcer les capacités de santé publique des États membres, avec une priorité donnée aux pays à ressources limitées, principalement dans le domaine de la détection des épidémies. L’équipe que Sébastien COGNAT dirige est en charge de la capacité des laboratoires à détecter les pathogènes émergeants et les pandémies.
Question à Frédéric KECK :
Vous êtes anthropologue, et avez mené différentes recherches sur le COVID, mais aussi sur les épidémies passées. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Frédéric KECK : il a travaillé avec les virologues de l’université de Hong Kong, qui depuis 1997 et l’émergence du virus de grippe aviaire H5 N1, se préparaient à des pandémies. En 2003, avec le Corona virus du Sras, ils ont lancé l’alerte sur les Corona virus qui émergent chez les chauves-souris. Il a suivi leurs recherches qui consistent à surveiller les réservoirs de pathogènes émergeants, chez les oiseaux sauvages et chez les chauves-souris, en portant un regard particulier sur les marchés aux animaux où les animaux sauvages sont concentrés, mis en contact avec d’autres animaux et avec des humains et qui sont des lieux d’intensification des émergences et de déclenchement de nouvelles pandémies.
Question à Philippe CINQUIN :
Vous êtes est également chercheur et vous vous intéressez à l’application de l’intelligence artificielle pour analyser les données de santé. Quels sont les objectifs de cette recherche, qu’avez-vous pu faire à Grenoble ?
Philippe CINQUIN : l’intelligence artificielle, ou plutôt l’intelligence avec les moyens artificiels, s’applique bien à la santé et en particulier potentiellement à des pandémies. À Grenoble, a été lancé un institut interdisciplinaire d’intelligence artificielle, suite au rapport de Cédric Villani sur l’intelligence artificielle. Philippe CINQUIN est le porteur d’une chaire, « Deep Care », qui développe une vision intégrative de la santé.
Question à Sébastien COGNAT :
Une des missions du bureau de l’OMS est la préparation des États au risque épidémique, voire pandémique. Que peut-on retenir de la crise actuelle et en quoi aucun pays n’était finalement assez préparé ?
Sébastien COGNAT : la pandémie n’est pas encore finie, mais on peut commencer à en tirer certaines leçons.
Tout d’abord une leçon d’humilité : malgré les alertes données depuis 20 ans, les pays n’ont pas mis en place les mécanismes de préparation suffisants. D’abord, au sein des systèmes de santé, (ré)investir dans des systèmes de santé publique, avec par exemple les centres de prévention et de contrôle des maladies, comme au Nigeria, en Corée, en Chine par exemple, sont des structures qui permettent de mieux appréhender les épidémies.
Aussi, on voit que le leadership des chefs d’État et de gouvernement est primordial pour fixer des priorités qui doivent aller au-delà des systèmes de santé, ils doivent concerner l’ensemble des secteurs, y compris jusqu’aux organisations civiles, aux communautés qui sont en première ligne dans ces épidémies. C’est quelque chose que l’OMS avait vu avec les épidémies d’Ebola, qui nécessitaient un contact et une bonne collaboration communautaire. Il faut une approche multisectorielle basée sur les besoins des communautés.
Dans la réponse, plusieurs aspects se sont améliorés tels que le partage des données, le partage des échantillons qui est primordial.
Enfin, il s’agit d’investir dans des structures de recherche et de développement, dans des collaborations pour que les pays aient des capacités de production (vaccins, tests …), qui puissent être mobilisées de façon très rapide. Tout cela doit s’accompagner par des financements (domestiques, de donateurs…) qui doivent intégrer le risque épidémique comme une priorité.
Benoît TONSON : comme les risques économiques par exemple ? Il s’agit d’organisations à l’échelle internationale ?
Sébastien COGNAT : oui, par exemple pour les pays qui bénéficient de financement de la banque mondiale, du FMI, l’évaluation des risques est surtout basée sur le risque économique. Mais le risque sanitaire est une composante essentielle du risque économique, avec un impact sur l’économie, les sociétés, la politique. Ce risque est probablement sous-estimé malgré les multiples alertes depuis le Sras en 2003. Certains pays se sont crus un peu trop à l’abri de ces maladies émergentes.
Question à Philippe CINQUIN :
Une composante importante pour prévenir ces risques, c’est la recherche : tout a été bousculé au début de la pandémie, encore maintenant. Sur quoi avez-vous travaillé plus spécifiquement à Grenoble, notamment sur le lavage des masques jetables ? Et pourquoi ces nouvelles connaissances n’ont pas été mises en pratique ?
Philippe CINQUIN : un travail sur le domaine de l’IA a été mené également.
Concernant le lavage des masques chirurgicaux, Philippe CINQUIN a été confronté à quelque chose de très surprenant, c’est une leçon importante à tirer : il s’agit de la rigidité de notre système réglementaire. En effet, Philippe CINQUIN est le responsable scientifique du centre d’investigation clinique innovation technologique du CHU de Grenoble. Il est normal que la recherche soit très fortement encadrée, il faut respecter les règles. Cependant, au mois de mars, Caroline LANDELLE, hygiéniste du CHU de Grenoble, a alerté sur la pénurie de masques au CHU de Grenoble. Jusqu’à la pandémie, le masque chirurgical était jeté entre chaque patient. Depuis, il peut être gardé quatre heures, voire huit heures pour le masque FFP2. L’hygiéniste a posé la question de trouver des méthodes pour réutiliser les masques chirurgicaux après les avoir décontaminés. L’équipe de Philippe CINQUIN a travaillé à Grenoble, en partenariat avec des collègues du CEA. Le CNRS leur a alors confié une mission pour trouver des solutions pour recycler les masques. Rapidement, une cinquantaine d’acteurs ont participé à ce projet de recherche collaborative (universitaires, industriels, grands organismes…). Ils ont trouvé des solutions dès le mois de mai, dont une solution très simple, c’est-à-dire le lavage des masques chirurgicaux. Ils ont démontré que ce lavage permettait de conserver la compatibilité avec la norme de référence qui s’applique aux masques chirurgicaux. De plus, le lavage des masques chirurgicaux est une solution tout à fait acceptable pour monsieur tout le monde, pour le respect des gestes barrières. C’était justement à l’époque où on a commencé à coudre ses propres masques, alors que les masques chirurgicaux sont beaucoup plus efficaces, avec 98 % de filtration.
Benoît TONSON : pour le grand public, combien de fois peut-on réutiliser un masque chirurgical lavé ?
Philippe CINQUIN : c’est une très bonne question, mais Philippe CINQUIN ne peut pas aujourd’hui répondre officiellement car il est respectueux de la loi du règlement … il est confronté à un problème réglementaire : le masque chirurgical est un dispositif médical. Il est donc soumis à de nombreuses réglementations, et en particulier le code de la santé publique stipule qu’un dispositif médical à usage unique ne doit pas être réutilisé. Philippe CINQUIN a donc demandé l’autorisation de faire une recherche impliquant la personne humaine, avec un dossier déposé auprès de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La réponse était négative, non pas sur le fond mais sur la forme ! Il est impossible de faire cette recherche car il existe un décret qui interdit la réutilisation du masque à usage unique. La dernière étape de cette recherche, après ce qui a été démontré en laboratoire (en collectant des masques chirurgicaux utilisés par les soignants au CHU de Grenoble, lavés 10 fois puis après vérification que la performance était compatible avec les normes), était de demander à des volontaires de porter 10 fois de suite un masque lavé 10 fois et de vérifier la performance. Cette étape a été interdite !
La situation de la recherche devrait permettre de tester des choses qui ne sont pas « dans les clous » actuels. Cette décision est très franco-française, cela fonctionne très différemment en Allemagne par exemple. Le système français est caractérisé par une rigidité qui n’est pas adaptée au niveau de risque de la pandémie. C’est catastrophique, car malheureusement, le Covid est une « gentille maladie » : c’est une maladie qui tue énormément de gens, mais en termes de contagiosité, on connaît bien pire. Philippe CINQUIN craint que le jour où on aura une pandémie avec un virus beaucoup plus agressif et transmissible, la France ne puisse pas s’adapter à cause de notre arsenal réglementaire.
Benoît TONSON : espérons que nous pourrons en tirer les leçons pour adapter nos règles sanitaires contexte d’urgence.
Question à Frédéric KECK :
Retour sur la Chine, où la crise a mis en lumière quelque chose que l’Occident connaissait mal : les marchés aux animaux vivants. Frédéric Keck a d’ailleurs écrit un article dans The Conversation disant que ce serait une mauvaise idée de les fermer. Pourquoi ?
Frédéric KECK : le risque d’émergence zoonotique (qui se transmet de l’animal à l’homme ou de l’homme à l’animal), donc des pathogènes pour lesquels les humains n’ont pas d’immunité, est particulièrement fort en Chine car il y a une forte augmentation de la demande en viande, du fait de l’enrichissement de la population, avec des traditions qui conduisent par exemple à acheter des poulets vivants ou à consommer des animaux sauvages. Des mesures ont été prises pour encadrer les marchés où les consommateurs risquent d’attraper ces virus zoonotiques, notamment dans les marchés aux volailles (nettoyage tous les soirs, consignes d’abattre et vendre des morceaux d’animaux…). Pour les marchés d’animaux sauvages pour la médecine chinoise traditionnelle, il y a eu l’interdiction des civettes masquées (Sras en 2003). Actuellement, on cherche l’animal intermédiaire entre la chauve-souris et les humains.
Le risque, si les mesures sont trop fortes et inadaptées, c’est que si les marchés sont fermés dans les villes, la consommation se déplace dans les banlieues avec une économie de contrebande. C’est là que se développent parfois des élevages d’animaux sauvages dans des conditions non réglementées.
Il est souhaitable que cette demande baisse (les mouvements végétariens taoïste, bouddhiste vont dans ce sens, comme ceux de protection des animaux sauvages), mais une réglementation très forte risquerait de déporter à l’extérieur des villes ces mécanismes d’émergence zoonotique. Les anthropologistes ont donc recommandé non pas de les fermer, mais de les réguler.
Benoît TONSON : en Chine, les animaux vivants représentent-ils une grosse partie de la consommation de viande ?
Frédéric KECK : cela représente entre 20 et 50 % de la consommation de viande, car les consommateurs n’ont pas confiance dans la chaîne du froid dans les supermarchés. Pour que le gouvernement puisse encadrer cette consommation sur les marchés, il faudrait qu’il renforce les conditions de sécurité dans les supermarchés.
Question à Sébastien COGNAT :
A propos de nos contacts avec les animaux sauvages : a-t-on trop tendance à s’approcher des animaux sauvages ? Peut-on imaginer de futures émergences, est-ce un risque que prend au sérieux l’OMS ?
Sébastien COGNAT : oui, depuis plusieurs années c’est très bien documenté : environ 60 % des maladies infectieuses viennent du monde animal, et même 70 à 75 % pour les maladies à potentiel épidémique. Aujourd’hui, plusieurs facteurs augmentent le risque de passage de l’animal à l’homme (zoonose) : les changements de pratique avec de plus en plus de populations qui demandent un accès à la viande ; les pratiques d’élevage de plus en plus intensives. Par exemple le virus nipah en Asie du Sud-Est à la fin des années 1990 qui était dû à la pratique de l’élevage de porcs intensif ; les grippes aviaires qui sont plus en plus fréquentes avec des passages à l’homme, dans des élevages de grande taille.
De plus, l’urbanisation galopante avec des villes qui vont de plus en plus vers les forêts et la faune sauvage, ainsi que les pratiques de pâturage qui accélèrent la déforestation, augmentent le contact entre l’homme et l’animal sauvage, entre l’animal sauvage et l’animal domestique. Le porc, les petits rongeurs peuvent être des « réservoirs », qui augmentent le risque.
Le changement climatique vient également apporter une complexité supplémentaire, avec par exemple l’émergence de maladies transportées par les moustiques (dengue, chikungunya …). Ces maladies viennent aux portes de l’hémisphère Nord et deviennent quasiment endémiques aujourd’hui. Ces maladies transmises par les moustiques parviennent à s’installer dans les régions qui deviennent de plus en plus chaudes en raison du réchauffement climatique. Les zoonoses ne sont donc pas prêtes de disparaître.
Benoît TONSON : les zoonoses sont des maladies transmisses de l’animal à l’homme et vice versa, à partir des moustiques, des oiseaux chauve-souris…
Question à Frédéric KECK :
Quelle est la perception du risque de maladies venant des animaux en Chine ou dans d’autres pays ?
Frédéric KECK : en Chine, c’est assez conscient puisque le gouvernement doit encadrer les pratiques d’élevage et de commercialisation. Frédéric KECK a étudié avec des anthropologues la perception du risque de zoonoses dans différents pays où des personnes sont au contact des animaux de façon quotidienne : cela diffère beaucoup selon les pratiques gouvernementales et les traditions culturelles. Par exemple, en Mongolie, où l’élevage pastoral est une activité très importante, les campagnes d’éducation soviétiques ont fait qu’il y a une forte sensibilisation aux risques de zoonoses. Par contre, au Laos où il y a risque de tuberculose qui peut se transmettre de l’homme vers l’animal (éléphant), ceux qui travaillent avec l’animal ne sont pas conscients du risque. En Australie, les aborigènes vivent avec les chauves-souris, les représentent dans l’art et ils peuvent les manger sans être affectés. Une pratique médicinale avec les deux aspects du virus : poison et remède. Ces anthropologues ont essayé de mettre en avant des savoirs qui ne sont pas seulement ceux de la médecine dans la gestion de ces pathogènes qui passent de l’animal à l’humain.
Benoît TONSON : en Europe, ce risque est assez méconnu, à part celui de grippe aviaire ?
Frédéric KECK : le grand moment de prise de conscience de la zoonose en Europe a été celui de la crise de la vache folle, lorsque les gouvernements ont abattu des millions de bovins pour éviter la transmission. Cela a suscité une baisse de la consommation de viande bovine ainsi qu’une réflexion sur les conditions d’élevage qui favorisent la transmission de ces pathogènes. On a régulièrement des épisodes de grippe aviaire qui conduisent à l’abattage d’animaux pour protéger les humains, ce qui pose la question de la valeur de la vie animale par rapport à la valeur de la vie humaine.
Benoît TONSON : finalement, l’abattage est la solution la plus simple à mettre en place ?
Frédéric KECK : c’est la plus simple techniquement mais aussi la plus coûteuse. Il faut ensuite refaire les élevages. C’est aussi une perte de savoir. Et cela pose des problèmes éthiques sur la destination des animaux de rente. C’est pour cela que toutes les mesures sont prises pour anticiper les pandémies, notamment des sentinelles qui permettent de repérer les virus avant qu’ils ne deviennent endémiques, sont moins coûteuses et plus respectueuses des pratiques locales des éleveurs.
Question à Philippe CINQUIN : concernant le Covid, on a réussi à développer des vaccins rapidement, mais au niveau des remèdes ?
Philippe CINQUIN : à Grenoble, il a lancé un essai sur l’utilisation de l’hydrogène dissous dans l’eau. Il y a de fortes raisons de penser que l’hydrogène pourrait avoir un effet anti-inflammatoire, susceptible d’empêcher la réaction immunitaire très violente qui conduit à « l’orage cytokinique du 10e jour » qui est responsable des complications. L’hydrogène a des propriétés antioxydantes sélectives intéressantes. Un essai clinique est lancé, des volontaires sont recrutés sur Grenoble Dijon : il s’agit de boire un verre d’eau avec un comprimé de 80mg de magnésium métallique. C’est actuellement au stade d’un projet de recherche clinique. L’enjeu n’est pas de traiter la Covid mais de diminuer, de prévenir les complications. Ce qui est triste, c’est qu’aujourd’hui il n’y a pas de solution pour les patients qui démarrent le Covid, mais seulement lorsqu’ils ont des complications.
Benoît TONSON : à l’hôpital, un patient qui a une forme grave en réanimation est soigné de quelle façon ?
Philippe CINQUIN : l’oxygène est un des éléments fondamentaux. Et ce sont principalement des corticoïdes qui ont montré leur efficacité, qui permettent de réduire la réaction inflammatoire.
Question du public :
- Le magnésium avec l’eau peut-il se substituer aux vaccins ?
Philippe CINQUIN : absolument pas. Le vaccin reste l’arme efficace, c’est le vrai traitement de la maladie : en étant immunisé on ne développe pas la Covid. Le comprimé n’est pas un traitement de la Covid mais une prévention des complications.
Benoît TONSON :
On cherche à se prémunir des pandémies. Que peut-on faire en termes de prévention du point de vue des États, des relations internationales ? Que préconise l’OMS ?
Sébastien COGNAT : l’OMS est une organisation d’États. En mai, il y aura l’assemblée mondiale de la santé qui réunit tous les ministres de la santé et des chefs d’État. Les enjeux vont au-delà de la santé. Il y a des questions de gouvernance mondiale qui se posent. On régit les épidémies depuis plusieurs siècles grâce à un règlement sanitaire international qui oblige les États à déclarer les épidémies. Ce règlement a à la fois montré des forces et des faiblesses pendant cette pandémie : les États discutent actuellement de l’adoption d’un traité qui permettrait de mieux appréhender la réponse aux pandémies. Aussi, il y a eu beaucoup d’engagements pris par la communauté internationale (G7, G20, ONU). Malheureusement, ça n’a pas été suivi d’effets ni des investissements nécessaires.
La prise de conscience est brutale et mondiale. Il va falloir faire des investissements dans les secteurs clés (recherche-développement, système de soins et de santé publique, couverture de santé universelle pour protéger les plus faibles) et avoir une approche multisectorielle (secteur de la santé animale, transport, tourisme…) : les aspects sociaux, culturels, philosophiques … doivent être pris en compte.
Benoît TONSON : au niveau de l’anthropologie, vis-à-vis de notre rapport aux risques, où pourrait-on travailler pour mieux alerter, mieux se comporter ?
Frédéric KECK : toutes les organisations de santé internationale convergent pour dire que le risque de transmission de zoonose baisse si l’on diminue l’élevage industriel et si l’on augmente la biodiversité. C’est à la fois une responsabilité pour les gouvernements et les citoyens, notamment pour les éleveurs (vers des élevages plus diversifiés, plus ouverts, qui répondent aussi une demande de bien-être animal).
Benoît TONSON : du côté de nouvelles technologies, de la recherche, on peut aussi de travailler pour prévenir l’émergence ou mieux traiter les épidémies ?
Philippe CINQUIN : on a vu l’importance du « tester, tracer, isoler » et la difficulté de le mettre en place. Il y a un effort à faire sur l’interopérabilité des systèmes d’information de santé. La remontée d’informations est très difficile. Il faut aussi être capable de tracer géographiquement, cela doit bien sûr se faire dans un cadre parfaitement clair du point de vue éthique, ce qui a été fait à Grenoble. Ce dispositif a permis de connaître très tôt au niveau d’un quartier la localisation des personnes qui arrivaient au CHU de Grenoble. Cela a permis d’identifier des zones de sur-risque d’hospitalisation. Des opérations spécifiques de tests ou de messages concernant les gestes barrières ont ainsi été mises en place en association avec la mairie de Grenoble. Le fait de disposer d’un outil qui permet de capturer l’information permet de tout mettre en place et d’être beaucoup plus rapide (d’autres exemples ont été développés à Grenoble pour faire en sorte que le patient devienne un acteur de sa trajectoire de santé).
Un des enjeux actuels est de comprendre les déterminants : qu’est-ce qui fait que certaines personnes évoluent vers des formes graves de la Covid et d’autres non ? Qu’est-ce qui fait que certaines personnes vont faire une covid longue (10% des patients) ? La fouille de l’information est une des trajectoires qui permet d’aller plus loin.
Benoît TONSON : tous les participants de la table ronde vont dans le même sens de la collaboration à différentes échelles.
- Est-ce que l’OMS aurait la capacité de faire des vaccins contre le Covid un bien public ?
Sébastien COGNAT : l’OMS n’a pas ce pouvoir. Ce type de décision est pris dans le cadre de l’OMC. Mais ce que fait l’OMS depuis plusieurs mois, c’est d’acculer les États membres à faire de ce vaccin bien public. L’accès aux brevets et aux licences a été facilité pour une production industrielle. Aussi, l’OMS n’a que le pouvoir que les États membres veulent bien lui donner.
- Les populations africaines et asiatiques sont bien plus habituées à supporter des épidémies, les populations européennes ont-elles donc montré moins de résilience et ont un peu raté la réponse face au Covid?
Frédéric KECK : c’est vrai que les sociétés africaines ont été mobilisées autour des émergences de type Ebola depuis les années 70, et elles ont été très éprouvées par le sida, le paludisme. Il y a une habitude de la prise en charge des épidémies. Et les sociétés asiatiques ont été très mobilisées par la crise du Sras en 2003 et ont joué le jeu de la préparation aux pandémies avec les dispositifs de sentinelles, d’alerte précoce.
La question est de savoir s’il y a des raisons culturelles. On a eu tendance à penser que les épidémies arrivaient dans les pays du Sud et qu’on pouvait les contrôler avant qu’elles ne viennent dans les pays du Nord. Mais la rapidité des moyens de transport fait qu’une émergence, si elle n’est pas détectée très vite, se propage au reste du monde très rapidement.
Aussi, est-ce que par leur discipline, les sociétés asiatiques sont plus capables de sacrifier leur liberté individuelle que les sociétés européennes ? Frédéric KECK pense que les sociétés européennes ont bien mis en place le principe de prévention pour des maladies qu’elles connaissaient bien (tuberculose, variole éradiquée) alors qu’elles étaient moins prêtes pour ces épidémies qui demandent beaucoup de réactivité.
Dans les sociétés européennes, on mobilise facilement le principe de précaution, mais on met moins en place le principe de préparation.
- Les sociétés asiatiques ont-elles vraiment joué le jeu de la pandémie ?
Frédéric KECK : les sentinelles ont bien fonctionné, on a eu rapidement la séquence du virus. Mais les autorités de Wuhan n’ont pas écouté les lanceurs d’alerte qui leur montrait que cette pneumonie atypique était déjà présente dans la population. On avait les informations, mais pas les mesures de contrôle assez tôt.
- Comment réconcilier la problématique du tester-tracer-isoler avec les libertés individuelles ?
Philippe CINQUIN : bonne question, sans réponse. Déjà, il faut tester, ce qui ne pose pas de problème par rapport aux libertés individuelles. Il faut rappeler qu’il y a des enjeux majeurs par rapport à cela aujourd’hui. On a été très lent à mettre cela en place. Aujourd’hui la France a un déficit important en capacité de séquençage, les variants nous montrent que c’est important, il y a un effort à faire là-dessus. Une fois que l’on a fait le test et que l’on a découvert que l’on était positif, se pose la question du tracé et donc de l’acceptabilité de communiquer les personnes avec qui on a été en contact. L’isolement pose la question de la restriction que cela implique.
C’est une question de nature politique. C’est un consensus qui doit s’établir entre la plus-value qu’on obtient en termes de santé publique et le coût que cela a en termes de restriction des libertés publiques individuelles.
- Est-ce-que l’OMS sait quand la pandémie a démarré ?
Sébastien COGNAT : une enquête est ouverte, des experts internationaux se sont déplacés en Chine. Le rapport arrive dans les jours à venir. Aujourd’hui nous n’avons pas de certitude sur la chronologie exacte. Wuhan a été indiquée comme le point de départ, ce n’est pas certain. Cependant cette question ne doit pas devenir majoritaire. C’est important de comprendre d’où vient cette pandémie pour pouvoir mieux prévenir la suivante, mais aujourd’hui l’effort doit se faire sur le contrôle de la pandémie.
Retour sur l’idée de vaccin comme bien public mondial : certes, l’OMS n’a pas ce pouvoir mais une initiative a été mise en place, le « covax », avec d’autres organisations internationales. Cette initiative permet d’acheter des vaccins en grande quantité pour pouvoir les distribuer à des pays à ressources limitées, afin de permettre un accès plus équitable aux vaccins au niveau mondial.
- Comment faire pour booster la recherche et « mettre le paquet sur la santé » ?
Philippe CINQUIN : très bonne question. C’est très triste et incompréhensible : la recherche en France est régulièrement diminuée dans son budget. Le nombre de postes ouverts dans les organismes comme le CNRS, l’Inserm… baisse. Le nombre de postes disponibles dans les universités baisse également. Donc on ne peut pas vraiment s’étonner que l’on ne soit plus en capacité de trouver des solutions rapides aux problèmes tels que la Covid. Philippe CINQUIN trouve qu’au pays de Pasteur, c’est triste que l’on n’ait pas été capable de produire un vaccin. Par exemple, la chercheuse Katalin Kariko, à l’origine d’un des deux vaccins ARN, avait candidaté comme enseignante chercheuse à l’université de Montpellier et n’a pas été recrutée … c’est un exemple intéressant : la tendance de la recherche en France est d’être pilotée par des programmes de recherche très précis. On dit aux chercheurs ce sur quoi ils doivent travailler, et en l’occurrence les vaccins ARN n’étaient pas à la mode à l’époque, et on n’arrivait donc pas à faire financer ce type de recherche !
Tant que la France continuera à ne pas payer correctement les enseignants chercheurs et à ne pas leur donner les moyens de poursuivre leurs recherches, on aura des grosses difficultés. C’est vrai dans le public mais aussi dans le privé : Sanofi est par exemple en train de supprimer des centaines d’emplois dans ses centres de recherche ! Il ne semble pas que pour la prochaine épidémie, nous aurons plus de capacités industrielles à y répondre…
La réponse est donc entre les mains du gouvernement. Cela fait des années que les gouvernements successifs ont diminué la part du budget de la recherche en France. On recule. Philippe CINQUIN est inquiet, il ne voit pas que la pandémie fait changer le mouvement.
- Est-ce le même sentiment du côté des sciences humaines et sociales ?
Frédéric KECK : pour les sciences humaines, cette pandémie a été l’occasion de poser des questions à un niveau général. Cela a suscité la réflexion sur l’anthropocène (l’impact de l’espèce humaine sur son environnement, lien entre pandémie et réchauffement climatique, les zoonoses…). En ce qui concerne l’accès sur le terrain, cela fait un an que les anthropologues n’ont pas pu faire de recherches sur place. Il faudra donc faire des recherches dans le contexte post pandémique pour étudier ses impacts sur les sociétés.