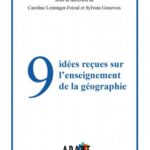Je remercie vivement l’Université de Nantes de son invitation et Mathieu Dubois de son aimable présentation.
Je débuterai cette conférence par trois anecdotes, significatives de situations vécues par un spécialiste français de la laïcité.
Première anecdote : je donne une série de cours à NYU. L’Université de New-York. Un étudiant veut me mettre en difficulté en me posant une colle : « Je ne comprends pas, me déclare-t-il faussement naïf, en France l’école est gratuite, laïque et obligatoire. Pourtant l’Etat finance des écoles privées catholiques. En bonne logique, ces établissements ne devraient pas exister, puisque l’école laïque est obligatoire. »
Rendons-nous, ensuite, au Mexique. En 2009, des manifestations célèbrent les 150 ans de la séparation mexicaine, effectuée donc en 1859. Mon collègue, Roberto Blancarte, donne la conférence inaugurale. Il fait allusion à un historique de la laïcité en France que vient de publier un organisme officiel, le Haut Conseil à l’Intégration. Cet historique affirme, entre autres erreurs, que le Mexique a imité la loi française de séparation. Blancarte conclut son propos en remerciant chaleureusement le Haut Conseil à l’Intégration d’avoir démontré que les Mexicains sont, je le cite, « le peuple le plus intelligent du monde, puisqu’en 1859 ils se sont dit : ‘imaginons ce que ferons les Français en 1905 et imitons-les’ ».
Enfin, terminons ce parcours par Barcelone où l’UNESCO a organisé, il y a 12, 15 ans, je ne sais plus exactement, une conférence sur les Minorités. La première séance donne la parole aux représentants des Etats. Le délégué du Ministère de la culture affirme péremptoirement : « En France, il n’y a pas de minorités ». La personne qui est à côté de moi ricane, et dit en anglais : « Oui, bien sûr, comme en Iran, il n’y a pas d’homosexuels ».
Ces exemples, parmi d’autres, montrent la difficulté de rechercher véracité et objectivité alors que des lieux communs ont valeur d’évidence. Je résume souvent ma situation ainsi : en France, on me somme d’être pour ou contre le foulard ; ailleurs on me demande d’analyser les affaires de foulard, et on me juge sur la solidité de mon argumentation historique et sociologique.
Reprenons brièvement la première anecdote : l’invocation récurrente de l’école « laïque, gratuite et obligatoire », alors même qu’il existe des écoles privées sous contrat, hors contrat et la possibilité d’un enseignement à domicile, illustre comment de fausses croyances peuvent influencer nos convictions en matière de laïcité. Car ce n’est pas pour rien que l’on répète si souvent un stéréotype aussi erroné. Le déni de la réalité qu’il implique permet de faciliter une orientation idéologique qui se croit neutre, alors qu’elle repose un imaginaire collectif faussé. Pour la sociologue, Colette Guillaumin, autrice de l’ouvrage L’idéologie raciste : genèse et langage actuel (1972), le racisme existe, non parce que la notion de « race » aurait une quelconque validité scientifique, mais parce que l’imaginaire collectif dominant lui confère une valeur de réalité. Beaucoup de gens croient voir des races, se comportent comme si celles-ci existaient, et cela a des effets sociaux. Il en est de même de beaucoup d’aspects de ce qui est socialement nommé « la laïcité » ; et c’est pourquoi l’analogie avec la question de la race, même si elle n’est pas à prendre au pied de la lettre, me semble pertinente.
Je vais donc tenter de donner un aperçu de la manière dont il est possible d’aborder la laïcité en France, avec une approche de sociologie historique. Des raccourcis synthétiques seront obligatoires, vu le temps imparti. Mais si certains d’entre eux posent question, le débat permettra d’apporter les précisions nécessaires.
Un mot d’abord sur le cadre conceptuel. Je distingue trois seuils de laïcité (plus exactement, trois seuils de laïcisation). Ces trois seuils correspondent à ce que Max Weber appelle des « idéaux-types », c’est-à-dire, en simplifiant, des portraits-robots. Un portrait-robot ne donne pas le visage, la silhouette d’une personne de façon complète, mais il permet, cependant, de l’identifier par des traits caractéristiques. Analogiquement, il en est de même entre l’idéal-type wébérien et la réalité empirique. J’ajouterai que, comme le présent est imprégné d’histoire, les caractéristiques d’un seuil ne disparaissent pas, comme par enchantement, lors du seuil suivant ; simplement elles ne sont plus dominantes car l’épaisseur historique d’une société n’empêche nullement des changements sociaux de se produire. Ruptures et continuité coexistent.
Le premier seuil
Le premier seuil de laïcisation se construit lors de la Révolution et de son recentrage autoritaire par Napoléon Bonaparte. L’acquis historique d’une Révolution est ce qu’il en reste quand celle-ci est terminée. Or, ce qui se met en place, au début du XIXe siècle, c’est le régime juridique des cultes reconnus où s’instaure un pluralisme religieux limité à ces cultes : il s’agit de deux cultes protestants, luthérien et réformé, du culte israélite, progressivement intégré dans ce système d’égalité formelle, et, bien sûr, du culte catholique, le culte sociologiquement dominant.
Ce simple rappel n’a rien d’évident car, dans une histoire traditionnelle qui souvent perdure, il est seulement question du Concordat, en le datant d’ailleurs de sa signature en 1801, et non de sa ratification législative, en 1802, conjointement avec les Articles organiques du culte catholique et ceux des cultes protestants, c’est-à-dire des textes attestant ce pluralisme. Donc, la mention du seul Concordat, et la datation de 1801, connotent une problématique qui, consciemment ou non, privilégie la continuité avec le Concordat de 1516, appréhende le système napoléonien comme une sorte de retour à l’Ancien-Régime où l’Eglise catholique était la seule légitime.
Or, la situation s’avère structurellement différente. Certes, le Concordat implique que le Premier Consul doit être catholique, mais si Bonaparte déclare appartenir à cette religion, il n’a pas caché qu’il se serait fait protestant si le rapport de force religieux avait été différent et il s’est voulu musulman lors de la campagne d’Égypte. L’instauration d’un pluralisme religieux, même limité à certains cultes, change fondamentalement les rapports entre l’Etat et la religion. Leur lien n’est plus dogmatique mais administratif. Lors de la Restauration où, pourtant, il existe une inflexion cléricale, Lamennais accuse l’Etat d’être « athée ». Si ce propos est excessif, il n’en reste pas moins que le Code civil s’écarte de certaines normes catholiques et que la loi ne dépend plus de préceptes religieux. Cependant, outre le fait d’assurer un service public des « secours de la religion » (selon l’expression de l’époque), les cultes reconnus ont pour mission de façonner la morale publique. A la manœuvre, aussi bien dans l’instauration de ce régime des cultes que pour le Code civil, Jean-Marie Étienne de Portalis veut compléter la loi laïcisée par une morale imprégnée de religion, sinon cette loi serait, affirme-t-il, « semblable à une justice sans tribunaux ».
L’autoritarisme napoléonien se conjugue en fait avec une vision philosophiquement libérale de la religion, non pas au sens où cette dernière serait libre, mais au sens où elle ne représente plus qu’un fragment du social, alors qu’elle le surplombait avant la Révolution. Ainsi, par exemple, en 1763, quand l’épidémie de variole fait rage, le Parlement de Paris soumet toute inoculation à l’approbation préalable de la faculté de théologie de la Sorbonne. Par ailleurs, alors, un médecin pouvait être pénalisé s’il cachait à son malade l’approche de la mort : il fallait, par les derniers sacrements, pouvoir se préparer religieusement au voyage dans « l’au-delà ». Or, dès 1803, la loi crée la notion d’«exercice illégal de la médecine », cinquante ans avant le Royaume Uni, pourtant en avance dans les mutations scientifiques et techniques médicales, car cette institutionnalisation de la médecine s’opère avant ces mutations.
Autre exemple : la loi de mai 1806 indique : « Nul ne peut ouvrir d’école et enseigner publiquement sans être membre de l’Université et gradué par une de ses facultés ». L’Empereur émancipe de l’Eglise catholique l’institution crée par elle, et il rend nécessaire l’autorisation du gouvernement pour tenir une école secondaire privée. Pendant tout le siècle, l’Université se voudra un lieu de libre débat, y compris dans les matières religieuses et, progressivement, l’école primaire va vouloir s’émanciper de la religion. Je n’insiste pas car les luttes scolaires sont mieux connues que les tensions qui ont trait à l’univers médical.
Si je résume, trois rupture sont effectuées : la première par le pluralisme des cultes reconnus où le catholicisme n’est plus que, selon les termes mêmes du Concordat, la « religion de la grande majorité des Français » ; la seconde par le fait que la reconnaissance officielle de la légitimité de la religion ne concerne plus la vérité de ses dogmes mais le fait qu’elle apparaît comme une institution de socialisation ; et donc, troisième rupture, il s’opère une différenciation institutionnelle où la religion n’est plus socialement porteuse d’un sens social qui concernerait l’ensemble des aspects de la vie. Des embryons d’institutions qui devaient auparavant tenir compte de ses normes, comme la médecine, ou se situaient sous son influence, comme l’école, se structurent progressivement, se développent, s’autonomisent dans le cadre de la prédominance de l’Etat et de sa législation civile. Ces institutions vont engendrer de nouveaux clercs (médecins, enseignants, etc) aptes à encadrer la population, à donner un sens nouveau, un sens séculier, à des conduites sociales.
Bref, le premier seuil de laïcisation équivaut à la sortie du « régime de catholicité » de l’Ancien Régime dont parle, dans ses travaux, l’historien Emile Poulat. Naturellement, l’Eglise catholique ne se laisse pas déposséder du rôle social englobant qui était le sien sans réagir. Inversement, beaucoup de nouveaux clercs vont estimer que la fonction dévolue à « l’Eglise » (catholique) reste trop importante et ne correspond plus à l’air du temps. En conséquence, l’histoire politique et culturelle de la France du XIXe siècle est traversée par la lutte de deux France (en fait deux minorités actives) : la France traditionnelle, « fille aînée de l’Eglise » qui tente d’infléchir la logique du premier seuil de laïcisation dans un sens « clérical », et la France moderne, fille de la Révolution, qui tente, elle, d’infléchir cette logique dans un sens « anticlérical ».
L’instabilité des régimes politiques dans notre pays qui en résulte va marquer fortement la mémoire collective. Résultat : la tentative d’instauration d’un pluralisme religieux se trouve surdéterminée par un conflit dualiste, dont l’enjeu n’est rien moins que l’emprise sur l’appareil d’Etat lui-même. Dans cette situation, chacun se trouve sommé de choisir son camp. Or, dans ce conflit, le camp qui estime incarner la modernité forme, dans la seconde moitié du XIX siècle, ce que Charles-Augustin Sainte-Beuve appelle « le grand diocèse de la Libre-pensée », entité nullement incluse dans le régime juridique des cultes reconnus. Et, pour ses membres, loin d’avoir un rôle positif de socialisation morale, la religion apparaît nocive, car elle est considérée comme autoritaire, intolérante, passéiste alors que la démocratie a besoin d’un citoyen libre, tolérant, actif.
Le deuxième seuil
A partir des années 1880, s’établit ce que les historiens appellent la « République des Républicains » ; un basculement s’opère vers une autre logique, celle du second seuil de laïcisation. Ce basculement s’effectue, dans le cadre d’un libéralisme démocratique, avec des lois instaurant la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté des funérailles, le droit de se syndiquer, etc. Cette démocratisation implique, toutefois, une nouvelle rupture avec la religion. La liberté des funérailles le montre : auparavant lesdits mécréants se trouvaient enterrés en « terre maudite », c’est-à-dire dans la partie du cimetière non bénie par le prêtre. La fin de cette discrimination est vécue par le catholicisme comme une dépossession. Cependant, la religion bénéficie des libertés nouvelles : ainsi, la presse catholique est plus libre que sous le Second Empire. Un leader politique comme Jules Ferry tente un équilibre entre les deux aspects, l’aspect de rupture et l’aspect de liberté. Si la laïcisation de l’école publique supprime le cours de morale religieuse, l’école vaque un jour par semaine, outre le dimanche, pour faciliter la tenue du catéchisme. L’Etat laïque a donc des devoirs, non plus maintenant envers la religion, mais envers la liberté religieuse, ce qui mécontente des laïques intransigeants. Cela permet d’éviter une condamnation globale de Léon XIII, sans toutefois rassurer les catholiques.
Les années 1890 voient le doublement mouvement de Ralliement (du côté catholique) et d’Esprit nouveau (du côté républicain). Les luttes religieuses vont-elles être supplantées par les luttes sociales ? Non, et après l’affaire Dreyfus, un durcissement se manifeste avec la loi de 1901 sur la liberté d’association. Celle-ci établit un régime spécifique pour les congrégations, qui relève d’autant moins du libéralisme démocratique qu’Émile Combes applique cette loi de façon très rigoureuse. S’en suit une période brève mais intense d’anticléricalisme d’Etat. La loi majeure de 1905, séparant les églises de l’État, met donc aux prises des conceptions divergentes de la laïcité. Ainsi, le projet de loi d’Émile Combes, mais également celui de son successeur au ministère des cultes, Jean-Baptiste Bienvenu-Martin, ne mentionnent pas la liberté de conscience. Aristide Briand et la Commission parlementaire imposent, pourtant, de mettre en tête de la loi un Article premier qui énonce : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions, édictées [par la loi elle-même] dans l’intérêt de l’ordre public. » « Assure », « garantie » : les termes même impliquent un engagement actif de la République.
L’Article 2, que Combes et Bienvenu-Martin avaient mis en tête, et qu’un certain imaginaire collectif croit toujours être l’article le plus essentiel de la loi, supprime le service public des cultes reconnus en affirmant que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Mais cet Article 2 rappelle, in fine, la primauté de l’Article 1er en déclarant que, dans des lieux fermés, comme les internats, les hôpitaux, les prisons, … des services d’aumônerie pourront être rétribués sur fond public, afin -je cite- d’«assurer le libre-exercice du culte ».
Liberté de conscience et libre exercice des cultes imprègnent la loi. Faute de pouvoir développer, comme je le fais dans le tome 2 de mon étude sur La loi de 1905 n’aura pas lieu, je me limiterai à quelques indications : des dérogations favorables aux Eglises sont faites par rapport à la loi de 1901, cela afin de faciliter la vie ecclésiale ; il en est de même des mesures transitoires (pensions, allocations, gratuité temporaire des presbytères , etc) ; aspect peu connu, car beaucoup d’historiens ne l’indiquent pas : la liberté de manifester sa religion dans l’espace public se trouve renforcée par rapport à la situation ante (Article 28, couplé avec l’Article 44); d’autre part, les mêmes peines punissent les incitations abusives à pratiquer une religion et celles qui conduiraient à ne pas la pratiquer (Article 31). La police des cultes est très allégée par rapport à ce qu’avait prévu Combes ; elle se situe dans le cadre du droit commun, à une exception près, l’Article 34, que Briand espérait provisoire. Les biens des fabriques, estimés à 400 millions de francs, à une époque où un instituteur gagne 200 francs par mois, et que certains leaders d’opinion considéraient comme des biens publics, sont intégralement transmis aux associations cultuelles formées selon « l’organisation générale de leur culte (Article 4). A ces association sont également dévolues, gratuitement et de façon indéfinie, les édifices du culte, propriété publique depuis 1790, ainsi que ceux construits au XIXe siècle en bénéficiant de fonds publics (Article 13).
Je viens de mentionner les associations cultuelles. De fait, avec la suppression du service public des cultes reconnus, l’État ne considère plus officiellement la religion comme une institution qui serait une instance de socialisation. L’obligation de l’instruction, l’enseignement de la morale laïque à l’école publique, le début des obligations médicales, instauré en 1902 par la loi sur la vaccination antivariolique, changent structurellement la donne. Ainsi, la mort est maintenant socialement considérée comme la fin de la vie à retarder, ce qui est l’affaire du médecin. La vivre comme le passage dans l’au-delà est devenu une croyance privée.
Nous retrouverons ce problème à propos du djihadisme. L’important, pour le moment, consiste à comprendre qu’il s’opère une dissociation institutionnelle, où l’Etat ne se prononce plus sur le rôle positif ou négatif de la socialisation morale dont la religion est porteuse. La religion se trouve, désormais, liée aux libertés publiques et elle fait partie de l’ensemble associatif de la société civile, ensemble qui s’est développé avec l’essor de la démocratie. Cependant, et c’est là que la loi de 1905 opère un travail de dentelle, l’Etat reconnait, avec l’Article 4 déjà cité, que certaines religions, l’Église catholique au premier chef, veulent fonctionner en interne comme des institutions. Il en tient compte dans l’attribution des biens et la dévolution des édifices religieux. De même, la justice de l’État laïque peut se référer à un droit infra-étatique, comme le droit canon, à propos d’affaires internes à une religion. Par exemple, actuellement, le fait que les femmes ne puissent pas être prêtres n’est pas considéré comme une discrimination à l’embauche.
Malgré les gains très importants de liberté apportés par ces changements (un seul exemple : pour la première fois, le pape nomme, seul, les évêques, l’accentuation de la vision libérale de la religion induite par la loi de 1905, et surtout le risque de voir la séparation française faire tache d’huile dans d’autres pays (notamment l’Espagne), décidèrent Pie X à ordonner aux catholiques de ne pas se conformer à la loi. Celle-ci fut, en conséquence, modifiée dès le 2 janvier 1907 dans le but, affirmé explicitement par Briand, de rendre, je cite, « l’Eglise catholique légale malgré elle ». L’exercice du culte pouvait dorénavant s’effectuer dans le cadre de la loi de 1881 sur les réunions publiques, ou celle de 1901 sur la liberté d’association (ce qui fait d’ailleurs qu’aujourd’hui la plupart des associations musulmanes pour l’exercice du culte se situent dans le cadre de la loi de 1901). Mais Pie X refusa également la loi du 2 janvier 1907. Deux autres lois, adoptées en mars 1907 et avril 1908, permirent, malgré tout, à la séparation d’être effective et de fonctionner, à peu près pacifiquement, moins de trois ans après avoir été votée. En 1914 une « Union sacrée » est globalement réalisée face à l’Allemagne. En 1904, elle aurait paru impossible, car la France se trouvait au bord de la guerre civile.
Un tel résultat est remarquable. Il n’a pas été obtenu sans peine : Briand, aussi bien dans la fabrication que dans l’application de la loi, s’est trouvé accusé, de façon récurrente, par une partie de la gauche, de faire, je cite, des « concessions excessives » et de « désarmer » l’État républicain face au « danger catholique ». On lui a reproché de témoigner de plus d’habileté que d’attachement aux principes. En fait, il avait compris que, quand le terrain est jonché de mines, on n’atteint pas le but fixé en ligne droite. Cependant, par ailleurs, la « révolte contre la loi » de l’Eglise catholique, pour reprendre les termes de Briand, a eu comme conséquence que ce n’est pas exactement la loi de 1905 qui s’est appliquée au catholicisme. La séparation réalisée avec cette Eglise a été moins avantageuse et plus conciliatrice
La séparation a été moins avantageuse pour le catholicisme : faute d’association cultuelle pour les recevoir, les biens des fabriques ne lui ont pas été attribués, même ceux que Briand tenta de sauvegarder avec la loi d’avril 1908, car cela aurait nécessité de créer des Sociétés de secours mutuels catholiques, et Pie X s’y opposa. Par ailleurs, suite au refus de la loi, les prélats durent quitter leurs palais épiscopaux, ce qui frappa l’opinion. Les pensions et les allocations ne purent être attribuées. Le thème de la « spoliation », constant, dès le départ, chez les catholiques intransigeants (et qui avait provoqué la crise des inventaires) sembla alors, effectivement, être une conséquence de la loi, alors qu’en fait ce fut une conséquence de son refus. Quant aux laïques intransigeants, ils furent très contents de pouvoir constater que certaines de leurs principales revendications, auxquelles la loi ne faisait nullement droit, étaient finalement, de fait, satisfaites. Le leader radical-socialiste, Camille Pelletan déclarait ironiquement que les non possumus du pape provenaient du « Saint Esprit » ! De là, le développement d’un récit d’une séparation stricte, récit commun à deux légendes, une légende noire cléricale et une légende dorée anticléricale ; certain prétendant même que Combes était le père de la séparation.
En même temps, la séparation a été plus conciliatrice que prévue envers le catholicisme car, malgré la succession des refus pontificaux, les églises ont quand même été dévolues à un clergé catholique romain, les occupant, je cite, « sans titre juridique », alors que la minorité de clercs catholiques qui tentèrent de former des associations cultuelles se les virent finalement refuser. Conséquence imprévue de l’Article 4, et point aveugle de la mémoire collective, le paradoxe de la séparation s’avéra être le suivant : quand deux prêtres se disputaient une église, celui qui, fidèle à sa hiérarchie, refusait de se conformer à la loi l’emportait sur celui qui voulait l’appliquer, et se déclarait « catholique républicain ».
Cette singularité assez étrange fut sans doute nécessaire, mais il est possible de se demander si le prix à payer n’a pas consisté à donner la priorité à un apaisement relatif, en limitant quelque peu le principe d’une égale liberté de conscience. Cela a, en tout cas, défavorisé le pluralisme et a favorisé le maintien d’un habitus dualiste, pour deux raisons. Premièrement si l’Etat fut mis hors champ du conflit, la querelle scolaire continua et devint, jusqu’à un certain point, un conflit substitutif pour ceux qui, dans les deux camps, rêvaient d’en découdre. En revanche, l’apaisement s’accentua au niveau de la séparation elle-même, par l’accord sur les diocésaines en 1924, l’acceptation par l’épiscopat de la laïcité de l’Etat en 1945, et la constitutionnalisation de la laïcité l’année suivante. Mais, du coup, l’utilisation sociale du terme de « laïcité » fut souvent réduite à ce qui restait conflictuel, comme le refus d’un subventionnement de l’école privée.
Seconde raison : si la loi de 1905 et les trois lois, votées en 1907 et 1908, ont éloigné les dangers d’une guerre civile, il s’est agi d’une sorte de paix armée. Les « deux France » ont continué leur face à face en développant deux réseaux de sociabilités dans le cadre de la société civile. Il a existé, en effet, un réseau de sociabilité catholique, comportant des patronages, des mouvements de jeunesse (la JEC, la JAC, la JOC, la JIC…), des Ligues féminines, une presse catholique, le syndicat CFTC, … Il se développa également un réseau de sociabilité laïque (complété, ensuite, par un réseau communiste) où la Ligue de l’enseignement fonda, dans l’entre-deux guerres, des Fédérations départementales des Œuvres Laïques (FOL). Et, notons-le, le terme « laïque » ne renvoie pas, là, à une régulation politique de la liberté de conscience, mais à un background culturel qui peut être irénique et areligieux ou bien polémique et antireligieux. D’où l’ambivalence fondamentale du terme de « laïcité » qui peut revêtir socialement deux significations divergentes.
En résumé, le deuxième seuil de laïcisation comporte, comme le premier, trois caractéristiques types. La religion prend, socialement, une forme analogue à l’association car elle est devenue un choix personnel totalement libre, alors que l’institution, tendanciellement comporte certaines obligations sociales. Dans ce cadre, seconde caractéristique, elle peut avoir des activités dans l’espace public et socialiser celles et ceux qui le souhaitent. Enfin, devenus de « droit privé », les différents cultes voient leur exercice publiquement garanti.
Le troisième seuil
Nous l’avons vu, des institutions, comme l’école et la médecine, remplacent tendanciellement la religion en tant qu’instance de socialisation officielles. Ce processus émerge lors du premier seuil et devient dominant lors du deuxième seuil. Il n’est donc pas étonnant que la déstabilisation de la sphère institutionnelle, opérée, en gros, dans les années 1960 et 1970, et dont « Mai 68 » marque le symbole, induise progressivement une nouvelle donne. Les institutions sont alors contestées comme induisant des situations de non-droit. Les droits des malades, les droits des élèves, etc sont revendiqués. Certains parlent de « consumérisme ». On assiste, en tout cas, à l’avènement d’une société de consommation, ce qui va d’ailleurs de pair avec une accélération de la sécularisation et, conjointement, avec une tentative de sécularisation interne du catholicisme, après le Concile de Vatican II.
Globalement, il se produit un adoucissement très net de la laïcité, mal vécu par des laïques militants, notamment avec la fin de la querelle scolaire, opéré de 1959 à 1984. On assiste, également, à une extension de la laïcisation par la modification de la législation concernant les mœurs (contraception en 1967, IVG en 1975). Cependant, cette extension n’est guère vécue en termes de « laïcité ». Le mot lui-même tend à se dévaloriser, il est souvent considéré comme « ringard » après l’échec du projet de loi Savary, qui aurait créé, de façon souple au demeurant, un Service laïque unifié de l’Education nationale.
C’est dans ce contexte qu’intervient la fin des Trente glorieuses, qui provoque un court-circuit entre la logique de la société de consommation et les contraintes issues de la crise socio-économique. Ce court-circuit s’opère conjointement au passage à une société post-industrielle, à l’émergence de la globalisation, à l’immersion dans une « culture monde ». Pour le sujet qui nous occupe, les nouvelles lois sur l’immigration entraînent la transformation d’un « islam d’hommes seuls », effectuant des aller-retours entre les deux rives de la Méditerranée, en « islam des familles », durablement implanté dans l’Hexagone.
Le basculement dans un troisième seuil de laïcisation s’effectue avec l’« affaire de Creil » où, en 1989, un incident disciplinaire -trois jeunes-filles refusent d’enlever, en salle de classe, le foulard qui couvre leurs cheveux- prend, à la surprise générale, une ampleur nationale. En fait, des facteurs structurels jouent. L’année commence avec, en Iran, une fatwa de l’imam Khomeini contre l’écrivain Salman Rushdie et elle se termine par la chute du Mur de Berlin. L’antagonisme Est-Ouest est remplacé par la peur de l’islam politique. Entre ces deux événements majeurs, la célébration du centenaire de la Révolution française remet en honneur le républicanisme, ce qu’on appelle alors « l’universalisme abstrait ».
Significativement, aujourd’hui, il n’est plus question d’universalisme abstrait mais plutôt d’«universalisme républicain », ce qui étonne beaucoup nos voisins belges ou espagnols, mis ainsi en dehors de l’universel. Pourquoi l’expression d’universalisme abstrait n’est-elle plus utilisée ? A mon sens, à cause des lois sur la parité femme-homme prises au tournant du XXe et du XXIe siècle. Logiquement, les personnes qui défendaient la perspective de l’universalisme abstrait ont combattu ces lois. Ainsi, Elisabeth Badinter a écrit qu’elles engendreraient « le pire communautarisme » et, de fait, l’ensemble des mesures prises (parité, quotas, etc) se situent dans une optique différentialiste. Néanmoins, elles ont été adoptées, puis elles sont passées dans les mœurs car elles permettent de faire un pas en avant vers plus d’égalité entre les sexes. Un jour viendra, sans doute, où elles deviendront inutiles, mais nous n’en sommes pas encore là, loin s’en faut.
L’expression d’universalisme abstrait a donc été abandonnée. Mais cela n’est pas allé de pair avec une réflexion d’ensemble. Or, tout comme la loi de 1905, les lois sur la parité relèvent de ce que Max Weber appelle le « paradoxe des conséquences ». Souvent, on ne parvient pas au but que l’on s’assigne en ligne droite ; beaucoup de zig-zags sont nécessaires, tant le terrain est jonché de mines. Mais si la lutte contre le « plafond de verre », qui maintenait les femmes dans des situations de subordination a été entreprise, l’action politique au sens large a été beaucoup moins volontariste et systématique au niveau des discriminations subies par des minorités. La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité, ou HALDE, créée par Jacques Chirac, a été supprimée par Nicolas Sarkozy, car son action, en matière de laïcité, ne lui convenait pas. De façon dominante, la perspective de l’universalisme abstrait a continué à fonctionner, même si le second terme n’est plus utilisé. Or, dans son ouvrage Les identités meurtrières, publié il y a déjà 24 ans, Amin Maalouf nous a prévenu, je cite : Si « on sent sa langue méprisée, sa religion bafouée, sa culture dévalorisée, on réagit en affichant avec ostentation les signes de sa différence. »
Bien sûr, cet aspect n’est pas le seul en jeu et, comme sociologue et historien, je considère que tout fait social est issu de plusieurs causes. Mais je considère également qu’il est le résultat d’interactions, et cette cause-là est celle sur laquelle nous pouvons le plus agir. Ne serait-ce qu’en évitant des malentendus. S’il est un lieu exempt de racisme, ce sont bien les Urgences. Pourtant, anecdote significative, une personne à peau noire venue aux Urgences, constatant qu’un individu arrivé après elle se trouvait examiné avant, a conclu qu’une fois encore, comme à l’embauche ou pour l’obtention d’un logement, elle se trouvait victime de sa couleur de peau. La raison de la priorité donnée à la seconde personne était naturellement que sa pathologie nécessitait une prise en charge immédiate. Je raconte cet incident pour montrer que, loin de toute perspective moraliste, il faut prendre l’existence de discriminations comme un fait social lourd de conséquences réelles et/ou ressenties.
Le président Macron a parlé de « séparatisme » ; dans mon langage de sociologue, je mentionnerai plutôt le développement d’aspects contre-sociétaux, qui peuvent prendre de multiples formes et sont loin de se réduire à un « séparatisme islamiste ». Pour en comprendre les raisons, il ne me semble pas inutile de revenir sur certaines caractéristiques de ce que je nomme le troisième seuil de laïcisation.
Je l’ai indiqué, on assiste à un ébranlement institutionnel. Les politistes Catherine Colliot-Thélène et Philippe Portier, dans leur ouvrage La métamorphose du prince (2014), parlent, significativement, de la « profanation » des institutions qui, auparavant, avaient elles-mêmes déstabilisé les institutions religieuses. Or l’institutionnalisation de la médecine et l’école était allée de pair avec trois croyances collectives, typiques de la modernité. Première croyance : la santé, le prolongement de la vie d’une part ; l’instruction, la connaissance de l’autre, constituent des biens extrêmement désirables. Seconde croyance : hors de la médecine, pas de santé possible ; hors de l’école, pas de connaissance véritable. Enfin, troisième croyance : la relation médecin-malade est celle « d’une confiance et d’une conscience », l’autorité du professeur ne saurait être mise en doute.
Ces trois croyances collectives s’affaiblissent. Ainsi, la réussite même de la médecine a déstabilisé l’idéal d’un allongement indéfini de la vie au profit d’une revendication à ce qu’on appelle le « droit de mourir dans la dignité », en clair, le droit à l’euthanasie ; la multiplication des diplômés démonétise le diplôme et donne l’impression que l’ascenseur social est désormais en panne. Et, avec cette nouvelle donne, dans un contexte global anxiogène, l’idée que le salut dans l’au-delà est préférable à la vie ici-bas peut trouver une nouvelle crédibilité. Olivier Roy montre l’importance de cet aspect, dans son livre Le djihad et la mort (2016). Or le premier et le deuxième seuil se caractérisaient, tendanciellement, par la croyance en la conjonction des progrès : le progrès scientifique et techniques devait induire, par les progrès de la démocratie, un progrès du bien-être. Si les deux guerres mondiales avaient ébranlé cet optimisme (qui n’a jamais, au demeurant, été total), il subsistait encore partiellement, avec l’opposition entre un bon progrès pacifique et un mauvais progrès guerrier.
Or, ces dernières décennies, à partir du vaste champ des problèmes environnementaux, se sont développés des discours sociaux retournant le progrès contre lui-même, annonçant une apocalypse par l’épuisement de la terre. C’est pourquoi l’invocation récurrente des Lumières ne s’accompagne plus, comme au XVIIIe siècle, de la promesse d’un bonheur terrestre et n’accroche plus le réel, spécialement auprès les perdants de la globalisation-mondialisation. Un désir de « pureté » se propage, pureté religieuse puisque la critique du « ciel » perd de sa plausibilité, et qui explique, sans forcément les justifier, des revendications d’ordre culturel ou religieux au sein des institutions. Mais aussi pureté séculariste, que l’on trouve chez les partisans d’une dite « laïcité sans concession » ni accommodement, comme si la vie quotidienne et sociale ne comportait pas maints arrangements et transactions. Ce n’est pas de cette manière, en tout cas, que laïcité l’a emporté en 1905-1908.
L’institution qui semble rencontrer le plus de difficultés est l’école. Elle dépense plus d’argent pour les établissements des beaux quartiers que pour les autres ; le classement Pisa (et d’autres études) montre que la France est un des pays démocratiques où, malgré le travail admirable de certains enseignants, les « inégalités scolaires », sont les plus fortes. D’autre part, la recherche d’informations, de connaissances, qui s’effectue via les réseaux sociaux, le numérique, déstabilise son mode d’enseignement. Faire la part des choses et distinguer ce qui relève de l’adolescence et ce qui relève d’une possible « radicalisation » n’est pas chose aisée. Bref, il est souvent question de « laïcité » à propos de l’école, indice que certains trains n’arrivent pas à l’heure.
En revanche, on ne parle guère de la « laïcité militaire », indice d’une meilleure maîtrise de la situation. L’armée a, la première en France, mis en œuvre le programme d’une « institution à l’image de la nation », reconnaissant « l’intérêt d’une diversité des compétences culturelles ». Elle constitue un lieu de promotion sociale pour certains jeunes « musulmans ». Dans un document (Expliquer la laïcité française), qu’elle diffuse à l’ensemble de ses cadres, elle prône une laïcité libérale en expliquant, entre autres, que chacun a le droit « d’exprimer son identité religieuse dans l’espace public ». Elle utilise au mieux le service d’aumônerie prévue par la loi de 1905. Elle va jusqu’à mettre à la disposition des militaires qui le souhaitent des barquettes casher ou halal. Ainsi elle a rempli les difficiles missions que le politique a exigées d’elle au Moyen-Orient, en Afrique sub-saharienne. En France même, depuis 2015, la protection d’édifices cultuels, de cérémonies religieuses, d’écoles confessionnelles a été confiée à des soldats, dont certains sont « musulmans » de conviction et/ou de culture, sans qu’aucun drame, jusqu’à présent, n’ait été à déplorer. Bref, l’armée adopte une stratégie inclusive, qui permet d’isoler les extrémistes pour mieux les combattre.
En effet, la dimension stratégique manque souvent, quand il est question de laïcité dans le débat public. Or elle me semble essentielle et nécessite de préférer l’analyse et le sang-froid à l’indignation et à la colère. Je crains qu’un emploi trop extensif de termes comme « fondamentalisme » favorise des amalgames. Il me semble nécessaire de distinguer le djihadisme, le salafisme et la mouvance qui se réfère aux Frères musulmans. En bref, le djihadisme se distingue par son recours à la violence alors que, normalement, le salafisme attend la rédemption de Dieu. Pour ses adeptes, souvent « convertis » après des itinéraires de « galère », la loi divine et les lois humaines sont incompatibles. Le désir de pureté dont j’ai parlé est porté à son maximum et des activités sociales, comme le sport ou la pratique de la musique, tendent à être rejetées. La mouvance frèriste, elle, croit que le Coran a tout inventé et que les règles humaines peuvent le copier. Ses membres participent donc à la vie de la cité, peuvent militer pour plus de justice sociale tout en se montrant fort rigoristes en matière de mœurs. En prenant des responsabilités sociales, certains d’entre eux évoluent, se rendent compte qu’il faut interpréter les textes fondateurs et que différents savoirs peuvent être utiles à cette fin. Certes, l’évolution peut également avoir lieu en sens inverse, et là est bien l’enjeu puisque le discours djihadiste, qui se propage beaucoup plus par internet que dans les mosquées, va tenter de convaincre des musulmans qu’ils ne sont pas des citoyens à part entière et que la société française les rejette.
En résumé, le troisième seuil est marqué par un processus de désinstitutionalisation où l’attitude de déférence envers les institutions tend à être remplacée par des rapports plus consuméristes où l’on revendique des « droits ». Ce processus conduit, deuxième caractéristique, à une crise de la socialisation car l’idéal social implicite présente la « réalisation de soi » comme moralement obligatoire, dans un rapport à autrui empreint, à la fois, de séduction et de rivalité, de compétition. La consommation de masse standardisée contribue à induire une tendance au mimétisme, mais également à des particularités de groupes, à un attrait de la différence qui peut prendre la forme d’identités spécifiques (d’âge, d’orientation sexuelle, religieuse, culturelle, …). Ces identités sont perçues comme des ressources, voire des recours. Enfin, troisième caractéristique, ce qui a trait au religieux se déterritorialise, se structure en réseaux transnationaux, ce qui contribue également à déstabiliser les autorités traditionnelles. Chacun se choisit son guide sur internet.
Remarque conclusive
Retraçant, à très gros traits, l’histoire de la laïcité en France, je me suis borné à la France métropolitaine. Les histoires spécifiques de la France ultramarine peuvent pourtant constituer certains apports. C’est pourquoi, je terminerai par l’évocation d’un penseur antillais, Edouard Glissant, qui a façonné la notion d’identité-rhizome, par allusion aux racines multiples d’une plante. Un racine unique détruit autour d’elle. En revanche le rhizome est la racine qui s’étend à la rencontre d’autres racines : tout élément en influence un autre, sans principe hiérarchique. Le rhizome est souterrain, invisible alors que la société privilégie le voir, le paraître, mais il donne des fruits explicites et se trouve en métamorphose constante. Il me semble que cette métaphore peut s’avérer utile pour faire face à notre situation présente.
***
Note : Les Clionautes remercient Jean Baubérot qui nous a communiqué le texte de son intervention pour cette mise en ligne.
Jean Baubérot est Professeur honoraire, ancien titulaire des chaires « Histoire et sociologie de la laïcité » et « Histoire et sociologie du protestantisme » à l’École pratique des hautes études (Sorbonne). En 1995, il a fondé le Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité, devenu le Groupe Sociétés, Religions, laïcités CNRS-EPHE (GSRL) qu’il a dirigé jusqu’en 2001. Il a donné des cours et/ou des conférences sur la laïcité (outre la France) dans 40 pays des 5 continents. Il a récemment publié : La loi de 1905 n’aura pas lieu, tome 1 : L’impossible loi de liberté (1902-1905) en 2019 et La loi de 1905 n’aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l’État (1902-1908). Tome II : La séparation, légendes et réalités en 2021 aux éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.